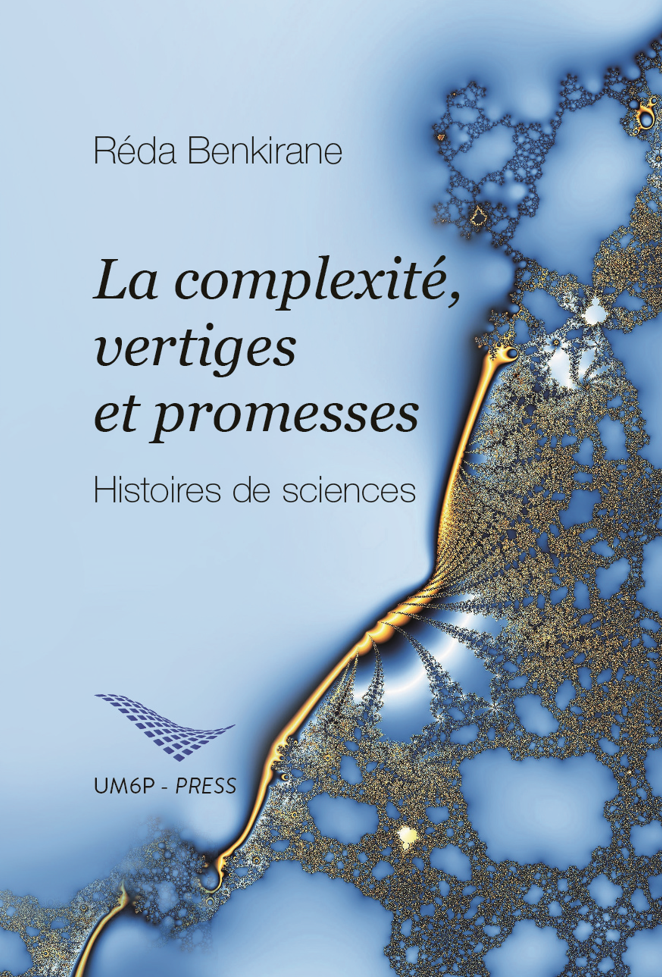Gilles Deleuze, Félix Guattari, Schizophrénie et capitalisme 2, Mille Plateaux. Éditions de Minuit, 1980.
Gilles Deleuze, Félix Guattari, Schizophrénie et capitalisme 2, Mille Plateaux. Éditions de Minuit, 1980.
Chapitre introductif : Le rhizome (HTML)
« Nous sommes fatigués de l’arbre. Nous ne devons plus croire aux arbres, aux racines ni aux radicelles, nous en avons trop souffert (…)Beaucoup de gens ont un arbre planté dans la tête, mais le cerveau lui-même est une herbe beaucoup plus qu’un arbre.
(…) L’arbre impose le verbe « être », mais le rhizome a pour tissu la conjonction « et… et… et…». Il y a dans cette conjonction assez de force pour secouer et déraciner le verbe être.»
Chapitre 12 : Traité de nomadologie (PDF)
« Le nomade se distribue dans un espace lisse, il occupe, il tient cet espace, et c’est là son principe territorial. Aussi est-il faux de définir le nomade par le mouvement. Toynbee a profondément raison de suggérer que le nomade est plutôt celui qui ne bouge pas (…) est celui qui ne part pas, ne veut pas partir, s’accroche à cet espace lisse où la forêt recule, où la steppe ou le désert croissent, et invente le nomadisme comme réponse à ce défi.»
(Copies de travail annotées. RB)
Mille Plateaux
Gilles Deleuze, Félix Guattari
Rhizome
Avant-propos
Ce livre est la suite et la fin de Capitalisme et schizophrénie, dont le premier tome était l’Anti-Oedipe.
Il n’est pas composé de chapitres, mais de « plateaux ». Nous essayons plus loin d’expliquer pourquoi (et aussi pourquoi les textes sont datés). Dans une certaine mesure, ces plateaux peuvent être lus indépendamment les uns des autres, sauf la conclusion qui ne devrait être lue qu’à la fin.
Ont déjà été publiés : « Rhizome » (Ed. de Minuit, 1976) « Un seul ou plusieurs loups ? » (revue Minuit, no 5) ; « Comment se faire un Corps sans organes ? » (Minuit, no 10). Ils sont repris ici modifiés.
1. introduction: Rhizome
Nous avons écrit l’Anti-Oedipe à deux. Comme chacun de nous était plusieurs, ça faisait déjà beaucoup de monde. Ici nous avons utilisé tout ce qui nous approchait, le plus proche et le plus lointain. Nous avons distribué d’habiles pseudonymes, pour rendre méconnaissables. Pourquoi avons-nous gardé nos noms ? Par habitude, uniquement par habitude. Pour nous rendre méconnaissables à notre tour. Pour rendre imperceptible, non pas nous-mêmes, mais ce qui nous fait agir, éprouver ou penser. Et puis parce qu’il est agréable de parler comme tout le monde, et de dire le soleil se lève, quand tout le monde sait que c’est une manière de parler. Non pas en arriver au point où l’on ne dit plus je, mais au point où ça n’a plus aucune importance de dire ou de ne pas dire je. Nous ne sommes plus nous-mêmes. Chacun connaîtra les siens. Nous avons été aidés, aspirés, multipliés.
Un livre n’a pas d’objet ni de sujet, il est fait de matières diversement formées, de dates et de vitesses très différentes. Dès qu’on attribue le livre à un sujet, on néglige ce travail des matières, et l’extériorité de leurs relations. On fabrique un bon Dieu pour des mouvements géologiques. Dans un livre comme dans toute chose, il y a des lignes d’articulation ou de segmentarité, des strates, des territorialités; mais aussi des lignes de fuite, des mouvements de déterritorialisation et de déstratification. Les vitesses comparées d’écoulement d’après ces lignes entraînent des phénomènes de retard relatif, de viscosité, ou au contraire de précipitation et de rupture. Tout cela, les lignes et les vitesses mesurables, constitue un agencement. Un livre est un tel agencement, comme tel inattribuable. C’est une multiplicité -mais on ne sait pas encore ce que le multiple implique quand il cesse d’être attribué, c’est-à-dire quand il est élevé à l’état de substantif. Un agencement machinique est tourné vers les strates qui en font sans doute une sorte d’organisme, ou bien une totalité signifiante, ou bien une détermination attribuable à un sujet, mais non moins vers un corps sans organes qui ne cesse de défaire l’organisme, de faire passer et circuler des particules asignifiantes, intensités pures, et de s’attribuer les sujets auxquels il ne laisse plus qu’un nom comme trace d’une intensité. Quel est le corps sans organes d’un livre ? Il y en a plusieurs, d’après la nature des lignes considérées, d’après leur teneur ou leur densité propre, d’après leur possibilité de convergence sur un «plan de consistance » qui en assure la sélection. Là comme ailleurs, l’essentiel, ce sont les unités de mesure: quantifier l’écriture. Il n’y a pas de différence entre ce dont un livre parle et la manière dont il est fait. Un livre n’a donc pas davantage d’objet. En tant qu’agencement, il est seulement lui-même en connexion avec d’autres agencements, par rapport à d’autres corps sans organes. On ne demandera jamais ce que veut dire un livre, signifié ou signifiant, on ne cherchera rien à comprendre dans un livre, on se demandera avec quoi il fonctionne, en connexion de quoi il fait ou non passer des intensités, dans quelles multiplicités il introduit et métamorphose la sienne, avec quels corps sans organes il fait lui-même converger le sien. Un livre n’existe que par le dehors et au-dehors. Ainsi, un livre étant lui-même une petite machine, dans quel rapport à son tour mesurable cette machine littéraire est-elle avec une machine de guerre, une machine d’amour, une machine révolutionnaire, etc. -et avec unemachine abstraite qui les entraîne ? On nous a reprochés d’invoquer trop souvent des littérateurs. Mais la seule question quand on écrit, c’est de savoir avec quelle autre machine la machine littéraire peut être branchée, et doit être branchée pour fonctionner. Kleist et une folle machine de guerre, Kafka et une machine bureaucratique inouïe… (et si l’on devenait animal ou végétal par littérature, ce qui ne veut certes pas dire littérairement ? ne serait-ce pas d’abord par la voix qu’on devient animal ?). La littérature est un agencement, elle n’a rien à voir avec de l’idéologie, il n’y a pas et il n’y a jamais eu d’idéologie.
Nous ne parlons pas d’autre chose : les multiplicités, les lignes, strates et segmentarités, lignes de fuite et intensités, les agencements machiniques et leurs différents types, les corps sans organes et leur construction, leur sélection, le plan de consistance, les unités de mesure dans chaque cas. Les stratomètres, les déléomètres, les unités CsO de densité, les unités CsO de convergence ne forment pas seulement une quantification de l’écriture, mais définissent celle-ci comme étant toujours la mesure d’autre chose. Écrire n’a rien à voir avec signifier, mais avec arpenter, cartographier, même des contrées à venir.
Un premier type de livre, c’est le livre-racine. L’arbre est déjà l’image du monde, ou bien la racine est l’image de l’arbre-monde. C’est le livre classique, comme belle intériorité organique, signifiante et subjective (les strates du livre). Le livre imite le monde, comme l’art, la nature : par des procédés qui lui sont propres, et qui mènent à bien ce que la nature ne peut pas ou ne peut plus faire. La loi du livre, c’est celle de la réflexion, le Un qui devient deux. Comment la loi du livre serait-elle dans la nature, puisqu’elle préside à la division même entre monde et livre, nature et art ? Un devient deux : chaque fois que nous rencontrons cette formule, fût-elle énoncée stratégiquement par Mao, fût-elle comprise le plus «dialectiquement » du monde, nous nous trouvons devant la pensée la plus classique et la plus réfléchie, la plus vieille, la plus fatiguée. La nature n’agit pas ainsi : les racines elles-mêmes y sont pivotantes, à ramification plus nombreuse, latérale et circulaire, non pas dichotomique. L’esprit retarde sur la nature. Même le livre comme réalité naturelle est pivotant, avec son axe, et les feuilles autour. Mais le livre comme réalité spirituelle, l’Arbre ou la Racine en tant qu’image, ne cesse de développer la loi de l’Un qui devient deux, puis deux qui deviennent quatre… La logique binaire est la réalité spirituelle de l’arbre-racine. Même une discipline aussi «avancée » que la linguistique garde pour image de base cet arbre-racine, qui la rattache à la réflexion classique (ainsi Chomsky et l’arbre syntagmatique, commençant à un point S pour procéder par dichotomie). Autant dire que cette pensée n’a jamais compris la multiplicité : il lui faut une forte unité principale supposée pour arriver à deux suivant une méthode spirituelle. Et du côté de l’objet, suivant la méthode naturelle, on peut sans doute passer directement de l’Un à trois, quatre ou cinq, mais toujours à condition de disposer d’une forte unité principale, celle du pivot qui supporte les racines secondaires. Ça ne va guère mieux. Les relations bi-univoques entre cercles successifs ont seulement remplacé la logique binaire de la dichotomie. La racine pivotante ne comprend pas plus la multiplicité que la racine dichotome. L’une opère dans l’objet quand l’autre opère dans le sujet. La logique binaire et les relations bi-univoques dominent encore la psychanalyse (l’arbre du délire dans l’interprétation freudienne de Schreber), la linguistique et le structuralisme, même l’informatique.
Le système-radicelle, ou racine fasciculée, est la seconde figure du livre, dont notre modernité se réclame volontiers. Cette fois, la racine principale a avorté, ou se détruit vers son extrémité ; vient se greffer sur elle une multiplicité immédiate et quelconque de racines secondaires qui prennent un grand développement. Cette fois, la réalité naturelle apparaît dans l’avortement de la racine principale, mais son unité n’en subsiste pas moins comme passée ou à venir, comme possible. Et on doit se demander si la réalité spirituelle et réfléchie ne compense pas cet état de choses en manifestant à son tour l’exigence d’une unité secrète encore plus compréhensive, ou d’une totalité plus extensive. Soit la méthode du cut-up de Burroughs : le pliage d’un texte sur l’autre, constitutif de racines multiples et même adventices (on dirait une bouture) implique une dimension supplémentaire à celle des textes considérés. C’est dans cette dimension supplémentaire du pliage que l’unité continue son travail spirituel. C’est en ce sens que l’œuvre la plus résolument parcellaire peut être aussi bien présentée comme l’Œuvre totale ou le Grand Opus. La plupart des méthodes modernes pour faire proliférer des séries ou pour faire croître une multiplicité valent parfaitement dans une direction par exemple linéaire, tandis qu’une unité de totalisation s’affirme d’autant plus dans une autre dimension, celle d’un cercle ou d’un cycle. Chaque fois qu’une multiplicité se trouve prise dans une structure, sa croissance est compensée par une réduction des lois de combinaison. Les avorteurs de l’unité sont bien ici des faiseurs d’anges, doctores angelici, puisqu’ils affirment une unité proprement angélique et supérieure. Les mots de Joyce, justement dits «à racines multiples » , ne brisent effectivement l’unité linéaire du mot, ou même de la langue, qu’en posant une unité cyclique de la phrase, du texte ou du savoir. Les aphorismes de Nietzsche ne brisent l’unité linéaire du savoir qu’en renvoyant à l’unité cyclique de l’éternel retour, présent comme un non-dit dans la pensée. Autant dire que le système fasciculé ne rompt pas vraiment avec le dualisme, avec la complémentarité d’un sujet et d’un objet, d’une réalité naturelle et d’une réalité spirituelle : l’unité ne cesse d’être contrariée et empêchée dans l’objet, tandis qu’un nouveau type d’unité triomphe dans le sujet. Le monde a perdu son pivot, le sujet ne peut même plus faire de dichotomie, mais accède à une plus haute unité, d’ambivalence ou de surdétermination, dans une dimension toujours supplémentaire à celle de son objet. Le monde est devenu chaos, mais le livre reste image du monde, chaosmos-radicelle, au lieu de cosmos-racine. Étrange mystification, celle du livre d’autant plus total que fragmenté. Le livre comme image du monde, de toute façon quelle idée fade. En vérité, il ne suffit pas de dire Vive le multiple, bien que ce cri soit difficile à pousser. Aucune habileté typographique, lexicale ou même syntaxique ne suffira à le faire entendre. Le multiple, il faut le faire, non pas en ajoutant toujours une dimension supérieure, mais au contraire le plus simplement, à force de sobriété, au niveau des dimensions dont on dispose, toujours n-1 (c’est seulement ainsi que l’un fait partie du multiple, en étant toujours soustrait). Soustraire l’unique de la Multiplicité à constituer ; écrire à n -1. Un tel système pourrait être nommé rhizome. Un rhizome comme tige souterraine se distingue absolument des racines et radicelles. Les bulbes, les tubercules sont des rhizomes. Des plantes à racine ou radicelle peuvent être rhizomorphes à de tout autres égards : c’est une question de savoir si la botanique, dans sa spécificité, n’est pas tout entière rhizomorphique. Des animaux même le sont, sous leur forme de meute, les rats sont des rhizomes. Les terriers le sont, sous toutes leurs fonctions d’habitat, de provision, de déplacement, d’esquive et de rupture. Le rhizome en lui-même a des formes très diverses, depuis son extension superficielle ramifiée en tous sens jusqu’à ses concrétions en bulbes et tubercules. Quand les rats se glissent les uns sous les autres. Il y a le meilleur et le pire dans le rhizome : la pomme de terre et le chiendent, la mauvaise herbe. Animal et plante, le chiendent, c’est le crab-grass. Nous sentons bien que nous ne convaincrons personne si nous n’énumérons pas certains caractères approximatifs du rhizome.
lo et 2o Principes de connexion et d’hétérogénéité : n’importe quel point d’un rhizome peut être connecté avec n’importe quel autre, et doit l’être. C’est très différent de l’arbre ou de la racine qui fixent un point, un ordre. L’arbre linguistique à la manière de Chomsky commence encore à un point S et procède par dichotomie. Dans un rhizome au contraire, chaque trait ne renvoie pas nécessairement à un trait linguistique : des chaînons sémiotiques de toute nature y sont connectés à des modes d’encodage très divers, chaînons biologiques, politiques, économiques, etc., mettant en jeu non seulement des régimes de signes différents, mais aussi des statuts d’états de choses. Les agencements collectifs d’énonciationfonctionnent en effet directement dans les agencements machiniques, et l’on ne peut pas établir de coupure radicale entre les régimes de signes et leurs objets. Dans la linguistique, même quand on prétend s’en tenir à l’explicite et ne rien supposer de la langue, on reste à l’intérieur des sphères d’un discours qui implique encore des modes d’agencement, et des types de pouvoir sociaux particuliers. La grammaticalité de Chomsky, le symbole catégoriel S qui domine toutes les phrases, est d’abord un marqueur de pouvoir avant d’être un marqueur syntaxique : tu constitueras des phrases grammaticalement correctes, tu diviseras chaque énoncé en syntagme nominal et syntagme verbal (première dichotomie… ) On ne reprochera pas à de tels modèles linguistiques d’être trop abstraits, mais au contraire de ne pas l’être assez, de ne pas atteindre à la machine abstraite qui opère la connexion d’une langue avec des contenus sémantiques et pragmatiques d’énoncés, avec des agencements collectifs d’énonciation, avec toute une micro-politique du champ social. Un rhizome ne cesserait de connecter des chaînons sémiotiques, des organisations de pouvoir, des occurrences renvoyant aux arts, aux sciences, aux luttes sociales. Un chaînon sémiotique est comme un tubercule agglomérant des actes très divers, linguistiques, mais aussi perceptifs, mimiques, gestuels, cogitatifs : il n’y a pas de langue en soi, ni d’universalité du langage, mais un concours de dialectes, de patois, d’argots, de langues spéciales. Il n’y a pas de locuteur-auditeur idéal, pas plus que de communauté linguistique homogène. La langue est, selon une formule de Weinreich, «une réalité essentiellement hétérogène ». Il n’y a pas de langue-mère, mais prise de pouvoir par une langue dominante dans une multiplicité politique. La langue se stabilise autour d’une paroisse, d’un évêché, d’une capitale. Elle fait bulbe. Elle évolue par tiges et flux souterrains, le long des vallées fluviales, ou des lignes de chemins de fer, elle se déplace par taches d’huile1. On peut toujours opérer sur la langue des décompositions structurales internes : ce n’est pas fondamentalement différent d’une recherche de racines. Il y a toujours quelque chose de généalogique dans l’arbre, ce n’est pas une méthode populaire. Au contraire, une méthode de type rhizome ne peut analyser le langage qu’en le décentrant sur d’autres dimensions et d’autres registres. Une langue ne se referme jamais sur elle-même que dans une fonction d’impuissance.
3o Principe de multiplicité : c’est seulement quand le multiple est effectivement traité comme substantif, multiplicité, qu’il n’a plus aucun rapport avec l’Un comme sujet ou comme objet, comme réalité naturelle ou spirituelle, comme image et monde. Les multiplicités sont rhizomatiques, et dénoncent les pseudomultiplicités arborescentes. Pas d’unité qui serve de pivot dans l’objet, ni qui se divise dans le sujet. Pas d’unité ne serait-ce que pour avorter dans l’objet, et pour «revenir » dans le sujet. Une multiplicité n’a ni sujet ni objet, mais seulement des déterminations, des grandeurs, des dimensions qui ne peuvent croître sans qu’elle change de nature (les lois de combinaison croissent donc avec la multiplicité). Les fils de la marionnette, en tant que rhizome ou multiplicité, ne renvoient pas à la volonté supposée une d’un artiste ou d’un montreur, mais à la multiplicité des fibres nerveuses qui forment à leur tour une autre marionnette suivant d’autres dimensions connectées aux premières : « Les fils ou les tiges qui meuvent les marionnettes appelons-les la trame. On pourrait objecter que sa multiplicité réside dans la personne de l’acteur qui la projette dans le texte. Soit, mais ses fibres nerveuses forment à leur tour une trame. Et elles plongent à travers la masse grise, la grille, jusque dans l’indifférencié… Le jeu se rapproche de la pure activité des tisserands, celle que les mythes attribuent aux Parques et aux Normes 2. » Un agencement est précisément cette croissance des dimensions dans une multiplicité qui change nécessairement de nature à mesure qu’elle augmente ses connexions. Il n’y a pas de points ou de positions dans un rhizome, comme on en trouve dans une structure, un arbre, une racine. Il n’y a que des lignes. Quand Glenn Gould accélère l’exécution d’un morceau, il n’agit pas seulement en virtuose, il transforme les points musicaux en lignes, il fait proliférer l’ensemble. C’est que le nombre a cessé d’être un concept universel qui mesure des éléments d’après leur place dans une dimension quelconque, pour devenir lui-même une multiplicité variable suivant les dimensions considérées (primat du domaine sur un complexe de nombres attaché à ce domaine). Nous n’avons pas d’unités de mesure, mais seulement des multiplicités ou variétés de mesure. La notion d’unité n’apparaît jamais que lorsque se produit dans une multiplicité une prise de pouvoir par le signifiant, ou un procès correspondant de subjectivation : ainsi l’unité-pivot qui fonde un ensemble de relations bi-univoques entre éléments ou points objectifs, ou bien l’Un qui se divise suivant la loi d’une logique binaire de la différenciation dans le sujet. Toujours l’unité opère au sein d’une dimension vide supplémentaire à celle du système considéré (surcodage). Mais justement, un rhizome ou multiplicité ne se laisse pas surcoder, ne dispose jamais de dimension supplémentaire au nombre de ses lignes, c’est-à-dire à la multiplicité de nombres attachés à ces lignes, Toutes les multiplicités sont plates en tant qu’elles remplissent, occupent toutes leurs dimensions : on parlera donc d’un plan de consistance des multiplicités, bien que ce « plan » soit à dimensions croissantes suivant le nombre de connexions qui s’établissent sur lui. Les multiplicités se définissent par le dehors : par la ligne abstraite, ligne de fuite ou de déterritorialisation suivant laquelle elles changent de nature en se connectant avec d’autres. Le plan de consistance (grille) est le dehors de toutes les multiplicités. La ligne de fuite marque à la fois la réalité d’un nombre de dimensions finies que la multiplicité remplie effectivement ; l’impossibilité de toute dimension supplémentaire, sans que la multiplicité se transforme suivant cette ligne ; la possibilité et la nécessité d’aplatir toutes ces multiplicités sur un même plan de consistance ou d’extériorité, quelles que soient leurs dimensions. L’idéal d’un livre serait d’étaler toute chose sur un tel plan d’extériorité, sur une seule page, sur une même plage : événements vécus, déterminations historiques, concepts pensés, individus, groupes et formations sociales. Kleist inventa une écriture de ce type, un enchaînement brisé d’affects avec des vitesses variables, des précipitations et transformations toujours en relation avec le dehors. Anneaux ouverts. Aussi ses textes s’opposent-ils à tous égards au livre classique et romantique, constitué par l’intériorité d’une substance ou d’un sujet. Le livre-machine de guerre, contre le livre-appareil d’État. Les multiplicités plates à n dimensions sont asignifiantes et asubjectives. Elles sont désignées par des articles indéfinis, ou plutôt partitifs (c’est du chiendent, du rhizome … ).
4o Principe de rupture asignifiante : contre les coupures trop signifiantes qui séparent les structures, ou en traversent une. Un rhizome peut être rompu, brisé en un endroit quelconque, il reprend suivant telle ou telle de ses lignes et suivant d’autres lignes. On n’en finit pas avec les fourmis, parce qu’elles forment un rhizome animal dont la plus grande partie peut être détruite sans qu’il cesse de se reconstituer. Tout rhizome comprend des lignes de segmentarité d’après lesquelles il est stratifié, territorialisé, organisé, signifié, attribué, etc. ; mais aussi des lignes de déterritorialisation par lesquelles il fuit sans cesse. Il y a rupture dans le rhizome chaque fois que des lignes segmentaires explosent dans une ligne de fuite, mais la ligne de fuite fait partie du rhizome. Ces lignes ne cessent de se renvoyer les unes aux autres. C’est pourquoi on ne peut jamais se donner un dualisme ou une dichotomie, même sous la forme rudimentaire du bon et du mauvais. On fait une rupture, on trace une ligne de fuite, mais on risque toujours de retrouver sur elle des organisations qui restratifient l’ensemble, des formations qui redonnent le pouvoir à un signifiant, des attributions qui reconstituent un sujet -tout ce qu’on veut, depuis les résurgences œdipiennes jusqu’aux concrétions fascistes. Les groupes et les individus contiennent des microfascismes qui ne demandent qu’à cristalliser. Oui, le chiendent est aussi rhizome. Le bon et le mauvais ne peuvent être que le produit d’une sélection active et temporaire, à recommencer.
Comment les mouvements de déterritorialisation et les procès de reterritorialisation ne seraient-ils pas relatifs,perpétuellement en branchement, pris les uns dans les autres ? L’orchidée se déterritorialise en formant une image, un calque de guêpe ; mais la guêpe se reterritorialise sur cette image. La guêpe se déterritorialise pourtant, devenant elle-même une pièce dans l’appareil de reproduction de l’orchidée ; mais elle reterritorialise l’orchidée, en en transportant le pollen. La guêpe et l’orchidée font rhizome, en tant qu’hétérogènes, On pourrait dire que l’orchidée imite la guêpe dont elle reproduit l’image de manière signifiante (mimesis, mimétisme, leurre, etc.). Mais ce n’est vrai qu’au niveau des strates -parallélisme entre deux strates telles qu’une organisation végétale sur l’une imite une organisation animale sur l’autre. En même temps il s’agit de tout autre chose : plus du tout imitation, mais capture de code, plus-value de code, augmentation de valence, véritable devenir, devenir-guêpe de l’orchidée, devenir-orchidée de la guêpe, chacun de ces devenirs assurant la déterritorialisation d’un des termes et la reterritorialisation de l’autre, les deux devenirs s’enchaînant et se relayant suivant une circulation d’intensités qui pousse la déterritorialisation toujours plus loin. Il n’y a pas imitation ni ressemblance, mais explosion de deux séries hétérogènes dans la ligne de fuite composée d’un rhizome commun qui ne peut plus être attribué, ni soumis à quoi que ce soit de signifiant. Rémy Chauvin dit très bien : « Évolution aparallèle de deux êtres qui n’ont absolument rien à voir l’un avec l’autre. 3 » Plus généralement, il se peut que les schémas d’évolution soient amenés à abandonner le vieux modèle de l’arbre et de la descendance. Dans certaines conditions, un virus peut se connecter à des cellules germinales et se transmettre lui-même comme gène cellulaire d’une espèce complexe ; bien plus, il pourrait fuir, passer dans les cellules d’une tout autre espèce, non sans emporter des «informations génétiques » venues du premier hôte (ainsi les recherches actuelles de Benveniste et Todaro sur un virus de type C, dans sa double connexion avec l’ADN de babouin et l’ADN de certaines espèces de chats domestiques). Les schémas d’évolution ne se feraient plus seulement d’après des modèles de descendance arborescente, allant du moins différencié au plus différencié, mais suivant un rhizome opérant immédiatement dans l’hétérogène et sautant d’une ligne déjà différenciée à une autre4. Là encore, évolution aparallèle du babouin et du chat, où l’un n’est évidemment pas le modèle de l’autre, ni l’autre la copie de l’un (un devenir-babouin dans le chat ne signifierait pas que le chat «fasse » le babouin). Nous faisons rhizome avec nos virus, ou plutôt nos virus nous font faire rhizome avec d’autres bêtes. Comme dit Jacob, les transferts de matériel génétique par virus ou d’autres procédés, les fusions de cellules issues d’espèces différentes, ont des résultats analogues à ceux des « amours abominables chères à l’Antiquité et au Moyen Age5 ». Des communications transversales entre lignes différenciées brouillent les arbres généalogiques. Chercher toujours le moléculaire, ou même la particule submoléculaire avec laquelle nous faisons alliance. Nous évoluons et nous mourons de nos grippes polymorphes et rhizomatiques, plus que de nos maladies de descendance ou qui ont elles-mêmes leur descendance. Le rhizome est une antigénéalogie.
C’est la même chose pour le livre et le monde : le livre n’est pas image du monde, suivant une croyance enracinée. Il fait rhizome avec le monde, il y a évolution aparallèle du livre et du monde, le livre assure la déterritorialisation du monde, mais le monde opère une reterritorialisation du livre, qui se déterritorialise à son tour en lui-même dans le monde (s’il en est capable et s’il le peut). Le mimétisme est un très mauvais concept, dépendant d’une logique binaire, pour des phénomènes d’une tout autre nature. Le crocodile ne reproduit pas un tronc d’arbre, pas plus que le caméléon ne reproduit les couleurs de l’entourage. La Panthère rose n’imite rien, elle ne reproduit rien, elle peint le monde à sa couleur, rose sur rose, c’est son devenir-monde, de manière à devenir imperceptible elle-même, asignifiante elle-même, faire sa rupture, sa ligne de fuite à elle, mener jusqu’au bout son «évolution aparallèle». Sagesse des plantes : même quand elles sont à racines il y a toujours un dehors où elles font rhizome avec quelque chose -avec le vent, avec un animal, avec l’homme (et aussi un aspect par lequel les animaux eux-mêmes font rhizome, et les hommes, etc.). «L’ivresse comme une irruption triomphale de la plante en nous » Et toujours suivre le rhizome par rupture, allonger, prolonger, relayer la ligne de fuite, la faire varier, jusqu’à produire la ligne la plus abstraite et la plus tortueuse à n dimensions, aux directions rompues. Conjuguer les flux déterritorialisés. Suivre les plantes : on commencera par fixer les limites d’une première ligne d’après des cercles de convergence autour de singularités successives ; puis on voit si, à l’intérieur de cette ligne, de nouveaux cercles de convergence s’établissent avec de nouveaux points situés hors des limites et dans d’autres directions. Ecrire, faire rhizome, accroître son territoire par déterritorialisation, étendre la ligne de fuite jusqu’au point où elle couvre tout le plan de consistance en une machine abstraite. « D’abord va à ta première plante et là observe attentivement comment s’écoule l’eau de ruissellement à partir de ce point. La pluie a dû transporter les graines au loin. Suis les rigoles que l’eau a creusées, ainsi tu connaîtras la direction de l’écoulement. Cherche alors la plante qui, dans cette direction, se trouve la plus éloignée de la tienne. Toutes celles qui poussent entre ces deux-là sont à toi. Plus tard, lorsque ces dernières sèmeront à leur tour leurs graines, tu pourras en suivant le cours des eaux à partir de chacune de ces plantes accroître ton territoire 6.» La musique n’a pas cessé de faire passer ses lignes de fuite, comme autant de « multiplicités à transformation », même en renversant ses propres codes qui la structurent ou l’arbrifient ; ce pourquoi la forme musicale, jusque dans ses ruptures et proliférations, est comparable à de la mauvaise herbe, un rhizome 7.
5o et 6o Principe de cartographie et de décalcomanie : un rhizome n’est justiciable d’aucun modèle structural ou génératif. Il est étranger à toute idée d’axe génétique, comme de structure profonde.Un axe génétique est comme une unité pivotale objective sur laquelle s’organisent des stades successifs ; une structure profonde est plutôt comme une suite de base décomposable en constituants immédiats, tandis que l’unité du produit passe dans une autre dimension, transformationnelle et subjective. On ne sort pas ainsi du modèle représentatif de l’arbre, ou de la racine -pivotale ou fasciculée (par exemple l’«arbre» chomskien, associé à la suite de base, et représentant le processus de son engendrement d’après une logique binaire). Variation sur la plus vieille pensée. De l’axe génétique ou de la structure profonde, nous disons qu’ils sont avant tout des principes de calque, reproductibles à l’infini. Toute la logique de l’arbre est une logique du calque et de la reproduction. Aussi bien dans la linguistique que dans la psychanalyse, elle a pour objet un inconscient lui-même représentant, cristallisé en complexes codifiés, réparti sur un axe génétique ou distribué dans une structure syntagmatique. Elle a pour but la description d’un état de fait, le rééquilibrage de relations intersubjectives, ou l’exploration d’un inconscient déjà là, tapi dans les recoins obscurs de la mémoire et du langage. Elle consiste à décalquer quelque chose qu’on se donne tout fait, à partir d’une structure qui surcode ou d’un axe qui supporte. L’arbre articule et hiérarchise des calques, les calques sont comme les feuilles de l’arbre,
Tout autre est le rhizome, carte et non pas calque. Faire la carte, et pas le calque. L’orchidée ne reproduit pas le calque de la guêpe, elle fait carte avec la guêpe au sein d’un rhizome. Si la carte s’oppose au calque, c’est qu’elle est tout entière tournée vers une expérimentation en prise sur le réel. La carte ne reproduit pas un inconscient fermé sur lui-même, elle le construit. Elle concourt à la connexion des champs, au déblocage des corps sans organes, à leur ouverture maximum sur un plan de consistance. Elle fait elle-même partie du rhizome. La carte est ouverte, elle est connectable dans toutes ses dimensions, démontable, renversable, susceptible de recevoir constamment des modifications. Elle peut être déchirée, renversée, s’adapter à des montages de toute nature, être mise en chantier par un individu, un groupe, une formation sociale. On peut la dessiner sur un mur, la concevoir comme une oeuvre d’art, la construire comme une action politique ou comme une méditation. C’est peut-être un des caractères les plus importants du rhizome, d’être toujours à entrées multiples ; le terrier en ce sens est un rhizome animal, et comporte parfois une nette distinction entre la ligne de fuite comme couloir de déplacement, et les strates de réserve ou d’habitation (cf. le rat musqué). Une carte a des entrées multiples, contrairement au calque qui revient toujours «au même». Une carte est affaire de performance, tandis que le calque renvoie toujours à une «compétence» prétendue. A l’opposé de la psychanalyse, de la compétence psychanalytique, qui rabat chaque désir et énoncé sur un axe génétique ou une structure surcodante, et qui tire à l’infini les calques monotones des stades sur cet axe ou des constituants dans cette structure, la schizoanalyse refuse toute idée de fatalité décalquée, quel que soit le nom qu’on lui donne, divine, anagogique, historique, économique, structurale, héréditaire ou syntagmatique. (On voit bien comment Mélanie Klein ne comprend pas le problème de cartographie d’un de ses enfants patients, le petit Richard, et se contente de tirer des calques tout faits -Oedipe, le bon et le mauvais papa, la mauvaise et la bonne maman -tandis que l’enfant tente avec désespoir de poursuivre une performance que la psychanalyse méconnaît absolument 8.) Les pulsions et objets partiels ne sont ni des stades sur l’axe génétique, ni des positions dans une structure profonde, ce sont des options politiques pour des problèmes, des entrées et des sorties, des impasses que l’enfant vit politiquement, c’est-à-dire dans toute la force de son désir.
Est-ce que toutefois nous ne restaurons pas un simple dualisme en opposant les cartes aux calques, comme un bon et un mauvais côté ? N’est-ce pas le propre d’une carte de pouvoir être décalquée ? N’est-ce pas le propre d’un rhizome de croiser des racines, de se confondre parfois avec elles ?Une carte ne comporte-t-elle pas des phénomènes de redondance qui sont déjà comme ses propres calques ? Une multiplicité n’a-t-elle pas ses strates où s’enracinent des unifications et totalisations, des massifications, des mécanismes mimétiques, des prises de pouvoir signifiantes, des attributions subjectives ? Même les lignes de fuite ne vont-elles pas reproduire, à la faveur de leur divergence éventuelle, les formations qu’elles avaient pour fonction de défaire ou de tourner ? Mais l’inverse est vrai aussi, c’est une question de méthode : il faut toujours reporter le calque sur la carte. Et cette opération n’est pas du tout symétrique de la précédente. Car en toute rigueur il n’est pas exact qu’un calque reproduise la carte. Il est plutôt comme une photo, une radio qui commencerait par élire ou isoler ce qu’il a l’intention de reproduire, à l’aide de moyens artificiels, à l’aide de colorants ou d’autres procédés de contrainte. C’est toujours l’imitant qui crée son modèle, et l’attire. Le calque a déjà traduit la carte en image, il a déjà transformé le rhizome en racines et radicelles. Il a organisé, stabilisé, neutralisé les multiplicités suivant des axes de signifiance et de subjectivation qui sont les siens. Il a généré, structuralisé le rhizome, et le calque ne reproduit déjà que lui-même quand il croit reproduire autre chose. C’est pourquoi il est si dangereux. Il injecte des redondances, et les propage. Ce que le calque reproduit de la carte ou du rhizome, c’en sont seulement les impasses, les blocages, les germes de pivot ou les points de structuration. Voyez la psychanalyse et la linguistique : l’une n’a jamais tiré que des calques ou des photos de l’inconscient, l’autre, des calques ou des photos du langage, avec toutes les trahisons que ça suppose (pas étonnant que la psychanalyse ait accroché son sort à celui de la linguistique). Voyez ce qui se passait déjà pour le petit Hans, en pure psychanalyse d’enfant : on n’a pas cessé de lui CASSER SON RHIZOME, de lui TACHER SA CARTE, de la lui remettre à l’endroit, de lui bloquer toute issue, jusqu’à ce qu’il désire sa propre honte et sa culpabilité, jusqu’à ce qu’on enracine en lui la honte et la culpabilité, PHOBIE (on lui barre le rhizome de l’immeuble, puis celui de la rue, on 1’enracine dans le lit des parents, on le radicelle sur son propre corps, on le bloque sur le professeur Freud). Freud tient compte explicitement de la cartographie du petit Hans, mais toujours et seulement pour la rabattre sur une photo de famille. Et voyez ce que fait Mélanie Klein avec les cartes géopolitiques du petit Richard : elle en tire des photos, elle en fait des calques, prenez la pose ou suivez l’axe, stade génétique ou destin structural, on cassera votre rhizome. On vous laissera vivre et parler, à condition de vous boucher toute issue. Quand un rhizome est bouché, arbrifié, c’est fini, plus rien ne passe du désir ; car c’est toujours par rhizome que le désir se meut et produit. Chaque fois que le désir suit un arbre, ont lieu des retombées internes qui le font choir et le conduisent à la mort ; mais le rhizome opère sur le désir par poussées extérieures et productrices.
C’est pourquoi il est si important de tenter l’autre opération, inverse mais non symétrique. Rebrancher les calques sur la carte, rapporter les racines ou les arbres à un rhizome. Étudier l’inconscient, dans le cas du petit Hans, ce serait montrer comment il tente de constituer un rhizome, avec la maison familiale, mais aussi avec la ligne de fuite de l’immeuble, de la rue, etc. ; comment ces lignes se trouvent barrées, l’enfant se faisant enraciner dans la famille, photographier sous le père, décalquer sur le lit maternel ; puis comment l’intervention du professeur Freud assure une prise de pouvoir du signifiant comme une subjectivation des affects ; comment l’enfant ne peut plus fuir que sous forme d’un devenir-animal appréhendé comme honteux et coupable (le devenir-cheval du petit Hans, véritable option politique). Mais toujours il faudrait re-situer les impasses sur la carte, et par là les ouvrir sur des lignes de fuite possibles. Il en serait de même pour une carte de groupe : montrer à quel point du rhizome se forment des phénomènes de massification, de bureaucratie, de leadership, de fascisation, etc., quelles lignes subsistent pourtant, même souterraines, continuant à faire obscurément rhizome. La méthode Deligny : faire la carte des gestes et des mouvements d’un enfant autiste, combiner plusieurs cartes pour le même enfant, pour plusieurs enfants 9… S’il est vrai que la carte ou le rhizome ont essentiellement des entrées multiples, on considérera même qu’on peut y entrer par le chemin des calques ou la voie des arbres-racines, compte tenu des précautions nécessaires (là encore on renoncera à un dualisme manichéen). Par exemple, on sera souvent forcé de tourner dans des impasses, de passer par des pouvoirs signifiants et des affections subjectives, de prendre appui sur des formations oedipiennes, paranoïaques ou pires encore, comme sur des territorialités durcies qui rendent possibles d’autres opérations transformationnelles. Il se peut même que la psychanalyse serve, oh malgré elle, de point d’appui. Dans d’autres cas au contraire, on s’appuiera directement sur une ligne de fuite permettant de faire éclater les strates, de rompre les racines et d’opérer les connexions nouvelles. Il y a donc des agencement très différents cartes-calques, rhizomes-racines, avec des coefficients de déterritorialisation variables. Il existe des structures d’arbre ou de racines dans les rhizomes, mais inversement une branche d’arbre ou une division de racine peuvent se mettre à bourgeonner en rhizome. Le repérage ne dépend pas ici d’analyses théoriques impliquant des universaux, mais d’une pragmatique qui compose les multiplicités ou les ensembles d’intensités. Au coeur d’un arbre, au creux d’une racine ou à l’aisselle d’une branche, un nouveau rhizome peut se former. Ou bien c’est un élément microscopique de l’arbre-racine, une radicelle, qui amorce la production du rhizome. La comptabilité, la bureaucratie procèdent par calques ; elles peuvent pourtant se mettre à bourgeonner, à lancer des tiges de rhizome, comme dans un roman de Kafka. Un trait intensif se met à travailler pour son compte, une perception hallucinatoire, une synesthésie, une mutation perverse, un jeu d’images se détachent, et l’hégémonie du signifiant se trouve remise en question. Des sémiotiques gestuelles, mimiques, ludiques, etc., reprennent leur liberté chez l’enfant, et se dégagent du «calque» , c’est-à-dire de la compétence dominante de la langue de l’instituteur -un événement microscopique bouleverse l’équilibre du pouvoir local. Ainsi les arbres génératifs, construits sur le modèle syntagmatique de Chomsky, pourraient s’ouvrir en tout sens, faire rhizome à leur tour10. Être rhizomorphe, c’est produire des tiges et filaments qui ont l’air de racines, ou mieux encore se connectent avec elles en pénétrant dans le tronc, quitte à les faire servir à de nouveaux usages étranges. Nous sommes fatigués de l’arbre. Nous ne devons plus croire aux arbres, aux racines ni aux radicelles, nous en avons trop souffert. Toute la culture arborescente est fondée sur eux , de la biologie à la linguistique. Au contraire, rien n’est beau, rien n’est amoureux, rien n’est politique, sauf les tiges souterraines et les racines aériennes, l’adventice et le rhizome. Amsterdam, ville pas du tout enracinée, ville-rhizome avec ses canaux-tiges, où l’utilité se connecte à la plus grande folie, dans son rapport avec une machine de guerre commerciale.
La pensée n’est pas arborescente, et le cerveau n’est pas une matière enracinée ni ramifiée. Ce qu’on appelle à tort «dendrites» n’assurent pas une connexion des neurones dans un tissu continu. La discontinuité des cellules, le rôle des axones, le fonctionnement des synapses, l’existence de micro-fentes synoptiques, le saut de chaque message par-dessus ces fentes, font du cerveau une multiplicité qui baigne, dans son plan de consistance ou dans sa glie, tout un système probabiliste incertain, uncertain nervous system. Beaucoup de gens ont un arbre planté dans la tête, mais le cerveau lui-même est une herbe beaucoup plus qu’un arbre. «L’axone et la dendrite s’enroulent l’un autour de l’autre comme le liseron autour de la ronce, avec une synapse à chaque épine 11.» C’est comme pour la mémoire… Les neurologues, les psychophysiologues, distinguent une mémoire longue et une mémoire courte (de l’ordre d’une minute). Or la différence n’est pas seulement quantitative : la mémoire courte est du type rhizome, diagramme, tandis que la longue est arborescente et centralisée (empreinte, engramme, calque ou photo). La mémoire courte n’est nullement soumise à une loi de contiguïté ou d’immédiateté à son objet, elle peut être à distance, venir ou revenir longtemps après, mais toujours dans des conditions de discontinuité, de rupture et de multiplicité. Bien plus, les deux mémoires ne se distinguent pas comme deux modes temporels d’appréhension de la même chose ; ce n’est pas la même chose, ce n’est pas le même souvenir, ce n’est pas non plus la même idée qu’elles saisissent toutes deux. Splendeur d’une Idée courte : on écrit avec la mémoire courte, donc avec des idées courtes, même si l’on lit et relit avec la longue mémoire des longs concepts. La mémoire courte comprend l’oubli comme processus ; elle ne se confond pas avec l’instant, mais avec le rhizome collectif, temporel et nerveux. La mémoire longue (famille, race, société ou civilisation) décalque et traduit, mais ce qu’elle traduit continue d’agir en elle, à distance, à contretemps, «intempestivement» , non pas instantanément.
L’arbre ou la racine inspirent une triste image de la pensée qui ne cesse d’imiter le multiple à partir d’une unité supérieure, de centre ou de segment. En effet, si l’on considère l’ensemble branches-racines, le tronc joue le rôle de segment opposé pour l’un des sous-ensembles parcourus de bas en haut : un tel segment sera un « dipôle de liaison », par différence avec les « dipôles-unités » que forment les rayons émanant d’un seul centre 12. Mais les liaisons peuvent elles-mêmes proliférer comme dans le système radicelle, on ne sort jamais de l’Un-Deux, et des multiplicités seulement feintes. Les régénérations, les reproductions, les retours, les hydres et les méduses ne nous en font pas plus sortir. Les systèmes arborescents sont des systèmes hiérarchiques qui comportent des centres de signifiance et de subjectivation, des automates centraux comme des mémoires organisées. C’est que les modèles correspondants sont tels qu’un élément n’y reçoit ses informations que d’une unité supérieure, et une affectation subjective, de liaisons préétablies. On le voit bien dans les problèmes actuels d’informatique et de machines électroniques, qui conservent encore la plus vieille pensée dans la mesure où ils confèrent le pouvoir à une mémoire ou à un organe central. Dans un bel article qui dénonce « l’imagerie des arborescences de commandement » (systèmes centrés ou structures hiérarchiques), Pierre Rosenstiehl et Jean Petitot remarquent :« Admettre le primat des structures hiérarchiques revient à privilégier les structures arborescentes. (…) La forme arborescente admet une explication topologique.(…) Dans un système hiérarchique, un individu n’admet qu’un seul voisin actif, son supérieur hiérarchique.(…) Les canaux de transmission sont préétablis : l’arborescence préexiste à l’individu qui s’y intègre à une place précise » (signifiance et subjectivation). Les auteurs signalent à ce propos que, même lorsque l’on croit atteindre à une multiplicité, il se peut que cette multiplicité soit fausse -ce que nous appelons type radicelle -parce que sa présentation ou son énoncé d’apparence non hiérarchique n’admettent en fait qu’une solution totalement hiérarchique : ainsi le fameux théorème de l’amitié, « si dans une société deux individus quelconques ont exactement un ami commun, alors il existe un individu ami de tous les autres » (comme disent Rosenstiehl et Petitot, qui est l’ami commun ? « l’ami universel de cette société de couples, maître, confesseur, médecin ? autant d’idées qui sont étrangement éloignées des axiomes de départ », l’ami du genre humain ? ou bien lephilosophe tel qu’il apparaît dans la pensée classique, même si c’est l’unité avortée qui ne vaut que par sa propre absence ou sa subjectivité, disant je ne sais rien, je ne suis rien ?). Les auteurs parlent à cet égard de théorèmes de dictature, Tel est bien le principe des arbres-racines, ou l’issue, la solution des radicelles, la structure du Pourvoir 13.
A ces systèmes centrés, les auteurs opposent des systèmes acentrés, réseaux d’automates finis, où la communication se fait d’un voisin à un voisin quelconque, où les tiges ou canaux ne préexistent pas, où les individus sont tous interchangeables, se définissent seulement par un état à tel moment, de telle façon que les opérations locales se coordonnent et que le résultat final global se synchronise indépendamment d’une instance centrale. Une transduction d’états intensifs remplace la topologie, et « le graphe réglant la circulation d’information est en quelque sorte l’opposé du graphe hiérarchique… Le graphe n’a aucune raison d’être un arbre » (nous appelions carte un tel graphe). Problème de la machine de guerre, ou du Firing Squad : un général est-il nécessaire pour que n individus arrivent en même temps à l’état feu ? La solution sans Général est trouvée pour une multiplicité acentrée comportant un nombre fini d’états et des signaux de vitesse correspondante, du point de vue d’un rhizome de guerre ou d’une logique de la guérilla, sans calque, sans copie d’un ordre central. On démontre même qu’une telle multiplicité, agencement ou société machiniques, rejette comme « intrus asocial » tout automate centralisateur, unificateur 14 . N, dès lors, est bien toujours n -1. Rosenstiehl et Petitot insistent sur ceci, que l’opposition centre-acentré vaut moins par les choses qu’elle désigne que par les modes de calcul qu’elle applique aux choses. Des arbres peuvent correspondre au rhizome, ou inversement bourgeonner en rhizome. Et c’est vrai généralement qu’une même chose admet les deux modes de calcul ou les deux types de régulation, mais non pas sans changer singulièrement d’état dans un cas et dans l’autre. Soit par exemple encore la psychanalyse : non seulement dans sa théorie, mais dans sa pratique de calcul et de traitement, elle soumet l’inconscient à des structures arborescentes, à des graphes hiérarchiques, à des mémoires récapitulatrices, à des organes centraux, phallus, arbre-phallus. La psychanalyse ne peut pas changer de méthode à cet égard : sur une conception dictatoriale de l’inconscient, elle fonde son propre pouvoir dictatorial. La marge de manœuvre de la psychanalyse est ainsi très bornée. Il y a toujours un général, un chef, dans la psychanalyse comme dans son objet (général Freud). Au contraire, en traitant l’inconscient comme un système acentré, c’est-à-dire comme un réseau machinique d’automates finis (rhizome), la schizoanalyse atteint à un tout autre état de l’inconscient. Les mêmes remarques valent en linguistique ; Rosenstiehl et Petitot considèrent à juste titre la possibilité d’une « organisation acentrée d’une société de mots ». Pour les énoncés comme pour les désirs, la question n’est jamais de réduire l’inconscient, de l’interpréter ni de le faire signifier suivant un arbre. La question, c’est de produire de l’inconscient, et, avec lui, de nouveaux énoncés, d’autres désirs : le rhizome est cette production d’inconscient même.
C’est curieux, comme l’arbre a dominé la réalité occidentale et toute la pensée occidentale, de la botanique à la biologie, l’anatomie, mais aussi la gnoséologie, la théologie, l’ontologie, toute la philosophie… : le fondement-racine, Grund, roots et fundations. L’Occident a un rapport privilégié avec la forêt, et avec le déboisement ; les champs conquis sur la forêt sont peuplés de plantes à graines, objet d’une culture de lignées, portant sur l’espèce et de type arborescent ; l’élevage à son tour, déployé sur jachère, sélectionne des lignées qui forment toute une arborescence animale. L’Orient présente une autre figure : le rapport avec la steppe et le jardin (dans d’autres cas, le désert et l’oasis), plutôt qu’avec la forêt et le champ ; une culture de tubercules qui procède par fragmentation de l’individu ; une mise à l’écart, une mise entre parenthèses de l’élevage confiné dans des espaces clos, ou repoussé dans la steppe des nomades. Occident, agriculture d’une lignée choisie avec beaucoup d’individus variables ; Orient, horticulture d’un petit nombre d’individus renvoyant à une grande gamme de « clones ». N’y a-t-il pas en Orient, notamment en Océanie, comme un modèle rhizomatique qui s’oppose à tous égards au modèle occidental de l’arbre ? Haudricourt y voit même une raison de l’opposition entre les morales ou les philosophies de la transcendance, chères à l’Occident, celles de l’immanence en Orient : le Dieu qui sème et qui fauche, par opposition au Dieu qui pique et déterre (la piqûre contre la semaille 15). Transcendance, maladie proprement européenne. Et ce n’est pas la même musique, la terre n’y a pas la même musique. Et ce n’est pas du tout la même sexualité : les plantes à graines, même réunissant les deux sexes, soumettent la sexualité au modèle de la reproduction ; le rhizome au contraire est une libération de la sexualité non seulement par rapport à la reproduction, mais par rapport à la génitalité. Chez nous, l’arbre s’est planté dans les corps, il a durci et stratifié même les sexes. Nous avons perdu le rhizome ou l’herbe. Henry Miller : « La Chine est la mauvaise herbe dans le carré de choux de l’humanité. (… ) La mauvaise herbe est la Némésis des efforts humains. De toutes les existences imaginaires que nous prêtons aux plantes, aux bêtes et aux étoiles, c’est peut-être la mauvaise herbe qui mène la vie la plus sage. Il est vrai que l’herbe ne produit ni fleurs, ni porte-avions, ni Sermons sur la montagne. Mais en fin de compte c’est toujours l’herbe qui a le dernier mot. En fin de compte tout retourne à l’état de Chine. C’est ce que les historiens appellent communément les ténèbres du Moyen Age. Pas d’autre issue que l’herbe. (… ) L’herbe n’existe qu’entre les grands espaces non cultivés. Elle comble les vides. Elle pousse entre, et parmi les autres choses. La fleur est belle, le chou est utile, le pavot rend fou. Mais l’herbe est débordement, c’est une leçon de morale 16.» -De quelle Chine parle Miller, de l’ancienne, de l’actuelle, d’une imaginaire, ou bien d’une autre encore qui ferait partie d’une carte mouvante ?
Il faudrait faire une place à part à l’Amérique. Bien sûr, elle n’est pas exempte de la domination des arbres et d’une recherche des racines. On le voit jusque dans la littérature, dans la quête d’une identité nationale, et même d’une ascendance ou généalogie européennes (Kérouac repart à la recherche de ses ancêtres). Reste que tout ce qui s’est passé d’important, tout ce qui se passe d’important procède par rhizome américain : beatnik, underground, souterrains, bandes et gangs, poussées latérales successives en connexion immédiate avec un dehors. Différence du livre américain avec le livre européen, même quand l’américain se met à la poursuite des arbres. Différence dans la conception du livre. « Feuilles d’herbe ». Et ce ne sont pas en Amérique les mêmes directions : c’est à l’Est que se font la recherche arborescente et le retour au vieux monde. Mais l’Ouest rhizomatique, avec ses Indiens sans ascendance, sa limite toujours fuyante, ses frontières mouvantes et déplacées. Toute une « carte » américaine à l’Ouest, où même les arbres font rhizome. L’Amérique a inversé les directions : elle a mis son orient à l’ouest, comme si la terre était devenue ronde précisément en Amérique ; son Ouest est la frange même de l’Est 17. (Ce n’est pas l’Inde, comme croyait Haudricourt, qui fait l’intermédiaire entre l’Occident et l’Orient, c’est l’Amérique qui fait pivot et mécanisme d’inversion). La chanteuse américaine Patti Smith chante la bible du dentiste américain : ne cherchez pas de racine, suivez le canal…
N’y aurait-il pas aussi deux bureaucraties, et même trois (et plus encore) ? La bureaucratie occidentale : son origine agraire, cadastrale, les racines et les champs, les arbres et leur rôle de frontières, le grand recensement de Guillaume le Conquérant, la féodalité, la politique des rois de France, asseoir l’État sur la propriété, négocier les terres par la guerre, les procès et les mariages. Les rois de France choisissent le lys, parce que c’est une plante à racines profondes accrochant les talus. Est-ce la même chose en Orient ? Bien sûr, c’est trop facile de présenter un Orient de rhizome et d’immanence ; mais l’État n’y agit pas d’après un schéma d’arborescence correspondant à des classes préétablies, arbrifiées et enracinées ; c’est une bureaucratie de canaux, par exemple le fameux pouvoir hydraulique à « propriété faible », où l’État engendre des classes canalisantes et canalisées (cf. ce qui n’a jamais été réfuté dans les thèses de Wittfogel). Le despote y agit comme fleuve, et non pas comme une source qui serait encore un point, point-arbre ou racine ; il épouse les eaux plus qu’il ne s’assied sous l’arbre ; et l’arbre de Bouddha devient lui-même rhizome ; le fleuve de Mao et l’arbre de Louis. Là encore l’Amérique n’a-t-elle pas procédé comme intermédiaire? Car elle agit à la fois par exterminations, liquidations internes (non seulement les Indiens, mais les fermiers, etc.) et par poussées successives externes d’immigrations. Le flux du capital y produit un immense canal, une quantification de pouvoir, avec des « quanta » immédiats où chacun jouit à sa façon dans le passage du flux-argent (d’où le mythe-réalité du pauvre qui devient milliardaire pour redevenir pauvre) : tout se réunit ainsi dans l’Amérique, à la fois arbre et canal, racine et rhizome. Il n’y a pas de capitalisme universel et en soi, le capitalisme est au croisement de toutes sortes de formations, il est toujours par nature néo-capitalisme, il invente pour le pire, sa face d’orient et sa face d’occident, et son remaniement des deux.
Nous sommes en même temps sur une mauvaise voie, avec toutes ces distributions géographiques. Une impasse, tant mieux. S’il s’agit de montrer que les rhizomes ont aussi leur propre despotisme, leur propre hiérarchie, plus durs encore, très bien, car il n’y a pas de dualisme, pas de dualisme ontologique ici et là, pas de dualisme axiologique du bon et du mauvais, pas de mélange ou de synthèse américaine. Il y a des nœuds d’arborescence dans les rhizomes, des poussées rhizomatiques dans les racines. Bien plus, il y a des formations despotiques, d’immanence et de canalisation, propres aux rhizomes. Il y a des déformations anarchiques dans le système transcendant des arbres, racines aériennes et tiges souterraines. Ce qui compte, c’est que l’arbre-racine et le rhizome-canal ne s’opposent pas comme deux modèles : l’un agit comme modèle et comme calque transcendants, même s’il engendre ses propres fuites ; l’autre agit comme processus immanent qui renverse le modèle et ébauche une carte, même s’il constitue ses propres hiérarchies, même s’il suscite un canal despotique. Il ne s’agit pas de tel ou tel endroit sur la terre, ni de tel moment dans l’histoire, encore moins de telle ou telle catégorie dans l’esprit. Il s’agit du modèle, qui ne cesse pas de s’ériger et de s’enfoncer, et du processus qui ne cesse pas de s’allonger, de se rompre et reprendre. Autre ou nouveau dualisme, non. Problème de l’écriture : il faut absolument des expressions anexactes pour désigner quelque chose exactement. Et pas du tout parce qu’il faudrait passer par là, et pas du tout parce qu’on ne pourrait procéder que par approximations : l’anexactitude n’est nullement une approximation, c’est au contraire le passage exact de ce qui se fait. Nous n’invoquons un dualisme que pour en récuser un autre. Nous ne nous servons d’un dualisme de modèles que pour atteindre à un processus qui récuserait tout modèle, Il faut à chaque fois des correcteurs cérébraux qui défont les dualismes que nous n’avons pas voulu faire, par lesquels nous passons. Arriver à la formule magique que nous cherchons tous PLURALISME = MONISME, en passant par tous les dualismes qui sont l’ennemi, mais l’ennemi tout à fait nécessaire, le meuble que nous ne cessons pas de déplacer.
Résumons les caractères principaux d’un rhizome : à la différence des arbres ou de leurs racines, le rhizome connecte un point quelconque avec un autre point quelconque, et chacun de ses traits ne renvoie pas nécessairement à des traits de même nature, il met en jeu des régimes de signes très différents et même des états de non-signes. Le rhizome ne se laisse ramener ni à l’Un ni au Multiple. Il n’est pas l’Un qui devient deux, ni même qui deviendrait directement trois, quatre ou cinq, etc. Il n’est pas un multiple qui dérive de l’Un, ni auquel l’Un s’ajouterait (n + 1). Il n’est pas fait d’unités, mais de dimensions, ou plutôt de directions mouvantes, Il n’a pas de commencement ni de fin, mais toujours un milieu, par lequel il pousse et déborde, Il constitue des multiplicités linéaires à ndimensions, sans sujet ni objet, étalables sur un plan de consistance, et dont l’Un est toujours soustrait (n -1). Une telle multiplicité ne varie pas ses dimensions sans changer de nature en elle-même et se métamorphoser. A l’opposé d’une structure qui se définit par un ensemble de points et de positions, de rapports binaires entre ces points et de relations biunivoque entre ces positions, le rhizome n’est fait que de lignes : lignes de segmentarité, de stratification, comme dimensions, mais aussi ligne de fuite ou de déterritorialisation comme dimension maximale d’après laquelle, en la suivant, la multiplicité se métamorphose en changeant de nature. On ne confondra pas de telles lignes, ou linéaments, avec les lignées de type arborescent, qui sont seulement des liaisons localisables entre points et positions. A l’opposé de l’arbre, le rhizome n’est pas objet de reproduction : ni reproduction externe comme l’arbre-image, ni reproduction interne comme la structure-arbre. Le rhizome est une antigénéalogie. C’est une mémoire courte, ou une antimémoire. Le rhizome procède par variation, expansion, conquête, capture, piqûre. A l’opposé du graphisme, du dessin ou de la photo, à l’opposé des calques, le rhizome se rapporte à une carte qui doit être produite, construite, toujours démontable, connectable, renversable, modifiable, à entrées et sorties multiples, avec ses lignes de fuite. Ce sont les calques qu’il faut reporter sur les cartes et non l’inverse. Contre les systèmes centrés (même polycentrés), à communication hiérarchique et liaisons préétablies, le rhizome est un système acentré, non hiérarchique et non signifiant, sans Général, sans mémoire organisatrice ou automate central, uniquement défini par une circulation d’états. Ce qui est en question dans le rhizome, c’est un rapport avec la sexualité, mais aussi avec l’animal, avec le végétal, avec le monde, avec la politique, avec le livre, avec les choses de la nature et de l’artifice, tout différent du rapport arborescent : toutes sortes de « devenirs ».
Un plateau est toujours au milieu, ni début ni fin. Un rhizome est fait de plateaux, Gregory Bateson se sert du mot « plateau » pour désigner quelque chose de très spécial : une région continue d’intensités, vibrant sur elle-même, et qui se développe en évitant toute orientation sur un point culminant ou vers une fin extérieure. Bateson cite en exemple la culture balinaise, où des jeux sexuels mère-enfant, ou bien des querelles entre hommes, passent par cette bizarre stabilisation intensive. « Une espèce de plateau continu d’intensité est substitué à l’orgasme », à la guerre ou au point culminant. C’est un trait fâcheux de l’esprit occidental, de rapporter les expressions et les actions à des fins extérieures ou transcendantes, au lieu de les estimer sur un plan d’immanence d’après leur valeur en soi 18. Par exemple, en tant qu’un livre est fait de chapitres, il a ses points culminants, ses points de terminaison.
Que se passe-t-il au contraire pour un livre fait de plateaux, communiquant les uns avec les autres à travers des micro-fentes, comme pour un cerveau ? Nous appelons « plateau » toute multiplicité connectable avec d’autres par tiges souterraines superficielles, de manière à former et étendre un rhizome.Nous écrivons ce livre comme un rhizome. Nous l’avons composé de plateaux. Nous lui avons donné une forme circulaire, mais c’était pour rire. Chaque matin nous nous levions, et chacun de nous se demandait quels plateaux il allait prendre, écrivant cinq lignes, ici, dix lignes ailleurs. Nous avons eu des expériences hallucinatoires, nous avons vu des lignes, comme des colonnes de petites fourmis, quitter un plateau pour en gagner un autre. Nous avons fait des cercles de convergence. Chaque plateau peut être lu à n’importe quelle place, et mis en rapport avec n’importe quel autre. Pour le multiple, il faut une méthode qui le fasse effectivement ; nulle astuce typographique, nulle habileté lexicale, mélange ou création de mots, nulle audace syntaxique ne peuvent la remplacer. Celles-ci en effet, le plus souvent, ne sont que des procédés mimétiques destinés à disséminer ou disloquer une unité maintenue dans une autre dimension pour un livre-image. Technonarcissisme. Les créations typographiques, lexicales ou syntaxiques ne sont nécessaires que si elles cessent d’appartenir à la forme d’expression d’une unité cachée, pour devenir elles-mêmes une des dimensions de la multiplicité considérée ; nous connaissons de rares réussites en ce genre 19. Nous n’avons pas su le faire pour notre compte. Nous avons seulement employé des mots qui, à leur tour, fonctionnaient pour nous comme des plateaux. RHIZOMATIQUE = SCHIZO-ANALYSE = STRATO-ANALYSE = PRAGMATIQUE = MICRO-POLlTIQUE-. Ces mots sont des concepts, mais les concepts sont des lignes, c’est-à-dire des systèmes de nombres attachés à telle ou telle dimension des multiplicités (strates, chaînes moléculaires, lignes de fuite ou de rupture, cercles de convergence, etc.). En aucun cas nous ne prétendons au titre d’une science. Nous ne connaissons pas plus de scientificité que d’idéologie, mais seulement des agencements. Et il n’y a que des agencements machiniques de désir, comme des agencements collectifs d’énonciation. Pas de signifiance, et pas de subjectivation : écrire à n (toute énonciation individuée reste prisonnière des significations dominantes, tout désir signifiant renvoie à des sujets dominés). Un agencement dans sa multiplicité travaille à la fois forcément sur des flux sémiotiques, des flux matériels et des flux sociaux (indépendamment de la reprise qui peut en être faite dans un corpus théorique ou scientifique). On n’a plus une tripartition entre un champ de réalité, le monde, un champ de représentation, le livre, et un champ de subjectivité, l’auteur. Mais un agencement met en connexion certaines multiplicités prises dans chacun de ces ordres, si bien qu’un livre n’a pas sa suite dans le livre suivant, ni son objet dans le monde, ni son sujet dans un ou plusieurs auteurs. Bref, il nous semble que l’écriture ne se fera jamais assez au nom d’un dehors. Le dehors n’a pas d’image, ni de signification, ni de subjectivité. Le livre, agencement avec le dehors, contre le livre-image du monde. Un livre-rhizome, et non plus dichotome, pivotant ou fasciculé. Ne jamais faire racine, ni en planter, bien que ce soit difficile de ne pas retomber dans ces vieux procédés. « Les choses qui me viennent à l’esprit se présentent à moi non par leur racine, mais par un point quelconque situé vers leur milieu. Essayez donc de les retenir, essayez donc de retenir un brin d’herbe qui ne commence à croître qu’au milieu de la tige, et de vous tenir à lui 20.» Pourquoi est-ce si difficile ? C’est déjà une question de sémiotique perceptive. Pas facile de percevoir les choses par le milieu, et non de haut en bas ou inversement, de gauche à droite ou inversement : essayez et vous verrez que tout change. Ce n’est pas facile de voir l’herbe dans les choses et les mots (Nietzsche disait de la même façon qu’un aphorisme devait être « ruminé », et jamais un plateau n’est séparable des vaches qui le peuplent, et qui sont aussi les nuages du ciel).
On écrit l’histoire, mais on l’a toujours écrite du point de vue des sédentaires, et au nom d’un appareil unitaire d’État, au moins possible même quand on parlait de nomades. Ce qui manque, c’est une Nomadologie, le contraire d’une histoire. Pourtant là aussi de rares et grandes réussites, par exemple à propos des croisades d’enfants : le livre de Marcel Schwob qui multiplie les récits comme autant de plateaux aux dimensions variables. Le livre d’Andrzejewski, Les portes du Paradis, fait d’une seule phrase ininterrompue, flux d’enfants, flux de marche avec piétinement, étirement, précipitation, flux sémiotique de toutes les confessions d’enfants qui viennent se déclarer au vieux moine à la tête du cortège, flux de désir et de sexualité, chacun parti par amour, et plus ou moins directement mené par le noir désir posthume et pédérastique du comte de Vendôme, avec cercles de convergence -l’important n’est pas que les flux fassent « Un ou multiple », nous n’en sommes plus là : il y a un agencement collectif d’énonciation, un agencement machinique de désir, l’un dans l’autre, et branchés sur un prodigieux dehors qui fait multiplicité de toute manière. Et puis, plus récemment, le livre d’Armand Farrachi sur la IVe croisade, La dislocation, où les phrases s’écartent et se dispersent, ou bien se bousculent et coexistent, et les lettres, la typographie se met à danser, à mesure que la croisade délire 21.Voilà des modèles d’écriture nomade et rhizomatique. L’écriture épouse une machine de guerre et des lignes de fuite, elle abandonne les strates, les segmentarités, la sédentarité, l’appareil d’État. Mais pourquoi faut-il encore un modèle ? Le livre n’est-il pas encore une « image » des croisades ? N’y a-t-il pas encore une unité gardée, comme unité pivotante dans le cas de Schwob, comme unité avortée dans le cas de Farrachi, comme unité du Comte mortuaire dans le cas le plus beau des Portes du Paradis ? Faut-il un nomadisme plus profond que celui des croisades, celui des vrais nomades, ou bien le nomadisme de ceux qui ne bougent même plus et qui n’imitent plus rien ? Ils agencent seulement. Comment le livre trouvera-t-il un dehors suffisant avec lequel il puisse agencer dans l’hétérogène, plutôt qu’un monde à reproduire ? Culturel, le livre est forcément un calque : calque de lui-même déjà, calque du livre précédent du même auteur, calque d’autres livres quelles qu’en soient les différences, décalque interminable de concepts et de mots en place, décalcage du monde présent, passé ou à venir. Mais le livre anticulturel peut encore être traversé d’une culture trop lourde : il en fera pourtant un usage actif d’oubli et non de mémoire, de sous-développement et non pas de progrès à développer, de nomadisme et pas de sédentarité, de carte et non pas de calque. RHIZOMATIQUE = POP’ANALYSE, même si le peuple a autre chose à faire que de le lire, même si les blocs de culture universitaire ou de pseudoscientificité restent trop pénibles ou pesants. Car la science serait complètement folle si on la laissait faire, voyez les mathématiques, elles ne sont pas une science, mais un prodigieux argot, et nomadique. Même et surtout dans le domaine théorique, n’importe quel échafaudage précaire et pragmatique vaut mieux que le décalque des concepts, avec leurs coupures et leurs progrès qui ne changent rien. L’imperceptible rupture, plutôt que la coupure signifiante. Les nomades ont inventé une machine de guerre, contre l’appareil d’État. Jamais l’histoire n’a compris le nomadisme, jamais le livre n’a compris le dehors. Au cours d’une longue histoire, l’État a été le modèle du livre et de la pensée : le logos, le philosophe-roi, la transcendance de l’idée, l’intériorité du concept, la république des esprits, le tribunal de la raison, les fonctionnaires de la pensée, l’homme législateur et sujet. Prétention de l’État à être l’image intériorisée d’un ordre du monde, et à enraciner l’homme. Mais le rapport d’une machine de guerre avec le dehors, ce n’est pas un autre « modèle », c’est un agencement qui fait que la pensée devient elle-même nomade, le livre une pièce pour toutes les machines mobiles, une tige pour un rhizome (Kleist et Kafka contre Goethe).
Écrire à n, n-1, écrire par slogans : Faites rhizome et pas racine, ne plantez jamais ! Ne semez pas, piquez ! Ne soyez pas un ni multiple, soyez des multiplicités ! Faites la ligne et jamais le point ! La vitesse transforme le point en ligne 22 ! Soyez rapide, même sur place ! Ligne de chance, ligne de hanche, ligne de fuite.
Ne suscitez pas un Général en vous ! Pas des idées justes, juste une idée (Godard). Ayez des idées courtes. Faites des cartes, et pas des photos ni des dessins. Soyez la Panthère rose, et que vos amours encore soient comme la guêpe et l’orchidée, le chat et le babouin. On dit du vieil homme-fleuve
He don’t plant tatos Don’t plant cotton Them that plants them is soon forgotten But old man river he just keeps rollin along.
Un rhizome ne commence et n’aboutit pas, il est toujours au milieu, entre les choses, inter-être, intermezzo.L’arbre est filiation, mais le rhizome est alliance, uniquement d’alliance. L’arbre impose le verbe « être », mais le rhizome a pour tissu la conjonction « et… et… et…». Il y a dans cette conjonction assez de force pour secouer et déraciner le verbe être. Où allez-vous ? d’où partez–vous ? où voulez-vous en venir ? sont des questions bien inutiles. Faire table rase, partir ou repartir à zéro, chercher un commencement, ou un fondement, impliquent une fausse conception du voyage et du mouvement (méthodique, pédagogique, initiatique, symbolique… ). Mais Kleist, Lenz ou Büchner ont une autre manière de voyager comme de se mouvoir, partir au milieu, par le milieu, entrer et sortir, non pas commencer ni finir 23. Plus encore, c’est la littérature américaine, et déjà anglaise, qui ont manifesté ce sens rhizomatique, ont su se mouvoir entre les choses, instaurer une logique du ET, renverser l’ontologie, destituer le fondement, annuler fin et commencement. Ils ont su faire une pragmatique. C’est que le milieu n’est pas du tout une moyenne, c’est au contraire l’endroit où les choses prennent de la vitesse. Entre les choses ne désigne pas une relation localisable qui va de l’une à l’autre et réciproquement, mais une direction perpendiculaire, un mouvement transversal qui les emporte l’une et l’autre, ruisseau sans début ni fin, qui ronge ses deux rives et prend de la vitesse au milieu.
NOTES
1 Cf. Bertil Malmberg, Les nouvelles tendances de la linguistique, P.U.F., (l’exemple du dialecte castillan), pp. 97 sq.
2 Ernst Jünger, Approches drogues et ivresse, Table ronde, p. 304, § 218.
3 Rémy Chauvin, in Entretiens sur la sexualité, Plon, p. 205.
5 François Jacob, La logique du vivant, Gallimard, pp. 312, 333.
6 Carlos Castaneda, L’herbe du diable et la petite fumée, Ed. du Soleil noir, p. 160.
7 Pierre Boulez, Par volonté et par hasard, Ed. du Seuil, p. 14 : « Vous la plantez dans un certain terreau, et tout d’un coup, elle se met à proliférer comme de la mauvaise herbe. » Et passim, sur la prolifération musicale, p. 89 : « une musique qui flotte, où l’écriture elle-même apporte pour l’instrumentiste une impossibilité de garder une coïncidence avec un temps pulsé ».
8 Cf. Mélanie Klein, Psychanalyse d’un enfant, Tchou : le rôle des cartes de guerre dans les activités de Richard.
9 Fernand Deligny, « Voix et voir », Cahiers de l’immuable, Recherches, avril 1975.
10 Cf. Dieter Wunderlich, « Pragmatique, situation d’énonciation et Deixis », in Langages, no 26, juin 1972, pp. 50 sq. : les tentatives de Mac Cawley, de Sadock et de Wunderlich pour introduire des « propriétés pragmatiques »dans les arbres chomskiens.
11Steven Rose, Le cerveau conscient, Ed. du Seuil, p. 97, et, sur la mémoire, pp. 250 sq.12.
12 Cf. Julien Pacotte, Le réseau arborescent, schème primordial de la pensée, Hermann, 1936. Cc livre analyse et développe divers schémas de la forme d’arborescence, qui n’est pas présentée comme un simple formalisme, mais comme « le fondement réel de la pensée formelle ». Il pousse jusqu’au bout la pensée classique. 11 recueille toutes les formes de l’ « Un-Deux », théorie du dipôle. L’ensemble tronc-racines-branches donne lieu au schéma suivant:
Plus récemment, Michel Serres analyse les variétés et séquences d’arbres dans les domaines scientifiques les plus différents : comment l’arbre se forme à partir d’un « réseau »(La traduction, Ed. de Minuit, pp. 27 sq. Feux et signaux de brume, Grasset, pp. 35 sq.)
13 Pierre Rosenstiehl et Jean Petitot, « Automate asocial et systèmes acentrés », in Communications, no 22, 1974. Sur le théorème de l’amitié, cf. H. S. Wilf, The Friendship Theorem in Combinatorial Mathematics, Welsh Academic Press ; et, sur un théorème de même type, dit d’indécision collective, cf. K.J. Arrow, Choix collectif et préférences individuelles, Calmann-Lévy.
16 Henry Miller, Hamlet, Corrêa, pp. 48-49.
20 Kafka, Journal, Grasset, p. 4 .
23 Cf. J.-C. Bailly, La légende dispersée, 10-18 la description du mouvement dans le romantisme allemand, pp. 18 sq.