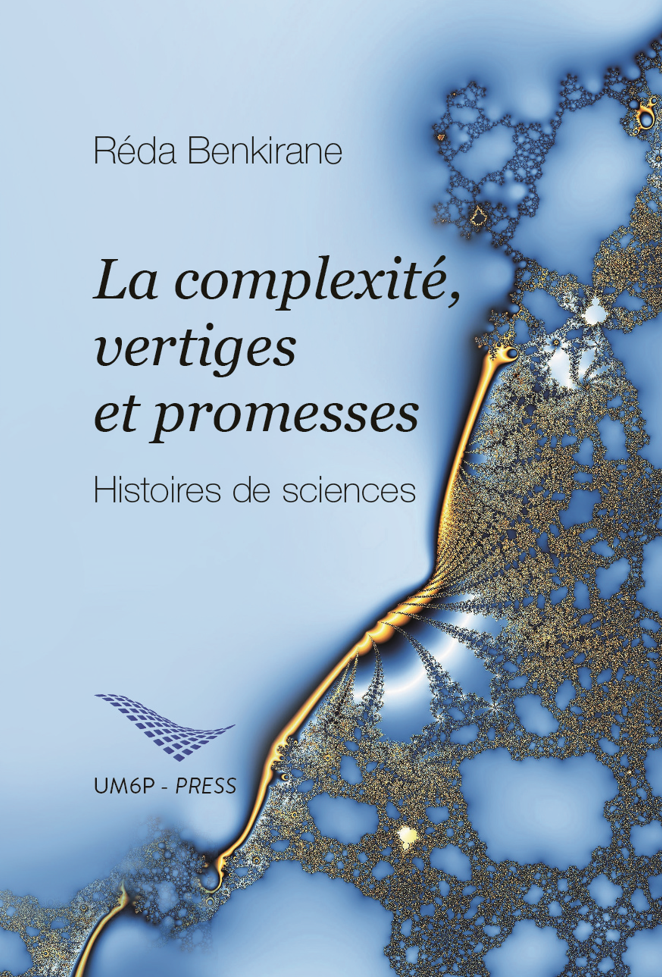L’art de la cyberculture
 [extraits]
[extraits]
L’adéquation entre les formes esthétiques de la cyberculture et ses dispositifs technosociaux
Le genre canonique de la cyberculture est le monde virtuel. N’entendons pas ce
terme au sens étroit de la simulation informatique d’un univers tridimentionnel
exploré par l’intermédiaire d’un casque stéréoscopique et de gants de données.
Appréhendons plutôt le concept plus général d’une réserve numérique de virtualités
sensorielles et informationnelles qui ne s’actualisent que dans l’interaction avec des
êtres humains. Selon les dispositifs, cette actualisation est plus ou moins inventive,
imprévisible, et laisse une part variable aux initiatives de ceux qui s’y plongent. Les
mondes virtuels peuvent éventuellement être enrichis et parcourus collectivement. Ils
deviennent dans ce cas un lieu de rencontre et un médium de communication entre
leurs participants.
L’ingénieur de mondes apparaît alors comme l’artiste majeur du XXIe siècle. Il
pourvoit aux virtualités, architecture les espaces de communication, aménage les
équipements collectifs de la cognition et de la mémoire, structure l’interaction
sensorimotrice avec l’univers des données.
Le World Wide Web, par exemple, est un monde virtuel favorisant l’intelligence
collective. Ses inventeurs Tim Berners Lee et tout ceux qui ont programmé les
interfaces permettant d’y naviguer sont des ingénieurs de mondes. Les
inventeurs de logiciels pour le travail ou l’apprentissage coopératif, les concepteurs
de jeux vidéos, les artistes qui explorent les frontières des dispositifs interactifs ou
des systèmes de télévirtualité sont également des ingénieurs de mondes.
On peut distinguer deux grands types de mondes virtuels :
ceux qui sont limités et éditorialisés, comme les CD-ROM ou les
installations d’artistes « fermées » (off line),
ceux qui sont accessibles par réseau et indéfiniment ouverts à l’interaction, à
la transformation et à la connexion sur d’autres mondes virtuels (on line).
Il n’y a aucune raison d’opposer on line et off line comme on le fait
parfois. Complémentaires, ils s’alimentent et s’inspirent réciproquement.
Les oeuvres off line peuvent offrir de manière commode une projection partielle et
temporaire de l’intelligence et de l’imagination collective qui se déploie dans les
réseaux. Elles peuvent aussi tirer avantage de contraintes techniques plus favorables.
En particulier, elles ne connaissent pas les limitations dues à l’insuffisance des débits
de transmission. Elles travaillent enfin à constituer des isolats originaux ou créatifs
hors du flux continu de la communication.
Symétriquement, les mondes virtuels accessibles en ligne peuvent
s’alimenter de données produites off line et les nourrir en retour. Ce sont
essentiellement des milieux de communication interactive. Le monde virtuel
fonctionne alors comme dépôt de messages, contexte dynamique accessible à tous et
mémoire communautaire collectivement alimentée en temps réel.
Le développement de l’infrastructure technique du cyberespace ouvre la perspective
d’une interconnexion de tous les mondes virtuels. La réunion progressive des textes
numérisés de la planète en un seul immense hypertexte n’est que le prélude d’une
interconnexion plus générale, qui joindra l’ensemble des informations numérisées, et
notamment les films et les environnements tridimensionnels interactifs. Ainsi, le
Réseau donnera accès à un gigantesque métamonde virtuel hétérogène qui accueillera
le pullulement des mondes virtuels particuliers avec leurs liens dynamiques, les
passages qui les connecteront comme autant de puits, de couloirs ou de terriers du
wonderland numérique. Ce métamonde virtuel ou cyberespace deviendra le principal
lieu de communication, de transactions économiques, d’apprentissage et de
divertissement des sociétés humaines. C’est aussi là que l’on goûtera la beauté
déposée dans la mémoire des anciennes cultures, comme celle qui naîtra des formes
propres à la cyberculture. De même que le cinéma n’a pas remplacé le théâtre mais
constitua un genre nouveau avec sa tradition et ses codes originaux, les genres
émergents de la cyberculture comme la musique techno ou les mondes virtuels ne
remplaceront pas les anciens. Ils s’ajouteront au patrimoine de la civilisation tout en
réorganisant l’économie de la communication et le système des arts. Les traits que
nous allons maintenant souligner, comme le déclin de la figure de l’auteur et deCriti
l’archive enregistrée, ne concernent donc pas l’art ou la culture en général mais
seulement les oeuvres qui se rattachent spécifiquement à la cyberculture.
Même , l’oeuvre interactive demande l’implication de ceux qui la goûtent.
L’interactant participe à la structuration du message qu’il reçoit. Autant que celles
des ingénieurs de mondes, les mondes virtuels multiparticipants sont des créations
collectives de leurs explorateurs. Les témoignages artistiques de la cyberculture sont
des oeuvres-flux, des oeuvres-processus, voire des oeuvres-événements qui se
prêtent mal à l’archivage et la conservation. Enfin, dans le cyberespace, chaque
monde virtuel sera potentiellement relié à tous les autres, les enveloppera et sera
contenu par eux suivant une topologie paradoxale enchevêtrant l’intérieur et
l’extérieur. Déjà, beaucoup d’oeuvres de la cyberculture n’ont pas de limites nettes.
Ce sont des « oeuvres ouvertes », non seulement parce qu’elles admettent une
multitude d’interprétations, mais surtout parce qu’elles sont physiquement
accueillantes à l’immersion active d’un explorateur et matériellement enchevêtrées
aux autres oeuvres du Réseau. Le degré de cette ouverture est évidemment variable
selon les cas ; or, plus l’oeuvre exploite les possibilités offertes par l’interaction,
l’interconnexion et les dispositifs de création collective, plus elle est typique de la
cyberculture… et moins il s’agit d’une « oeuvre » au sens classique du terme.
L’oeuvre de la cyberculture atteint une certaine forme d’universalité par présence
ubiquitaire dans le Réseau, par connexion et coprésence aux autres oeuvres, par
ouverture matérielle, et non plus nécessairement par signification partout valable ou
conservée. Or, cette forme d’universalité par contact va de pair avec une tendance à
la détotalisation. En effet, le garant de la totalisation de l’oeuvre, c’est-à-dire de la
clôture de son sens, est l’auteur. Même si la signification de l’oeuvre est réputée
ouverte ou multiple, un auteur doit encore être présupposé si l’on veut interpréter des
intentions, décoder un projet, une expression sociale, voire un inconscient. L’auteur
est la condition de possibilité de tout horizon de sens stable. Or il est devenu banal
de dire que la cyberculture remet fortement en question l’importance et la fonction du
signataire. L’ingénieur de monde ne signe pas une oeuvre finie mais un
environnement par essence inachevé dont il revient aux explorateurs de construire
non seulement le sens variable, multiple, inattendu, mais également l’ordre de lecture
et les formes sensibles. De plus, la métamorphose continue des oeuvres adjacentes et
du milieu virtuel qui supporte et pénètre l’oeuvre, contribue à déposséder de ses
prérogatives de garant du sens un éventuel auteur.
Fort heureusement, talents, capacités, efforts individuels de création sont toujours à
l’ordre du jour. Mais ils peuvent qualifier l’interprète, le « performeur »,
l’explorateur, l’ingénieur de monde, chaque membre de l’équipe de réalisation aussi
bien et peut-être mieux qu’un auteur de moins en moins cernable.
Après l’auteur, la seconde condition de possibilité pour la totalisation ou la clôture
du sens est la fermeture physique jointe à la fixité temporelle de l’oeuvre.
L’enregistrement, l’archive, la pièce susceptible d’être conservée dans un musée
sont des messages achevés. Un tableau, par exemple, objet de conservation, est à la
fois l’oeuvre elle-même et l’archive de l’oeuvre. Mais l’oeuvre-événement,
l’oeuvre-processus, l’oeuvre interactive, l’oeuvre métamorphique, connectée,
traversée, indéfiniment coconstruite de la cyberculture peut difficilement
s’enregistrer en tant que telle, même si l’on photographie un moment de son procès
ou si l’on capte quelque trace partielle de son expression. Et surtout, faire oeuvre,
enregistrer, archiver : cela n’a plus, cela ne peut plus avoir le même sens qu’avant le
déluge informationnel. Lorsque les dépôts sont rares, ou du moins circonscriptibles,
faire trace revient à entrer dans la mémoire longue des hommes. Mais si la mémoire
est pratiquement infinie, en flux, débordante, alimentée à chaque seconde par des
myriades de capteurs et des millions de gens, entrer dans les archives de la culture ne
suffit plus à différencier. Alors, l’acte de création par excellence consiste à faire événement,
ici et maintenant, pour une communauté, voire à constituer le collectif pour qui
l’événement adviendra, c’est-à-dire à réorganiser partiellement le métamonde virtuel,
l’instable paysage de sens qui abrite les humains et leurs oeuvres.
Ainsi, la pragmatique de la communication dans le cyberespace estompe les deux
grand facteurs de totalisation des oeuvres : totalisation en intention par l’auteur,
totalisation en extension par l’enregistrement.
Avec le rhizôme et le plan d’immanence, Deleuze et Guattari ont philosophiquement
décrit un schéma abstrait qui comprend :
la prolifération, sans limites a priori, de connexions entre noeuds
hétérogènes et la multiplicité mobile des centres,
le grouillement des hiérarchies enchevêtrées, les effets holographiques
d’enveloppements partiels et partout différents d’ensembles dans leurs
parties, la dynamique auto-poiétique et auto-organisatrice de populations mutantes
qui étendent, créent, transforment un espace qualitativement varié, un
paysage ponctué de singularités.
Ce schéma s’actualise socialement par la vie des communautés virtuelles,
cognitivement par les processus d’intelligence collective, sémiotiquement sous la
forme du grand hypertexte ou du métamonde virtuel du Web.
L’oeuvre de la cyberculture participe à ces rhizomes, à ce plan d’immanence du
cyberespace. Elle est donc d’emblée creusée de tunnels ou de failles qui l’ouvrent
sur un extérieur inassignable et connectée par nature (ou en attente de connexion) à
des gens, à des flux de données.
Voici l’hypertexte global, le métamonde virtuel en métamorphose perpétuelle, le flux
musical ou iconique en crue. Chacun est appelé à devenir un opérateur singulier,
qualitativement différent, dans la transformation de l’hyperdocument universel et
intotalisable. Entre l’ingénieur et le visiteur de monde virtuel, tout un continuum
s’étend. Ceux qui se contentent d’arpenter ici concevront peut-être des systèmes ou
sculpteront des données là-bas. Cette réciprocité n’est en rien garantie par l’évolution
technique, ce n’est qu’une possibilité favorable ouverte par nouveaux dispositifs de
communication. Aux acteurs sociaux, aux activistes culturels de la saisir afin de ne
pas reproduire dans le cyberespace la mortelle dissymétrie du système des médias de
masse.
L’universel sans totalité : texte, musique et image
Pour chaque grande modalité du signe, texte alphabétique, musique ou image, la
cyberculture fait émerger une forme et une manière d’interagir nouvelles. Le texte se
plie, se replie, se divise et se recolle par bouts et fragments ; il mute en hypertexte et
les hypertextes se connectent pour former le plan hypertextuel indéfiniment ouvert et
mobile du Web.
La musique peut certes se prêter à une navigation discontinue par hyperliens (on
passe alors de bloc sonore en bloc sonore selon les choix de l’auditeur), mais elle y
gagne beaucoup moins que le texte. Sa mutation majeure dans le passage au
numérique se définirait plutôt par le processus récursif ouvert de l’échantillonnage, du
mixage et de l’arrangement, c’est-à-dire par l’extension d’un océan musical virtuel
alimenté et transformé continuellement par la communauté des musiciens.
Quant à l’image, elle perd son extériorité de spectacle pour s’ouvrir à l’immersion.
La représentation fait place à la visualisation interactive d’un modèle, la simulation
succède à la ressemblance. Le dessin, la photo ou le film se creusent, accueillent
l’explorateur actif d’un modèle numérique, voire une collectivité de travail ou de jeu
engagée dans la construction coopérative d’un univers de données.
Nous avons donc trois formes principales :
– le dispositif hyperdocumentaire de lecture-écriture en réseau pour le texte,
– le processus récursif de création et transformation d’une mémoire-flux par
une communauté de coopérateurs différenciés, dans le cas de la musique,
– l’interaction sensori-motrices avec un ensemble de données qui définit l’état
virtuel de l’image.
Or aucune de ces trois formes n’est exclusive des autres. Mieux, chacune d’elle
actualise différemment la même structure abstraite de l’universel sans totalité, si bien
qu’en un certain sens chacune contient les deux autres.
On navigue dans un monde virtuel comme dans un hypertexte et la pragmatique de la
techno suppose, elle aussi, un principe de navigation virtuel et différé dans la
mémoire musicale. Par ailleurs, certaines performances musicales en temps réel
mettent en oeuvre des dispositifs de type hypermédia.
Dans notre analyse des nouvelles tendances de la musique numérique, j’ai
mis en évidence la transformation coopérative et continue d’une réserve
informationnelle qui tient lieu à la fois de canal et de mémoire commune. Or ce type de
situation concerne aussi bien les hypertextes collectifs et les mondes virtuels pour la
communication que la musique techno. Ajoutons que les images et les textes font, de
plus en plus, l’objet de pratiques d’échantillonnage et de réarrangement. Dans la
cyberculture, toute image est potentiellement matière première d’une autre image,
tout texte peut constituer le fragment d’un plus grand texte composé par un
« agent » logiciel intelligent à l’occasion d’une recherche particulière.
Enfin, l’interaction et l’immersion, typiques des réalités virtuelles, illustrent un
principe d’immanence du message à son récepteur qui s’applique à toutes les
modalités du numérique : l’oeuvre n’est plus à distance mais à portée de main. Nous
y participons, nous la transformons, nous en sommes partiellement les auteurs.
L’immanence des messages à leurs récepteurs, leur ouverture, la transformation
continue et coopérative d’une mémoire-flux des groupes humains, tous ces traits
actualisent le déclin de la totalisation. Quant au nouvel universel, il se réalise dans la
dynamique d’interconnexion de l’hypermédia en ligne, dans le partage de l’océan
mnémonique ou informationnel, dans l’ubiquité du virtuel au sein des réseaux qui le
portent. En somme, l’universalité vient de ce que nous baignons tous dans le même
fleuve d’informations et la perte de la totalité de sa crue diluvienne. Non content de
couler toujours, le fleuve d’Héraclite a maintenant débordé.
L’auteur en question
Comme nous venons de le voir, l’auteur et l’enregistrement garantissent la
totalisation des oeuvres, ils assurent les conditions de possibilité d’une
compréhension englobante et d’une stabilité du sens. Si la cyberculture trouve son
essence dans l’universel sans totalité, nous devons examiner, ne fusse qu’à titre
d’hypothèse, les guises d’un art et d’une culture pour qui ces deux figures
passeraient au second plan. En effet, nous ne pensons pas qu’après être passé par un
état de civilisation où l’archive mémorable et le génie créateur furent si prégnants,
nous puissions imaginer (sauf catastrophe culturelle) une situation où l’auteur et
l’enregistrement aient entièrement disparu. En revanche, nous devons envisager
sereinement un état futur de la civilisation où ces deux verrous de la totalisation
déclinante ne tiendraient plus qu’une place modeste dans les préoccupations de ceux
qui produisent, transmettent et goûtent les oeuvres de l’esprit.
La notion d’auteur en général, comme les différentes conceptions de l’auteur en
particulier, sont fortement liées à certaines configurations de communication, à l’état
des relations sociales sur les plans économique, juridique et institutionnel.
Dans les sociétés où le principal mode de transmission des contenus culturels
explicites est la parole, la notion d’auteur apparaît mineure, voire inexistante. Les
mythes, les rites, les formes plastiques ou musicales traditionnelles sont
immémoriales et on ne leur associe généralement pas de signature, ou bien celle d’un
auteur mythique. Notons au passage que le concept même de signature, comme celui
de « style » personnel, implique l’écriture. Les artistes, chanteurs, bardes,
conteurs, musiciens, danseurs, sculpteurs, etc., sont plutôt considérés comme des
interprètes d’un thème ou d’un motif venu de la nuit des temps et appartenant au
patrimoine de la communauté considérée. Parmi la diversité des époques et des
cultures, la notion d’interprète (avec la capacité de distinguer et d’apprécier les
grands « interprètes ») se trouve beaucoup plus répandue que la notion d’auteur.
Celle-ci prend évidemment quelque relief avec l’apparition et l’usage de l’écriture.
Cependant, jusqu’au Moyen Âge inclus, on ne considérait pas nécessairement
comme auteur toute personne rédigeant un texte original. Le terme était réservé à une
source d' »autorité », comme par exemple Aristote, tandis que le commentateur ou
le copiste glosant ne méritaient pas cette appellation. Avec l’imprimerie, donc avec
l’industrialisation de la reproduction des textes, il devint nécessaire de définir
précisément le statut économique et juridique des rédacteurs. C’est alors, tandis que
se précise progressivement son « droit », que prend forme la notion moderne
d’auteur. Parallèlement, la Renaissance voit se développer la conception de l’artiste
comme créateur démiurgique, inventeur ou concepteur, et non plus seulement
comme artisan, ou passeur plus ou moins inventif d’une tradition.
Y a-t-il de grandes oeuvres, de grandes créations culturelles sans auteur? Sans
aucune ambiguïté, la réponse est oui. La mythologie grecque, par exemple, est un
des joyaux du patrimoine culturel de l’humanité. Or, c’est incontestablement une
création collective, sans auteur, venue d’un fond immémorial, polie et enrichie par
des générations de retransmetteurs inventifs. Homère, Sophocle ou Ovide, en tant
qu’interpètes célèbres de cette mythologie, lui ont évidemment donné un lustre
particulier. Mais Ovide est l’auteur des Métamorphoses pas de la mythologie ;
Sophocle a écrit Oedipe roi, il n’a pas inventé la saga des rois de Thèbes, etc.
La Bible est un autre cas exemplaire d’une oeuvre majeure du fond spirituel et
poétique de l’humanité qui n’a pourtant pas d’auteur assignable. Hypertexte avant la
lettre, sa constitution résulte d’une sélection (d’un échantillonnage!) et d’un
amalgame tardif d’un grand nombre de textes de genres hétérogènes rédigés à
diverses époques. L’origine de ces textes peut se trouver en d’anciennes traditions
orales du peuple juif (la Genèse, l’Exode), mais aussi bien dans l’influence des
civilisations mésopotamienne et égyptienne (certaines parties de la Genèse, les
Livres de sagesse), dans la brûlante réaction morale à une certaine actualité politique
et religieuse (Livres prophétiques), dans un épanchement poétique ou lyrique
(Psaumes, Cantique des cantiques), dans une volonté de codification législative et
rituelle (Lévitique) ou de préservation d’une mémoire historique (Chroniques, etc.).
On considère pourtant à juste titre la Bible comme une oeuvre, porteuse d’un
message religieux complexe et de tout un univers culturel.
Pour en rester à la tradition juive, notons que telle interprétation d’un docteur de la
Loi ne prend véritablement autorité que lorsqu’elle devient anonyme, quand la
mention de son auteur est effacée et qu’elle s’intègre au patrimoine commun. Les
talmudistes citent constamment les avis et les commentaires des sages qui les ont
précédés, contribuant ainsi à une manière d’immortalité du plus précieux de leur
pensée. Mais, paradoxalement, le plus haut accomplissement du sage consiste à ne
plus être cité nommément, et donc à disparaître comme auteur afin que son apport se
fonde et s’identifie à l’immémorial de la tradition collective.
La littérature n’est pas le seul domaine où des oeuvres majeures sont anonymes. Les
thèmes des ragas, les peintures de Lascaux, les temples d’Angkor ou les cathédrales
gothiques ne sont pas plus signées que La Chanson de Roland.
Ainsi, il y a de grandes oeuvres sans auteurs. En revanche, réaffirmons qu’il semble
difficile de goûter de belles oeuvres sans l’intervention de grands interprètes,
c’est-à-dire sans personnes talentueuses qui se placent sur le fil d’une tradition, la
réactivent et lui donnent un éclat particulier. Or les interprètes peuvent être connus,
mais il peuvent tout aussi bien n’avoir pas de visage. Qui fut l’architecte de
Notre-Dame de Paris? Qui sculpta les portails des cathédrales de Chartres ou de
Reims?
La figure de l’auteur émerge d’une écologie des médias et d’une configuration
économique, juridique et sociale bien particulière. Il n’est donc pas étonnant qu’elle
puisse passer au second plan lorsque le système des communications et des rapports
sociaux se transforme, déstabilisant le terreau culturel qui avait vu grandir son
importance. Mais cela n’est peut-être pas si grave puisque la prééminence de l’auteur
ne conditionne pas l’épanouissement de la culture ni la créativité artistique.
Le déclin de l’enregistrement
Nous disions plus haut que faire oeuvre, faire trace, enregistrer, n’a plus le même
sens, la même valeur, qu’avant le déluge informationnel. La dévaluation des
informations suit naturellement de leur inflation. Dès lors, le propos du travail
artistique se déplace sur l’événement, c’est-à-dire vers la réorganisation du paysage
de sens qui, fractalement, à toutes les échelles, habite l’espace de communication,
les subjectivités de groupe et la mémoire sensible des individus. Il se passe quelque
chose dans le réseau des signes comme dans le tissu des gens.
Évitons les malentendus. Il ne s’agit certes pas de prévoir banalement un déplacement du
« réel » lourdement matériel conservé par les musées vers un « virtuel » labile du
cyberespace. A-t-on vu que l’irrésistible montée du Musée imaginaire chanté par
Malraux, c’est-à-dire la multiplication des catalogues, les livres et les films d’art
aient fait diminuer la fréquentation des musées? Au contraire. Plus se sont répandus
les éléments recombinables du musée imaginaire et plus on a fondé de bâtiments
ouverts au public dont la vocation était d’abriter et d’exposer la présence physique
des oeuvres. Il reste que si l’on étudiait le destin de tel ou tel tableau célèbre, on
trouverait qu’il a été goûté plus souvent en reproduction que par visite de l’original.
De même, les musées virtuels ne feront probablement jamais concurrence aux réels,
ils en seraient plutôt l’extension publicitaire. Ils représenteront cependant la
principale interface du public avec les oeuvres. Un peu comme le disque a mis plus
de gens en contact avec Beethoven ou les Beatles que le concert. L’idée fausse de substitution du prétendu « réel » par un « virtuel » ignoré et déprécié a donné lieu à une multitude de malentendus. J’y reviendrai dans le chapitre XV sur la critique de la substitution.
Ce qui précède vaut évidemment pour les arts plastiques « classiques ». Quant aux propositions
spécifiques de la cyberculture, elles trouvent dans le virtuel leur lieu naturel tandis
que les musées ne peuvent en accueillir qu’une imparfaite projection. On
n' »expose » pas un CD-ROM ni un monde virtuel : on doit y naviguer,
s’immerger, interagir, participer à des processus qui demandent du temps.
Renversement inattendu : pour les arts du virtuel, les « originaux » sont des
faisceaux d’événements dans le cyberespace tandis que les « reproductions » se
goûtent à grand-peine dans le musée.
Les genres de la cyberculture sont de l’ordre de la performance, comme la danse et le
théâtre, comme les improvisations collectives du jazz, de la commédia dell’arte ou
des concours de poésie de la tradition japonaise. Dans la lignée des
installations, ils demandent l’implication active du récepteur, son déplacement dans
un espace symbolique ou réel, la participation de sa mémoire à la constitution du
message. Leur centre de gravité est un processus subjectif, ce qui les délivre de toute
clôture spatio-temporelle.
Organisant la participation à des événements plutôt que des spectacles, les arts de la
cyberculture retrouvent la grande tradition du Jeu et du Rituel. Le plus contemporain
boucle ainsi sur le plus archaïque, sur l’origine même de l’art dans ses fondements
anthropologiques. Le propre des ruptures majeures ou des vrais « progrès » n’est-il
d’ailleurs pas tout en opérant la critique en acte de la tradition avec laquelle ils
rompent de revenir paradoxalement au commencement? Aussi bien dans le jeu que
dans le rituel, ni l’auteur, ni l’enregistrement ne sont importants, mais plutôt l’acte
collectif ici et maintenant.
Ingénieur de mondes avant la lettre, Léonard de Vinci organisait des fêtes princières dont il ne reste rien. Qui ne voudrait y avoir participé?
D’autres fêtes se préparent pour demain.
Extraits de Cyberculture, rapport au Conseil de l’Europe de Pierre Lévy. Paris, Odile Jacob, 1998.