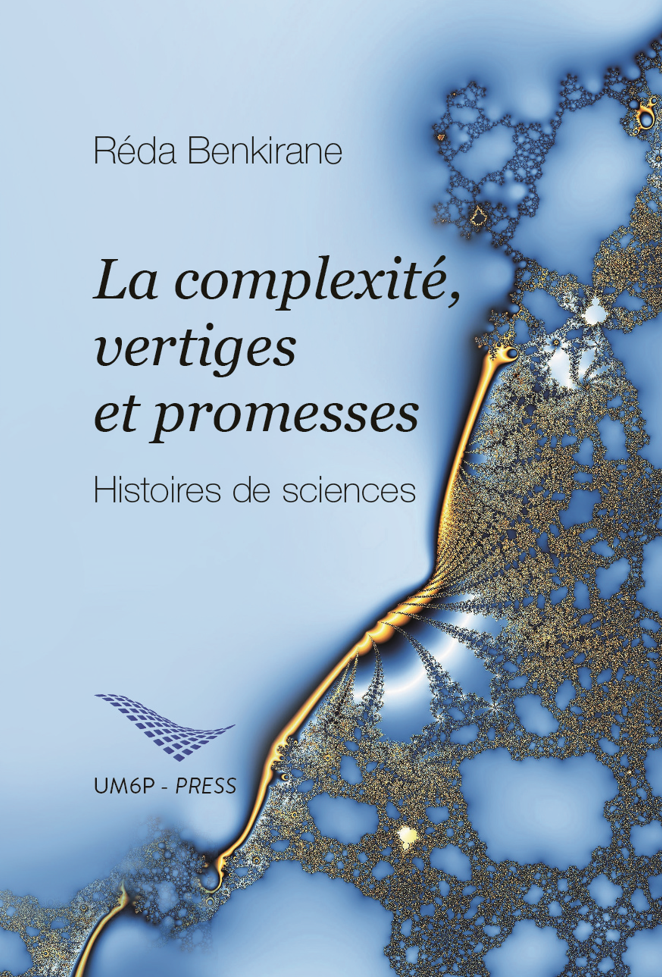Réda Benkirane: Comment situer la réflexion sur le « Serpent cosmique » par rapport à votre expérience, déjà ancienne et disons plus conventionnelle, d’anthropologue des populations indigènes d’Amazonie? Quelle est la nouveauté et éventuellement les ruptures par rapport à vos travaux précédents?
Jeremy Narby: Pendant le long processus d’acquisition d’un doctorat en anthropologie dans une université d’élite aux États-Unis, j’ai vu que mes professeurs en anthropologie nous formaient, moi et mes camarades doctorants, pour devenir… d’autres professeurs en anthropologie. Au plus haut niveau, le serpent se mordait la queue, et la discipline tournait dans le vide, flottant au-dessus de la réalité, qu’elle était pourtant sensée étudier. Entre-temps, les Indiens Ashaninca, avec qui j’avais vécu, m’avait marqué par leur mise en exergue de la pratique, qu’ils considéraient comme la forme la plus avancée de la théorie. Leur point de vue était clair: si une idée est vraiment bonne, c’est qu’elle est réalisable. A mon retour d’Amazonie, j’ai proposé cette manière de voir à mes camarades, mais j’ai vite compris qu’ils n’avaient qu’un intérêt distant pour le concret. Dès que j’avais le doctorat en poche, j’ai tourné le dos à toute cette scène, et je me suis dirigé vers la pratique, convaincu que j’allais aller plus loin avec mon anthropologie (= étude de l’humain).
Je cherchais à rendre utiles mes études de l’écologie indigène amazonienne. Des 1989, l’organisation d’entraide suisse Nouvelle Planète m’a donné l’occasion de récolter des projets de démarcation territoriale en Amazonie, et de les présenter pour financement ici en Europe au nom de la sauvegarde de la forêt amazonienne. Je devais donc utiliser le savoir que j’avais acquis pour trouver des bons projets en Amazonie, puis pour expliquer leur pertinence à des publics européens essentiellement non-spécialistes. Dans un contexte des plus réels, il s’agissait d’expliquer aux Indiens qui étaient ces blancs qui voulaient aider (pour une fois), et d’expliquer aux Européens que les indigènes n’étaient pas des (nobles) sauvages, mais des gens munis d’un savoir certain par rapport à leur milieu ancestral. C’était de l’anthropologie à double sens. J’ai plus ou moins bien fait mon boulot, puisque j’ai réussi à récolter des fonds considérables ici, et que leur utilisation s’est faite à bon escient là-bas. En quatre ans de travail, une surface totale équivalente aux deux tiers de la Suisse à été titularisée au nom des peuples amazoniens, essentiellement au Pérou.
La première rupture avec la trajectoire conventionnelle d’un anthropologue se situe là: en agissant dans la réalité des budgets, des versements d’argent, de l’organisation du travail topographique, du suivi bureaucratique des dossiers, du bouclement des comptes, etc., les Indiens étaient tellement au point que les financeurs suisses à l’autre bout n’avaient rien à redire. Autrement dit, les Indiens étaient opérationnels sur le plan de la « vraie » réalité, celle de chez nous, celle des cash-flow. Ils ne parlaient pas en métaphores. Ils disaient « nous avons besoin de tant pour démarquer tant d’hectares ». Et lorsqu’on leur envoyait la somme en question, la surface correspondante se trouvait titularisée peu de temps après.
J’ai donc vu ce que mes collègues académiques ne voient pas, lorsqu’ils mènent des démarches abstraites « sur le terrain », puis rentrent à leur université pour écrire des articles que seuls d’autres anthropologues liront.
Et chaque fois que je retournais en Amazonie pour vérifier les projets, je parlais avec les Indiens dans les communautés, pas seulement Ashaninca, mais aussi Bora, Machiguenga, Shipibo, en tous une dizaine de peuples, et ils m’affirmaient invariablement que leur savoir écologique provenait de leurs chamanes, qui buvaient une décoction végétale hallucinogène, et conversaient dans leurs visions avec les esprits de la nature.
A cet égard, il y avait un autre point de rupture, qui s’était produit tout au début de ma trajectoire d’anthropologue. J’avais essayé à plusieurs reprises cette décoction, et j’avais vu que ce n’était pas de la plaisanterie. Par contre, je ne savais pas du tout de quoi il s’agissait, et j’avais peur que mes collègues ne me prennent point au sérieux. Mais huit ans plus tard, ayant acquis de la « bouteille », et ayant vu que mes collègues académiques vivaient dans un monde à moitié divorcé de la réalité, je n’avais plus peur de considérer les données en elles-mêmes: les Indiens d’Amazonie occidentale, dont le savoir écologique est admiré par la communauté scientifique et pharmaceutique internationale, affirment qu’ils acquièrent une partie de leur savoir grâce aux hallucinations induites par une décoction végétale. Je ne pouvais plus simplement me dire qu’il s’agissait de métaphores, parce que mon travail pratique m’avait appris à ne pas me contenter de telles explications.
Au fond, j’ai innové en prenant les Indiens au mot, tout simplement. Que cette démarche là constitue une rupture, en dit long sur les présupposés des « sciences de l’homme ».
Vous décrivez l’ayahuasca comme tour à tour le microscope, la télévision, l’Internet de la forêt. Cet hallucinogène ouvre-t-il la voie à une observation, un accès à l’information comparable à nos déambulations (pour l’heure au stade de balbutiements) dans l’univers cybernétique? Quel type d’information peut-on chercher – et trouver – par ce biais? La notion d’interactivité est-elle concevable pour un ayahuasquero?
JN: J’embrasse les métaphores comme voie de compréhension, mais il s’agit de les manier avec soin. L’ayahuasca donne accès à des images sonores tri-dimensionnelles, ultra-colorées et capables de défiler à une vitesse ahurissante; ces images sonores semblent contenir de l’information bio-moléculaire et curative, entre autres, et elles sont essentiellement interactives. Le travail du chamane consiste à interagir avec ces images de façon à en ramener de l’information utile et vérifiable dans la réalité quotidienne. Cette interaction s’articule autour de la voix, du son, du chant — et de la mémoire, avec le chant, encore une fois, comme support mnémonique. Notez qu’il ne s’agit pas de texte, et qu’il n’y a ni claviers, ni écrans, comme avec l’Internet: voici les limites de la métaphore. Durant les visions, il n’y a pas besoin d’attendre que les images s’inscrivent sur l’écran; au contraire, on fait face à un trop plein, un défilé vertigineux. Le débit des images est d’un autre ordre. Par contre, de la métaphore je retiens le côté « world wide web », parce que, d’après mon hypothèse, c’est le réseau biosphérique de la vie à base d’ADN qui est la source des images.

Cinq après le Sommet de la Terre de Rio et le 500e anniversaire de la « découverte » de Colomb, quels ont été les impacts de ces deux événements sur les populations amazoniennes? Quels leçons ces sociétés ont-elles pu tirer, donner en cette occasion où, pour une fois, le monde occidental focalisa en leur direction?
JN: Ce genre d’événement n’agit pas tout de suite au niveau où l’on voudrait voir le changement, c’est-à-dire sur le terrain, dans la réalité vécue par les gens. A Rio par exemple, on a décrété l’importance du savoir des peuples indigènes; les gouvernements du monde ont signé des accords affirmant leur volonté de rémunérer ce savoir « équitablement ». Or, rien n’a changé depuis. La propriété intellectuelle des peuples indigènes demeure sans protection, et ceux qui l’exploitent ne sont pas pressés de voir évoluer la situation. On évacue la question en disant qu’il y a d’autres priorités, ou que les Indiens pourront se contenter de ce que telle compagnie pharmaceutique voudra bien leur offrir.
Dans un cas que je connais bien, nous essayons depuis deux ans, avec les organisations non-gouvernementales suisses qui soutenons les peuples indigènes, d’interpeller la DDC (Coopération technique suisse) pour qu’elle mette en place une politique interne concernant les peuples indigènes. Les accords de Rio, signés par la Suisse, stipulent que l’on ne peut aborder des questions de biodiversité ou de développement durable sans se référer aux peuples indigènes. En Amazonie, par exemple, où poussent la moitié de toutes les espèces végétales de la planète, il y a dix fois plus de plantes ayant un nom dans les langues indigènes que les scientifiques n’ont pu en répertorier et auxquelles ils ont pu attribuer un nom latin -ce qui signifie que la connaissance de la diversité biologique est entre les mains des peuples indigènes. Eh bien, pour parler poliment et concisement, on peut dire que nous avons rencontré toutes sortes de résistances de la part de la DDC; nous nous sommes même fait traités d' »apartheidistes » par une haut-fonctionnaire (pour qui il est dangereux de soutenir des causes « ethniques »…). Mais les accords de Rio nous ont été très utiles pour faire avancer ce dialogue précis. Il suffit d’en citer certains passages. Ainsi, selon le principe 22 de la Déclaration de Rio: « Les populations et communautés autochtones […] ont un rôle vital à jouer dans la gestion de l’environnement et le développement du fait de leurs connaissances du milieu et de leurs pratiques traditionnelles. Les États devraient reconnaître leur identité, leur culture et leurs intérêts, leur accorder tout l’appui nécessaire et leur permettre de participer efficacement à la réalisation d’un développement durable ».
En l’occurrence, je suis confiant que les choses vont avancer avec la DDC, et que d’ici cinq ans peut-être, la Coopération suisse soutiendra des initiatives indigènes sur le terrain. A ce moment-là, on pourra dire que le Sommet de la Terre de Rio commence à avoir un impact concret.
Une remarque finale: la science à établi depuis des décades que les peuples indigènes disposent de savoirs tout à fait remarquables. Mais le monde industriel a une attitude immature, et ne reçoit de leçons de personne, surtout pas d’Indiens vivant pied nus dans la forêt. Il y a une sorte de racisme épistémologique qui opère, dans nos universités, dans nos laboratoires, et dans nos têtes. Ce racisme est plus tenace, parce que plus caché, que celui qui concerne la couleur de la peau.
JN: Vous imaginez que si les entreprises locales en Europe ont de la peine a échapper à la mondialisation économique et à la pure logique marchande, il sera d’autant plus difficile pour les populations amazoniennes de le faire. Pourtant, c’est le pari qu’ils font. Parce que ce sont eux qui envisagent déjà les solutions, plutôt que les anthropologues comme moi. C’est là un des développements les plus étonnants des dernières quinze années: des centaines de peuples indigènes, éparpillés à travers l’immensité de la forêt amazonienne, sans moyens de communication modernes, se sont élevés d’une seule voix, et ont commencé à s’organiser ensemble, à envoyer des représentants dans le monde, à Lima, Washington et Genève, pour exiger le respect de leurs territoires, dans un premier temps. Et ces représentants indigènes nous ont étudiés. Il ne faut pas oublier que ces peuples sont des chasseurs, fin stratèges, utilisant éclaireurs, imitant les sons des animaux qu’ils chassent pour mieux les attirer. Ainsi, les peuples amazoniens ont appris notre langage; ils ont vu qu’en Occident, il y a des écologistes, des compagnies pharmaceutiques, des organismes de développement, etc., et ils ont appris à manoeuvrer ici, et à nous diagnostiquer. Maintenant ils savent ce qu’ils veulent: ne plus être exploités par nous.
Tout cela a mis les anthropologues sur la touche, ce qui est, je crois, notre juste place, comme des soigneurs, des coaches, ou des conseillers.
Avec la trajectoire que les Indiens ont montré au cours des derniers 15 ans, je suis confiant qu’ils vont très bien se débrouiller. Mais la réalité est ultra-complexe. Dans un premier temps, il s’agit d’établir une reconnaissance détaillée, officielle et financière de la propriété intellectuelle des peuples indigènes. Très bien, direz-vous, mais que feront les peuples de l’Amazonie péruvienne lorsque Novartis leur versera 100 millions de dollars pour tel remède? N’est-ce pas là que les véritables problèmes commenceront? Bien sûr. Voilà la complexité. Chaque pas en avant mène à des problèmes d’un autre ordre. Mais le retour en arrière n’est pas possible, et n’est souhaité par personne. Les Indiens ont le droit de faire des erreurs. J’estime que ce que nous pouvons faire de mieux pour que cette situation précise progresse est de leur donner libre accès au marché et de les rémunérer comme n’importe quel autre acteur; c’est-à-dire que s’ils ont un remède qui marche, qu’ils puissent le breveter et en tirer profit. Pour l’instant, ce droit, pourtant basique en capitalisme, leur est prohibé. Drôle de monde, quand même.
La propriété intellectuelle est une notion rendue de plus en plus floue par la digitalisation du monde, ou tout est réduit en chaînes binaires de 0 et 1, virtuellement partout et nulle part, pouvant être dupliqué à l’infini, sans possibilité aucune de distinguer l’original de la copie … Une des voies susceptibles de protéger la propriété intellectuelle à l’ère cybernétique s’inspirerait de la biologie. Considérer par exemple que la fonction « copier-coller » si familière de nos programmes informatiques trouve ses origines dans le traitement du texte génétique de l’ADN (réplication, transcription, traduction). Nous retournons à l’hypothèse du serpent cosmique. Que vous inspire votre croisement des savoirs des cultures amazoniennes et de la biologie moléculaire par rapport à cette question -peut-être aussi éminemment philosophique- du droit d’auteur ?
JN: Les chamanes disent que les essences animées communes à toutes les formes de vie sont vivantes, et que la nature est intelligente. Les biologistes moléculaires présupposent qu’elle ne l’est pas. Mais l’existence même de l’ADN, qui est un « texte », ou un « programme » ou un « ensemble de données » selon les différentes métaphores utilisées par les biologistes moléculaires, me pousse à pencher pour l’hypothèse d’une intelligence dans la nature. Je ne parle pas métaphoriquement, mais bien moléculairement: une intelligence qui se manifeste, entre autres, par l’existence moléculaire d’un « texte » en ADN. De ce point de vue, breveter des séquences en ADN est donc une double imposture: d’une part, le lecteur du texte n’en est pas l’auteur, et d’autre part, la découverte de la séquence n’est pas une invention -alors que les brevets ne sont reconnus que pour les inventions en temps normal.
Vous dites qu’il s’agit d’une question possiblement philosophique. On peut même dire religieux. Je considère l’athéisme matérialiste qui règne dans les laboratoires comme une foi, jeune, intolérante et zélée. Qui peut prouver que l’ADN n’est qu’une molécule -surtout quand on nous la décrit par la même occasion comme un support informatique capable d’auto-duplication? Accepter que l’ADN n’est qu’un produit chimique inerte (et que ses séquences sont brevetables), est un acte de foi. Et nous sommes bien d’accord: science et religion se mélangent difficilement, surtout lorsqu’il y a des milliards de dollars en jeu.
Si on daignait dialoguer à ce sujet avec des chamanes, qui parlent avec les essences animées de la nature depuis des millénaires (alors que nous ne connaissons le rôle de l’ADN que depuis 44 ans), on pourrait peut-être tirer cette affaire au clair. Selon les chamanes, les essences animées sont essentiellement doubles, sources de pouvoir bénéfique, mais aussi maléfique. Traiter avec ces essences exige une démarche éthique, car l’utilisation à des fins personnelles du savoir qui s’y rapporte est non seulement la définition même de la magie noire, mais aussi suicidaire pour la personne qui s’y engage.
Quant aux peuples indigènes, ils devraient pouvoir breveter leurs recettes, leurs remèdes, leurs techniques, et en tirer profit, au même titre que les autres. C’est d’ailleurs ce qu’ils demandent. Reconnaissons leur expertise en nos termes, c’est-à-dire financièrement, aussi.
En quoi converge et diverge votre travail avec les écrits de Castañeda et les autres études sur l’usage de plantes hallucinogènes chez les peuples amérindiens?
JN: Castañeda a compris avant beaucoup d’anthropologues que la meilleure façon de rendre compréhensible la réalité souvent abracadabrante des chamanes était de raconter une histoire vécue à la première personne. Il a montré que lorsque l’anthropologue arrête de se retrancher derrière la troisième personne, et s’implique à la première personne dans la réalité qu’il décrit et dans laquelle il participe qu’il le veuille ou non, sa version des faits est plus compréhensible, et plus vraisemblable. C’est une question essentiellement épistémologique: le chamanisme travaille centralement avec l’imagerie interne et subjective; la seule façon de savoir de quoi il s’agit est d’impliquer son « je ». Il n’est pas possible de nager sans mouiller son propre corps. L’étude « objective » du chamanisme est un contresens, comme parler de natation sans jamais se lancer à l’eau.
Par contre, Castañeda a certainement fini par tomber dans la marmite sur laquelle il se penchait. Il a cessé d’être un anthropologue, et il est devenu un trickster, un fripon, un joueur de tours; comme tous les chamanes, il s’est mis à raconter des mythes, qui sont des histoires fantastiques à propos du savoir -mais qu’il ne faut pas confondre avec des récits véridiques qui respectent le canon de l’académisme. On peut juger ce choix de plusieurs façons, et on peut même le justifier jusqu’à un certain point. Comme le chanteur britannique Sting, qui a fait des fictions télévisuelles pour mieux sensibiliser les millions de téléspectateurs: il a bafoué la réalité ethnographique, mais la fin justifiait les moyens en l’occurrence. Personnellement, je regrette que Castañeda ait quitte le niveau de la réalité des faits; ses derniers livres ne m’intéressent guère.
De Castañeda, je retiens le ton narratif, et l’expression à la première personne. Par contre, je fais tout ce que je peux pour rester factuel, et pour coller aux données établies par la science. J’essaie de combiner le meilleur des deux mondes: narratif ET rigueur, donc.
Concernant les autres études sur l’usage des plantes hallucinogènes, il convient de relever les travaux anthropologiques de Michael Harner et de Gerardo Reichel-Dolmatoff, deux véritables précurseurs, et de Jean-Pierre Chaumeil, Angelika Gebhart-Sayer, et Luis Eduardo Luna; en ethnobotanique, Richard Evans Schultes et Albert Hofmann ont fait du grand travail, sans oublier Gordon Wasson et Humphry Osmond. Tous ces chercheurs ont fait un travail excellent, d’abord concernant la récolte de données. Sans eux, je n’aurais jamais pu faire ce que j’ai fait. Ce serait possible de parler longuement de chacun d’eux. Et il y en a d’autres qu’il ne faudrait pas oublier si on cherchait à répondre exhaustivement. Dans mon livre, j’ai essayé de n’oublier personne, en particulier dans les notes.
Sur un plan plus général, comment situez-vous votre approche du réel par rapport à la « voie » du Nouvel Age?
JN: Le New Age? Vos questions sont si vastes. J’essaie de parler seulement de ce que j’ai vécu. Or, je n’ai jamais assisté à un cours qu’on pourrait qualifier de New Age. Par contre, il est évident que lorsque je donne des conférences ou il est question de chamanisme, je croise des gens qui s’intéressent au « néo-chamanisme », au « channeling », etc. La plupart du temps, ce sont des personnes sensibles qui sont à la recherche de sens, dans un monde ou il faut en convenir, le sens n’est pas si facile à trouver. Il me semble qu’il ne faut pas en vouloir à ces occidentaux qui cherchent du sens, en tâtonnant certes. Par contre, ceux qui transforment cette recherche en un business, ou pire, dans une escroquerie mortelle comme avec le Temple Solaire, sont à juger sévèrement. Une chose que je constate à regret dans bon nombre de personnes « New Age » que je croise est le manque d’humour. C’est une chose qui frappe chez les chamanes amazoniens: plus ils sont avancés dans leurs recherches, plus ils ont d’humour, d’auto-dérision et de modestie gnoséologique. Dans le New Age, il semble que ce soit le contraire. Au fond, la présence d’humour est la preuve par neuf qu’on a à faire au véritable produit.
La présence d’humour que vous observez chez les chamanes amazoniens rompt en effet avec l’image que l’on se fait – austère, ascétique, voire impeccable – des hommes spirituellement inspirés. L’humour est effectivement peu évoqué dans les expériences spirituelles plus « classiques »… y aurait-il d’autres facettes qui permettent au chamane d’entretenir, devant les voyages de son âme, une « modestie gnoséologique »?
JN: Je constate que l’humour n’est pas si détaché du spirituel, puisque le mot « spirituel » signifie aussi « drôle, relatif à la plaisanterie » -mais de nombreuses démarches spirituelles sont plutôt ascétiques, il est vrai.
En Amazonie occidentale, les chamanes utilisent surtout une décoction végétale hallucinogène, l’ayahuasca. Ce breuvage pharmacologiquement sophistiqué permet d’accéder à des transes hallucinatoires très visuelles, mais reste inoffensif, semble-t-il, sur le plan physiologique.
Par contre, certaines sociétés indigènes, en Amérique du nord par exemple, utilisaient traditionnellement l’épreuve physique pour atteindre les visions, leurs chamanes se suspendant par les pectoraux à des crochets, pendant des heures, jusqu’à halluciner. D’autres préféraient jeûner dans le désert pendant 40 jours. Ce genre de technique chamanique consiste à tester les limites de la physiologie -soit tout le contraire de la démarche amazonienne.
Le chamanisme à base d’ayahuasca est donc ouvert aux praticiens qui ne sont pas nécessairement des ascètes, ou des personnes capables d’endurer les pires douleurs. C’est aussi pour cela peut-être que les chamanes amazoniens sont souvent plus « drôles » qu’ailleurs.
Pour répondre à la dernière partie de votre question, je ne crois pas que l’humour soit « une facette permettant au chamane d’entretenir une modestie gnoséologique », mais plutôt le résultat du savoir qu’ils atteignent. Mais je dis ceci sans avoir parlé explicitement avec un ayahuasquero de son sens de l’humour. Je souligne que dans le paragraphe qui suit, je ne parle que de mon interprétation de leur humour.
Je crois que leur utilisation du son, lorsqu’ils chantent dans leurs transes, leur apprend que le langage, ou les mots, sont tordables, qu’on peut leur donner un double sens, ou déformer leur son pour arriver à un autre sens, et que les mots qu’on peut utiliser dans le quotidien ne seront jamais plus que des mots, et que l’essentiel s’exprime mieux dans le non-dit, ou dans le chant, ou dans l’image, que dans le dit, avec ses mots descriptifs et frontaux. La métaphore est ce qui permet de nommer les choses correctement, c’est-à-dire indirectement. C’est le langage double et entrelacé des chamanes, tsai yoshto yoshto comme disent les Yaminahua, language-twisting-twisting.
Dans la réalité quotidienne, cette manière d’appréhender le monde mène à un certain humour, souvent espiègle.
En s’intéressant de plus en plus à la complexité dans ses différentes manifestations (chaos, auto-organisation, vie artificielle, réseaux de neurones, etc.), les sciences dites exactes entreprennent ce qu’il est convenu d’appeler un changement de paradigme. A l’heure ou des chercheurs abordent une neurochimie de la Conscience, quelle pourrait être la place de votre hypothèse (établissant un lien entre des visions mystiques et mythiques et l’ADN) dans le débat sur les sciences?
JN: La place d’une hypothèse est invariablement de proposer de nouvelles avenues d’investigation. En l’occurrence, mon hypothèse suggère que le chamanisme est une exploration de la conscience par sa modification (que ce soit par l’utilisation d’hallucinogènes, de rythmes sonores ou d’autres techniques qui aient un impact sur la neurochimie). En science, il est tout à fait basique de modifier les choses pour l’étudier; par exemple, en génétique, on modifie un gène dans la séquence en ADN pour voir le résultat de cette modification sur l’organisme, et pour en déduire la fonction du gène. Dans ce sens, on peut dire que les chamanes sont de véritables savants de la conscience, qu’ils étudient par modification depuis des millénaires. Mais, pour l’instant, la science « officielle » (celle publiée dans Nature, Science et La Recherche, par exemple) ne veut rien savoir d’un véritable dialogue avec des Indiens vivant pieds nus dans la forêt et consommant des « drogues ». Faut-il rappeler que la plupart des plantes hallucinogènes sont illégales dans le monde occidental, et que, même dans le nouveau domaine de la science de la conscience, personne ne fait carrière en proposant l’utilisation de ces outils? Il existe donc une sorte de racisme épistémologique qui fait que les voies de connaissance établies par d’autres cultures sont tout simplement ignorées. Les chamanes amazoniens étudient la conscience depuis au moins cinq mille ans; la science de la conscience existe depuis moins de cinq ans; et pourtant, aucun de nos chercheurs officiels ne daignent entrer en dialogue avec ceux qui détiennent encore les clés de ce savoir ancien. Toutefois, il ne s’agit pas seulement d’un blocage épistémologique, mais de carrières, de comités éditoriaux, d’organismes de financement, et de tous ces facteurs économico-politico-institutionnels qui articulent notre monde scientifique.

Dans l’état actuel des choses, mon hypothèse ne semble pas avoir une place dans les débats de la science: elle est de l’autre coté de la limite de ce qui est acceptable. Mais, ici dans la marge, il y a plus de place; et les choses évoluent tellement rapidement que tout semble possible dans peu de temps.
JN: La pratique de l’anthropologie au sein d’une tribu amazonienne m’a bien préparé pour la longue exploration que j’ai entreprise dans le monde des biologistes moléculaires. J’ai passé des mois à lire des textes biologiques sans comprendre grand-chose, comme s’il s’agissait d’une langue autochtone; je regardais les dessins, j’essayais de deviner le sens des discours. Finalement, le miracle de la méthode anthropologique eut lieu: à force d’immersion dans leur monde, j’ai commencé à voir les choses du point de vue des biologistes moléculaires.
Et c’est à ce moment-là que j’ai compris que la métaphore « biologistes moléculaires = drôles d’Indiens » avait des limites. Car, contrairement aux Indiens, les biologistes sont pauvres en mythes. Ils n’ont pas de récits qui donnent un sens au monde -alors que leurs données leur permettrait d’en tisser plus d’un. Sur ce point, il s’agit donc de « remythifier » la science plutôt que de la « démystifier ». Comme l’a dit Claude Levi-Strauss: « […] la pensée mythique est destinée à servir de médiation entre les découvertes des scientifiques et l’homme de la rue, incapable de comprendre de telles découvertes de l’intérieur, et réduit par la même à les apercevoir seulement sous la forme d’un monde imaginaire paradoxal, étrange et déroutant, qui présente à ses yeux les mêmes propriétés que celui des mythes ».
La culture occidentale actuelle manque d’histoires à propos de son savoir. Il y a du terrain à défricher du côté du narratif scientifique.
Mais l’anthropologie inversée dont je rêve consisterait à faire un livre pour les Indiens d’Amazonie, qui raconte le savoir occidental, en particulier la biologie moléculaire. Pour une fois, il ne s’agirait pas d’extraire les matières premières (les données) du sud, pour les transformer, et les transférer au nord, mais le contraire. Le but de l’exercice serait d’aider les Indiens à mieux nous comprendre, même si nous n’arrivons pas à les comprendre. Parce que les ponts se construisent depuis les deux rives, et que le changement viendra du savoir.
Je n’aime pas me réclamer d’un mouvement ou d’un autre -mais je suis certainement issu d’une anthropologie interprétative et autocritique, qui essaie d’objectiver son rapport d’objectivation, qui reconnaît l’émotion, qui considère les paroles des gens comme des données à part entière, etc. C’est une anthropologie qui n’est pas une science, mais une forme interprétation. J’essaie d’y ajouter un dévouement à l’indiscipline, c’est-à-dire le non-respect systématique des barrières entre les « disciplines ». Pourquoi nos représentations du réel auraient-elles des barrières, lorsque le réel lui-même n’en a pas?
Propos recueillis par Réda Benkirane