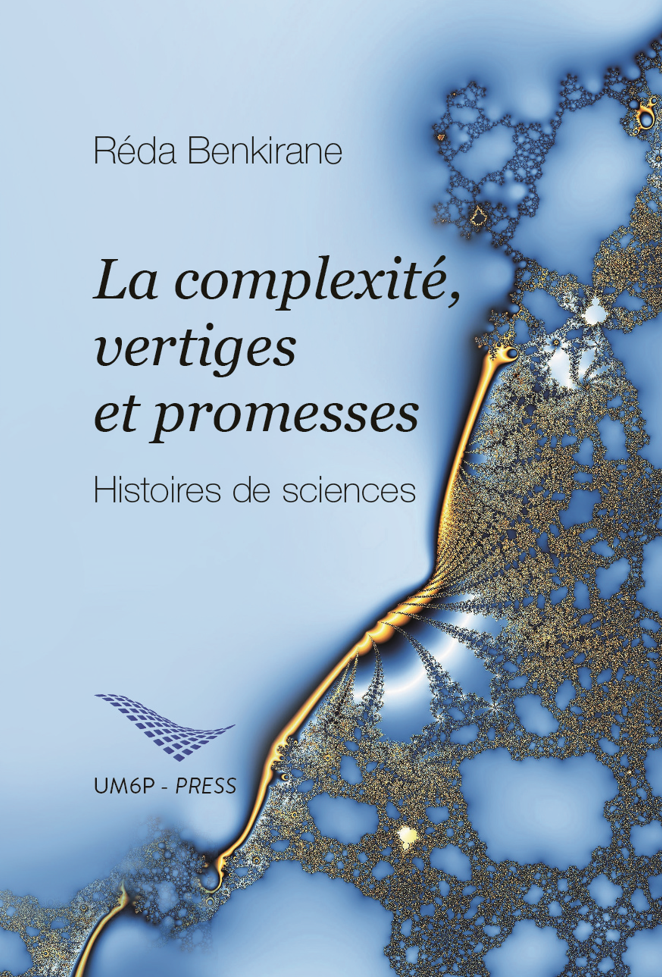Nouvelle finance planétaire
les vertus du chaos
par Charles Goldfinger
Charles Goldfinger, directeur-général de Global Electronic Finance (GEF) Management S.A., à Bruxelles, s’intéresse notamment à l’impact de la technologie de l’information sur la stratégie des entreprises et sur les politiques économiques. Auteur de La géofinance (Paris, Seuil, 1986) et de L’utile et le futile: l’économie de l’immatériel (Paris, Edile Jacob, 1994) et Travail et Hors-Travail, vers une société fluide (Paris, Odile Jacob, 1998), il avait déjà publié dans « Le Temps stratégique » No 31 de l’hiver 1989-90: « La finance internationale, sauvageonne dangereuse que nul n’apprivoisera jamais? ».
Après les économies agricole, industrielles, et des services, voici venu le temps de l’économie immatérielle. L’essentiel de l’activité économique ne consiste plus, désormais, à produire et à accumuler des objets, mais à émettre et à traiter des flux d’informations, canalisés par les « autoroutes numériques », infrastructure de réseaux informatiques, télécommunicationnels et audiovisuels visibles et invisibles.
Au cœur de cette nouvelle économie immatérielle, la finance occupe une place centrale.
Sans monnaie, sans intermédiaires financiers, aucun échange, aucun commerce international, aucun investissement ne serait possible. Aujourd’hui, le volume des transactions financières internationales est de plus de 1300 milliards de dollars par jour, soit près de cent fois supérieur au volume du commerce mondial quotidien des marchandises. Les services financiers contribuent pour 5 à 7% du produit intérieur brut des pays industrialisés. Les grandes banques suisses, allemandes ou françaises sont des multinationales de plein droit.
Mais la finance est aussi une activité hautement symbolique. Dans la société capitaliste en effet, l’argent, non content de façonner l’échelle des valeurs sociales et culturelles, offre le spectacle permanent d’acteurs ambitieux engagés dans des affrontements épiques, de succès spectaculaires et d’échecs cuisants, de controverses animées et de scandales retentissants…
La finance cristallise d’ailleurs les controverses. Sa puissance, sa capacité à se jouer des frontières, la rapidité de son évolution, suscitent à la fois fascination, crainte et hostilité. Certains l’accusent de miner la souveraineté nationale et la démocratie. D’autres dénoncent son influence grandissante dans l’économie. Elle est en tout cas devenue hautement visible.
La coexistence des crises et de l’essor. Dans les années 1980, la finance a provoqué des crises spectaculaires. La crise de la dette du tiers monde du début de la décennie a mis en péril les grandes banques internationales. Les deux krachs boursiers d’octobre 1987 et d’octobre 1989 ont secoué les marchés, sans toutefois casser leur essor. Transactions et flux financiers transnationaux ont connu en effet, durant cette période, un développement sans précédent. De nouveaux marchés, d’instruments dérivés notamment, ont proliféré. Actions et obligations ont connu sur tous les grands marchés des hausses généralisées.
A l’heure actuelle, la dynamique reste la même. Des krachs majeurs, certes, comme celui du marché obligataire américain en 1994, avec des pertes estimées à 1500 milliards de dollars, ou du marché des actions japonaises, dont la valeur s’est effritée de plus de 60% entre 1990 et 1993, plus des scandales entraînant la faillite d’institutions séculaires comme la banque d’affaires britannique Barings Brothers. Mais, dans le même temps, la poursuite de l’essor des transactions et du développement des nouveaux marchés, notamment ceux des pays en voie de développement et des pays ex-communistes, et l’explosion des marchés des instruments dérivés, futures, options et autres swaps — le terme explosion n’est pas trop fort puisqu’entre 1987 et 1993, le montant planétaire des transactions sur les produits dérivés a été multiplié par 9,3 pour atteindre la somme hallucinante de 14’900 milliards de dollars (il est vrai que cette croissance s’est ralentie en 1995, mais sans que l’on puisse dire s’il s’agit d’une pause passagère ou d’une tendance durable.)
La géofinance. Cette coexistence des crises et de l’essor s’inscrit dans une logique plus fondamentale. La globalisation de l’économie (géoéconomie) et de la politique (géopolitique) devait nécessairement s’accompagner d’une globalisation de la finance, que j’ai appelée géofinance.
La géofinance est un réseau planétaire de marchés et d’intermédiaires financiers, capable d’acheminer d’un bout à l’autre de la Terre, en quelques secondes, d’énormes montants de capitaux, que ce soit sous la forme de monnaies, d’obligations, d’actions ou d’instruments dérivés.
Trois forces façonnent la géofinance: l’intégration mondiale des marchés et des flux financiers, bien sûr, mais aussi le développement des nouvelles technologies de l’information, et la déréglementation des services financiers.
La globalisation. Les marchés monétaires à court terme et les marchés des capitaux à long terme, les marchés nationaux et les marchés internationaux, les marchés cash et les marchés dérivés, forment un réseau planétaire interconnecté, qui fonctionne 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Toutefois, le degré de globalisation varie selon les marchés et les instruments. Il est presque total pour le marché des changes qui, avec un volume de transactions de près de 1300 milliards de dollars quotidiens (en 1995) est le plus grand marché mondial. Il est fort avancé pour le marché des taux d’intérêt sur le dollar, fondé pour l’essentiel sur les obligations du Trésor américain (300 milliards de dollars par jour en 1993) et pour les marchés des produits dérivés sur les taux. Il reste en revanche balbutiant pour le marché des actions, même si les krachs boursiers de 1987 et 1989 ont montré qu’il progresse à grand pas.
La géofinance se joue des contraintes de la géographie et des frontières nationales. Elle crée son propre espace-temps, et fonctionne selon une logique qui peut paraître déroutante. On considérait jadis que la principale raison d’être de la finance internationale était de permettre la couverture et le paiement des échanges de marchandises. Or aujourd’hui, cette fonction est devenue mineure (moins de 10% des transactions). Elle a été déplacée par les fonctions nouvelles de protection contre les risques et de jugement sur les nouvelles opportunités de placement.
La finance électronique. Sans les apports massifs de la technologie de l’information, la globalisation serait impossible. L’informatique et la télématique forment l’ossature du nouvel espace-temps financier, planétaire, perpétuel, mais aussi capillaire puisque la banque et la Bourse s’installent à demeure dans les entreprises et dans les foyers grâce au téléphone et à l’ordinateur personnel.
L’informatique financière est restée longtemps discrète, enfouie dans l’intendance de la banque ou de la Bourse. Sa fonction était d’automatiser des tâches répétitives, consommatrices de papier et de main d’œuvre: la comptabilité générale et les moyens de paiement. En revanche, dans les années 80, la technologie a acquis une visibilité nouvelle, et elle est considérée désormais comme une arme de concurrence, un levier de projection planétaire, et comme un outil indispensable pour mobiliser de l’information sur les clients et créer de nouveaux produits. Les dépenses liées à la technologie représentent aujourd’hui de 15 et 20% des coûts d’exploitation des banques. Les banques américaines dépensent planétairement 26 milliards de dollars par an pour la technologie de l’information; plusieurs grands établissements dépensent chacun plus d’un milliard de dollars. En Europe, l’effort est tout aussi important: les grandes banques françaises comme la B.N.P. ou la Société Générale, britanniques comme la Barclays ou la NatWest, consacrent à la technologie de l’information de 2 à 3 milliards de francs français par an.
Les nouveaux instruments financiers — les options, les swaps, les instruments hybrides — ne pourraient exister sans l’informatique, qui a suscité l’essor de nouvelles stratégies d’investissement, fondées sur l’énorme capacité de calcul des ordinateurs, et de nouveaux métiers, tels l’arbitragiste-informaticien. Les marchés eux-mêmes sont devenus électroniques. Des réseaux télématiques tels que Reuters, Telerate ou Bloomberg, qui servaient à l’origine de compléments aux marchés traditionnels, commencent aujourd’hui à les supplanter.
Cette emprise croissante de l’informatique sur les marchés inquiète. Certains ont attribué le krach boursier d’octobre 1987 aux programmes informatiques d’arbitrage entre le marché au comptant de New York et les marchés à terme de Chicago. Les ordinateurs, froids et mystérieux, les stratégies automatisées d’investissement et d’arbitrage, impersonnelles et complexes, sont des boucs émissaires tout désignés. Un retour en arrière paraît pourtant impossible. Les actions et obligations que l’on achète et vend instantanément, la monnaie qui fait le tour du monde en quelques secondes, n’ont plus de réalité physique. Ce ne sont plus des billets ou des lingots que l’on expédie, mais des messages digitaux. Les coffres-forts ont été remplacés par les ordinateurs. La finance se confond désormais avec l’information. Comme le proclamait dans les années quatre-vingt Walter Wriston, Pdg de Citicorp: « L’information sur l’argent est devenue aussi précieuse que l’argent lui-même ». La nouvelle monnaie est informationnelle: c’est la qualité et la richesse de l’information sur l’économie et les marchés financiers qui constituent aujourd’hui l’étalon de la valeur.
La déréglementation et la désintermédiation. On comprendra sans peine que les structures de comportement et les règles de contrôle établies jadis ne sont plus adaptées à l’univers foisonnant de la géofinance.
L’activité financière a toujours été réglementé étroitement. Aux États-Unis et au Japon, des restrictions draconiennes pesaient sur les activités des banques. Dans les pays de l’Union Européenne, les restrictions sur les banques et sur les autres intermédiaires financiers (les agents de change, les compagnies d’assurance) étaient moins contraignantes mais néanmoins sévères; les organismes de tutelle officiels et par les banques centrales les accompagnaient par une surveillance attentive. Réglementation et surveillance visaient à assurer la stabilité du système financier, considéré comme l’élément vital du fonctionnement d’une économie moderne, en protégeant l’épargnant et l’investisseur. Cette protection débouchait de facto sur la protection des banques et des marchés financiers, qui se retrouvaient ainsi peu concurrentiels, cartellisés et cloisonnés. Des dizaines de milliers de firmes de toute taille, banques, caisses d’épargne, compagnies d’assurance, n’avaient qu’une activité spécialisée et locale. Quant aux grandes banques, elles dominaient leur marché national mais jouaient les seconds rôles à l’étranger. Ils n’existait point de leaders mondiaux dominant plusieurs marchés nationaux, comme dans l’automobile, l’informatique ou l’électronique grand public.
Ces structures obsolètes ont tout été secouées par la « déréglementation », entreprise sous la pression combinée d’intermédiaires financiers impatients de briser les carcans réglementaires pesant sur eux, d’entreprises industrielles et commerciales désireuses d’entrer dans le monde de la finance, et d’efforts difficiles d’adaptation du cadre réglementaire.
La dynamique de ce profond mouvement de déréglementation a différé d’un pays à l’autre. Aux États-Unis, des intermédiaires financiers tels que Citicorp et Merrill Lynch ont joué le rôle moteur, alors que les pouvoirs législatif et exécutif étaient réticents. En France, c’est l’inverse qui s’est produit: les pouvoirs publics, anxieux de moderniser les marchés financiers du pays, ont lancé une déréglementation que les financiers ont accueilli avec une certaine circonspection. Au Royaume-Uni, les autorités et les institutions financières britanniques et étrangères ont joint leurs efforts, en vue de préserver la prééminence internationale de la City de Londres. Le Japon, lui, a cédé aux instances des autorités américaines, qui voyaient dans la déréglementation un moyen de forcer l’ouverture des marchés nippons.
Les progrès de la déréglementation ont été, somme toute, remarquables. Désormais, la liberté de mouvement des capitaux entre les grandes zones économiques est totale. Les institutions financières peuvent fixer librement les taux d’intérêt qu’elles entendent offrir à leur déposants et à leurs emprunteurs. Preuve en est qu’elles deviennent commercialement plus agressives sur le plan: au Royaume-Uni, aux États-Unis, en France, des banques ont déclenché des guerres de taux pour gagner des parts du marché des dépôts ou des prêts hypothécaires. Le cloisonnement entre les différentes catégories d’intermédiaires a été réduit ou même éliminé —si bien que des catégories entières d’institutions financières ont perdu leur raison d’être, tels que les caisses d’épargne aux États-Unis ou les agents de change en France.
Certains observateurs pensent même que la déréglementation a privé le secteur bancaire de son rôle privilégié de collecteur d’épargne et de fournisseur de financement aux ménages et aux entreprises. Cette réduction du rôle des banques dans le financement de l’économie a reçu le nom barbare de « désintermédiation ».
La désintermédiation recouvre deux phénomènes distincts: la perte, par les banques, de parts de marché au profit de nouveaux intermédiaires financiers; et le remplacement du crédit bancaire comme moyen privilégié de financement par des produits et instruments négociables.
La déréglementation du secteur financier a attiré en effet de nouveaux entrants, notamment de grandes entreprises industrielles comme General Electric, de grands distributeurs comme Marks & Spencer ou Carrefour, ou des opérateurs de télécommunications comme ATT. Libres d’agir sans contraintes et disposant d’appuis financiers solides, les nouveaux venus peuvent souvent obtenir un financement meilleur marché que la grande majorité des banques, offrir donc de meilleures conditions à leurs clients et prendre aux banques des parts de marché. C’est ainsi qu’ATT a réussi à gagner en quelques mois 10 millions d’utilisateurs pour sa carte de crédit, lancée en mars 1990, devenant ipso facto le quatrième émetteur américain des cartes. Quant à General Electric Capital, il est d’ores et déjà numéro 1 du financement spécialisé aux États-Unis.
Mais les principaux agents de la désintermédiation sont sans doute les gouvernements, dont les obligations négociables ont supplanté en quelques années les prêts bancaires comme moyen principal de financement du déficit des finances publiques. De même, les entreprises utilisent de plus en plus fréquemment des billets de trésorerie pour financer leur fonds de roulement, ou des obligations pour investir à moyen et long termes.
Les liens entre la banque et son client, qui étaient intimes jadis, se détendent donc. Dans une opération traditionnelle de crédit, la banque est la contrepartie de l’emprunteur: le crédit reste inscrit à son bilan jusqu’à ce qu’il soit remboursé ou annulé. Dans les opérations sur les instruments négociables, la banque agit en revanche comme simple courtier: moyennant commission, elle trouve des investisseurs pour un placement ou des placements pour des investisseurs. Même lorsqu’elle détient une créance, cette détention est temporaire, le temps qu’il lui faut pour trouver un acquéreur. Les créances négociables, qui par définition peuvent être librement vendues ou achetées, ne figurent pas à son bilan.
La création monétaire change dès lors de nature. Lorsque les banques contrôlaient la collecte de l’épargne et les circuits de financement, elles étaient les principaux agents de la création monétaire, et les autorités les surveillaient étroitement. Or la désintermédiation, en perturbant ce schéma, rend le contrôle politique de la création monétaire beaucoup plus difficile.
L’importance de la désintermédiation varie d’une période à l’autre et d’un pays à l’autre (elle est plus grande, par exemple, aux États-Unis qu’en Allemagne ou au Japon), mais en tout état de cause le phénomène paraît devoir être durable.
Une hiérarchie sans cesse bouleversée. La hiérarchie de la géofinance est sans cesse bouleversée. Au début des années quatre-vingt, les grandes banques américaines étaient les leaders incontestés. Puis, dans les années 80, ce fut le tour des banques japonaises, dont on prédisait qu’elles allaient être la force motrice d’une « deuxième vague » de domination nippone. Mais aujourd’hui, le miracle japonais est terminé, et les banques japonaises, même si elles occupent les premières places du classement mondial par taille du bilan, doivent faire face sur leur marché national à d’énormes difficultés qui leur interdisent désormais d’aspirer à un rôle de premier plan sur le plan international. Au début des années quatre-vingt-dix, vint le tour des grandes banques européennes (Deutsche Bank, Barclays, Crédit Lyonnais), qui, jusqu’à la récession de 1993, conduisirent des politiques d’expansion tous azimuts, jusqu’à ce que la récession de 1993 ne les oblige à réduire leurs. A l’heure actuelle, enfin, le vent favorise les grandes banques agressives des petits pays (UBS et SBS en Suisse, ING en Hollande), qui cherchent en permanence à exploiter les opportunités planétaires, que ce soit à Londres, à New York ou à Moscou.
Les vedettes de la finance. On pourrait croire que la dématérialisation de l’argent, la mondialisation des marchés et la course à la taille critique réduit, en matière financière, le poids des personnalités. Il n’en est rien. Les hommes de la finance n’ont jamais été aussi puissants et importants. La technologie de l’information leur permet en effet de mobiliser rapidement d’énormes quantités de capital, grâce auxquelles ils font tomber les monnaies, secouent les entreprises traditionnelles, financent les rêves d’entrepreneurs ambitieux, construisant en quelques années des empires, qu’ils perdent souvent en quelques mois ou en quelques jours.
Les spécialistes des nouveaux instruments, les conseillers en fusion, en acquisition et en montages complexes, ont le vent en poupe. Les premiers ont le savoir-faire technique, fondé souvent sur des méthodes mathématiques et informatiques avancées. Les seconds ont accumulé un capital relationnel immense, qui leur permet d’identifier les opportunités et de créer un climat propice aux transactions. En période faste, ces « bricoleurs des fusées » et autres « faiseurs de pluie », comme on les appelle dans le jargon de Wall Street, enrichissent les firmes qui les emploient. Entre 1990 et 1992, une trentaine d’arbitragistes, à New York, Tokyo et Londres, sur un total de 8000 employés, ont généré 87% du profit de Salomon Brothers. Ces nouvelles vedettes de la finance demandent à être payées en conséquence: des dizaines, voire des centaines, de millions de dollars.
Un foyer de controverse. Omniprésence de l’argent, splendeur des sièges sociaux, rites savants ou ésotériques, jeux d’influence réels ou imaginaires, tout contribue à faire de la finance une nouvelle religion, pour reprendre l’expression forgée par Anthony Sampson.
Nombreux sont toutefois les politiciens, les chefs d’entreprise, les économistes et les commentateurs qui la considèrent pernicieuse, voire carrément maléfique. Ils soumettent le financier à un véritable tir de barrage, affectent de ne voir en lui qu’un rentier, vivant aux dépens de ceux qui travaillent, un prédateur, prêt à détruire des entreprises pour réaliser des gains à court terme, un escroc exploitant ses informations privilégiées aux dépens des petits épargnants.
En France, notamment, la finance a si mauvaise réputation et une image médiatique si exécrable, qu’il est difficile d’en trouver des défenseurs parmi les leaders d’opinion. Maurice Allais, Prix Nobel d’économie 1988, parle de « délire financier » aux effets « démoralisants ». D’autres, de « cancer financier ». Michel Albert, membre du Conseil monétaire de la Banque de France et essayiste influent, dénonce les dangers de « l’argent roi » et de « l’économie du casino ». François Mitterrand et Jacques Chirac, opposés sur pratiquement tous les sujets, sont toutefois d’accord pour dénoncer ceux qui « s’enrichissent en dormant ». Lionel Jospin, stigmatise la « spéculation financière internationale ». Alain Juppé donne aux agents de la finance anglo-saxonne qu’il accuse de comploter contre la France et sa monnaie le nom de « gnomes de Londres ».
Aux États-Unis, la légitimité de la finance est mieux acceptée: l’entrée en Bourse est, pour une entreprise, la consécration. Mais, outre qu’ils critiquent Wall Street d’être trop souvent obsédé par le court terme et les résultats financiers immédiats, de nombreux observateurs considèrent que le « gonflement financier » des années Reagan a fait de la finance non plus la servante mais la maîtresse de l’économie avec droit sur elle de vie ou de mort, développé un climat immoral d’argent facile, fait proliférer les rapaces, les parasites et autres fossoyeurs d’entreprises animés uniquement par l’appât du gain. Pour eux, il était inévitable que ces années-là se terminent par des scandales. Les titres de quelques succès de librairie consacrés aux grandes affaires financières américaines des années 1980 sont explicites: « Les barbares devant la porte », « Le bal des prédateurs », « Un nid de voleurs ».
Un univers opaque et méconnu. Ces réactions d’hostilité à la nouvelle finance sont d’autant plus grandes qu’on la comprend plus mal, et que l’on ne saisit ni ses objectifs ni ses finalités. Une méconnaissance surprenante si l’on considère la visibilité de la géofinance et de l’abondance d’informations à son propos. Rares sont les domaines qui sont suivis de manière aussi massive et permanente. Le volume disponible des chiffres, des indicateurs, des analyses et des informations est énorme.
De surcroît, la théorie financière a connu un essor important et occupe le devant de la scène depuis que Merton Miller, William Sharpe et Harry Markowitz, trois économistes américains, ont reçu ex aequo le Prix Nobel d’économie en 1990. Markowitz est le père de la théorie moderne de la gestion de portefeuille. A partir de ses travaux, Sharpe a formulé un modèle d’évaluation de la valeur des actions. Les travaux des deux hommes ont contribué au développement des techniques de gestion « passive », dont l’objectif est de se rapprocher autant que possible de l’indice général de performance d’un marché donné. Miller, quant à lui, a contribué, avec Franco Modigliani, à formuler des modèles d’évaluation de la valeur d’une firme. C’est à lui que les deux plus grands marchés de nouveaux instruments financiers, le Chicago Board of Trade et leChicago Mercantile Exchange, ont fait appel au lendemain du krach boursier d’octobre 1987 pour répondre aux violentes attaques dont ils faisaient l’objet. Son argumentation serrée a contribué à éloigner la menace d’une réglementation plus restrictive.
Et pourtant, la finance reste pour l’essentiel, je le répète, un monde opaque et méconnu. Les données qu’elle propose, certes abondantes, sont perçues cependant comme peu fiables; leur interprétation suscite donc des désaccords profonds. La finance reste d’ailleurs une boîte noire pour la science économique elle-même, dont les spécialistes sont incapables de se mettre d’accord, sur la définition de la monnaie, sur le niveau optimal des taux d’intérêt, sur l’impact réel des déficits publics sur l’activité économique, sur les facteurs déterminant les taux d’épargne et d’investissement, sur la manière de gérer les taux de change. Qui faut-il croire, par exemple? Alan Greenspan et Hans Tietmayer, présidents, respectivement, de la Réserve Fédérale américaine et de la Bundesbank, lorsqu’ils affirment que la réduction du déficit budgétaire américain fera monter le dollar? Ou Martin Feldstein de Harvard et Paul Krugman de Stanford, professeurs d’économie distingués pour qui elle entraînerait au contraire une baisse du dollar? [Nos lecteurs se rappelleront l’article de Paul Krugman: « La compétition économique entre nations? Une foutaise! », paru dans « Le Temps stratégique » No 65 de février 1995].
La monnaie restant un concept mal défini, la politique monétaire relève largement du pilotage à vue. Les mesures traditionnelles de la croissance monétaire, les célèbres M1, M2, M3 [voir encadré], perdent l’une après l’autre leur pertinence et leur pouvoir de prévision. En juillet 1993, Alan Greenspan a reconnu devant le Congrès que, M2 ayant été abandonné sans que l’on lui trouve un remplaçant digne de ce nom, il ne disposait plus d’outils fiables pour prédire l’évolution de la croissance et de l’inflation. En effet, dès que la Réserve fédérale annonce le choix d’un indice et d’objectifs quantitatifs, les intermédiaires financiers développent des stratégies qui rendent ces choix inopérants. Greenspan a donc cherché des indicateurs sur lesquels les intermédiaires ne puissent influer aisément, comme l’or ou les matières premières —une idée surprenante, si l’on considère qu’en dehors du pétrole et des produits agricoles, les matières premières représentent moins de 1% de la valeur des biens et des services produits aux États-Unis.
L’utilisation des indices monétaires permet un drôle de jeu du chat et de la souris. En Allemagne, la Bundesbank utilise un agrégat très large, M3 comme indicateur-clé pour sa politique. Ce choix a été critiqué tant par les banques allemandes que par les institutions internationales, l’OCDE par exemple, pour qui M3 peut être facilement déformé par des facteurs externes ou temporaires. La Bundesbank persiste néanmoins à utiliser le M3. N’empêche que, lorsque M3 a explosé en janvier et février 1994 (sa croissance sur une base annuelle ayant atteint 21.2% et 17.5%, respectivement, alors que l’objectif était de 4%), la Bundesbank a froidement informé les marchés qu’elle prendrait pas en considération les chiffres de M3 pour cette période. D’ailleurs le M3 a un très faible pouvoir de prédiction du M3: alors qu’entre 1991 et 1994, sa croissance a dépassé de manière significative les objectifs affichés par la Bundesbank, l’inflation, elle, a baissé.
La transparence et la pertinence des données dont disposent les établissements financiers ne sont guère meilleures. Les règles de la comptabilité et du reporting sont plus obscures et moins contraignantes dans le secteur financier qu’ailleurs. C’est ainsi, par exemple, que les banques suisses et allemandes peuvent cacher en toute légalité une partie de leurs profits et de leurs fonds propres, d’importance variable il est vrai, à tel enseigne qu’un investisseur moyen n’a aucun moyen de connaître la vraie situation financière d’une banque allemande, suisse ou japonaise, et ne peut procéder à aucune comparaison. La désintermédiation et le développement des nouveaux instruments financiers ont contribué à gonfler les activités hors bilan des banques, comptabilisées selon des règles floues.
La volatilité. La volatilité de la géofinance — la force, la fréquence et la rapidité des fluctuations de prix des instruments financiers — inquiète universitaires et gouvernements.
Les taux de change flottent depuis 1973. En 1980, la politique de gestion de la masse monétaire américaine a été modifié. Depuis lors, les taux de change ont perdu leur stabilité, aux États-Unis d’abord, puis dans les grands pays européens. Le marché des obligations, dont l’évolution est déterminée par le mouvement des taux d’intérêt, a cessé alors d’être le refuge de la veuve et de l’orphelin.
Après les taux de change et les taux d’intérêt, les actions commencèrent à connaître à leur tour des écarts spectaculaires et fréquents. Même les grandes valeurs, IBM, Citicorp ou Alcatel, symboles de solidité, connaissent désormais des écarts journaliers de 3% ou plus. Le krach boursier d’octobre 1987 a provoqué une baisse moyenne de 20% en un jour.
La volatilité de la géofinance pose un problème paradoxal. Elle est accusée de déformer la réalité économique, d’encourager la spéculation, de miner donc le commerce international et les stratégies d’investissement. Pourtant, elle perdure. Pourquoi?
Première explication: elle résulte de la tension persistante qui existe entre le système financier planétaire et les politiques économiques et monétaires nationales. L’argent circule beaucoup plus vite que les marchandises. Les décisions des opérateurs financiers sont beaucoup plus rapides que les décisions des responsables politiques. La volatilité mesure en quelque sorte l’ampleur du décalage et l’intensité des conflits entre les détenteurs d’actifs financiers et les autres agents économiques.
Mais cette réponse est insuffisante. Il faut aller plus loin. La volatilité accrue reflète en vérité la transformation du système financier qui, tout en conservant ses fonctions traditionnelles, est devenu aussi un formidable lieu d’échange de données et de jugements. Des armées d’analystes, d’économistes et de gestionnaires de portefeuille évaluent en permanence les données économiques passées et prospectives: évolution du Produit intérieur brut, de l’inflation et de la masse monétaire, résultats des entreprises. Leurs opinions et recommandations déterminent les décisions d’achat et de vente. Elles sont un jugement collectif sur la gestion économique d’un pays ou les perspectives de croissance d’une entreprise. Ce jugement contredit parfois les objectifs des États. Il en résulte de périodiques bras-de-fer entre gouvernements et banques centrales d’un côté, et marchés financiers de l’autre, sur les taux de change ou les taux d’intérêt. Ces bras-de-fer se terminent rarement à l’avantage des gouvernements. D’août 1992 à juillet 1993, les marchés financiers ont forcé la dévaluation de la livre sterling, de la lire italienne, de la peseta espagnole, puis imposé au Système Monétaire européen un flottement généralisé de ses monnaies, mettant ainsi en échec une politique d’intégration monétaire engagée solennellement une dizaine d’années plus tôt.
Ces jugements et ces décisions, instantané, massifs et mimétiques, portent sur la vente ou l’achat, en quelques secondes, de milliards de dollars. Et surtout, tout le monde vend ou achète en même temps et dans le même sens. Bien que tout le monde ait désormais accès à l’information, les marchés financiers vivent encore sous la coupe de dictatures d’opinion. Si bien que les grands investisseurs institutionnels et les intermédiaires financiers font tous les mêmes analyses, que ce soit aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne ou ailleurs et suivent les mêmes stratégies.
Lorsqu’un marché est dominé par des considérations commerciales classiques, il est relativement équilibré: pour chaque acheteur il y a, en principe, un vendeur, et vice versa. Dans un marché informationnel, en revanche, il peut y avoir plusieurs vendeurs pour un acheteur, et vice versa. La notion d’équilibre perd dès lors beaucoup de son sens. La motivation première des opérateurs financiers étant d’exploiter l’information disponible pour accroître leur profit ou de réduire leur risque, il court un grand risque s’ils décident d’aller à contre-courant du consensus informationnel. Si la plupart des analystes disent par exemple que les taux d’intérêt vont monter, il faut beaucoup de courage et de moyens financiers pour les jouer à la baisse. L’information se propageant très vite, celui qui veut en profiter doit agir avant les autres. D’où la frénésie des transactions dans les secondes et ou les minutes qui suivent l’annonce de données importantes, comme le déficit de la balance commerciale américaine ou un indice des prix. Le consensus informationnel évolue constamment, en fonction des données disponibles, de l’interprétation qui en est faite et des réactions provoquées par les consensus précédents.
Anxieux d’être toujours les premiers à réagir, les opérateurs pratiquent de plus en plus l’anticipation. Si bien que lorsque l’information officielle est donnée, les opérateurs réagissent à cette information qu’à l’écart entre cette information et ce qu’ils en attendaient. Les actions des sociétés qui annoncent une augmentation de leurs bénéfices pourront baisser si cette augmentation est inférieure à ce que prévoyaient les analystes. Autre exemple: les monnaies du Système monétaire européen se sont mises à flotter en juillet 1993 parce que les opérateurs s’attendaient à ce que la Bundesbank décide de réduire son taux d’escompte, et furent donc surpris lorsqu’elle n’en fit rien.
Une approche informationnelle de la volatilité explique à la fois ses excès et sa pérennité. Ses excès sont dus à la variété et à la variabilité des données, des opinions et des perceptions dans un univers d’abondance. Sa pérennité s’explique par le fait que le mécanisme des marchés offrent un moyen irremplaçable d’agréger, de présenter, de confronter et d’ajuster entre eux des points de vue très nombreux et très variés. Non pas que ce mécanisme soit infaillible, loin s’en faut. Les surestimations et sous-estimations y sont endémiques; elles déclenchent des corrections parfois brutales. Mais c’est parce que l’environnement économique évolue sans cesse, qu’il faut des mécanismes transactionnels permettant des ajustements de prix rapides. Les marchés financiers actuels remplissent cette fonction, puisque, même lorsque les écarts sont importants, ils assurent liquidité et continuité.
La montée des risques. La géofinance aggrave la fragilité du système financier. En interconnectant les marchés éloignés et en accélérant les flux entre eux d’informations et de transactions, elle exacerbe le risque systémique, le risque d’un effet domino qui, à partir d’un déséquilibre local, met en danger des marchés et des banques à l’autre bout de la planète. On se souvient que la faillite de Drexel Burnham Lambert, la célèbre société de Bourse, en janvier 1990 à New York, a sérieusement affecté la Banque centrale de Portugal, et CERA, une banque belge de taille moyenne.
L’effet domino explique aussi la faillite, en mars 1995, de Barings, la banque d’affaires britannique prestigieuse et bicentenaire, après que Nick Leeson, trader en produits dérivés à Singapour, se fût engagé dans des spéculations malheureuses sur les indices de la Bourse japonaises, accumulant des pertes proches d’un milliard de livres, bien supérieures aux fonds propres de la banque. Ce n’était d’ailleurs pas la première fois que Barings avait eu des problèmes. En 1890, des spéculations hardies sur des obligations argentines l’avaient conduite au bord de la faillite. Elle fut sauvée cependant par une intervention musclée de la Banque d’Angleterre. En 1995, en revanche, la Banque d’Angleterre a refusé d’intervenir. Un refus qui a valeur de signal, et pas seulement pour les banques anglaises. Désormais, une banque en difficulté ne pourra plus compter sur le soutien automatique et inconditionnel des autorités. Il leur faut donc gérer mieux leurs risques.
La création des mécanismes et des marchés de protection contre les risques financiers a paradoxalement contribué à l’aggravation de ces derniers. La sophistication croissante des instruments financiers, l’essor des marchés dérivés, dont la liquidité et la profondeur semblaient infinies, ont pu faire croire en effet que les risques financiers pouvaient être complètement maîtrisés désormais. D’où une illusion de sécurité et de gain à tous les coups qui a induit des comportements dangereux, des paris énormes sur l’évolution des marchés, des positions spéculatives massives. L’essor des fonds de couverture (ou hedge funds) en est la meilleure illustration. Ces fonds, réservés aux investisseurs disposant de moyens importants, interviennent sur tous les instruments et tous les marchés. Le plus connu d’entre eux, le Quantum Fund de George Soros, peut mettre plusieurs milliards de dollars sur un seul pari. Soros est réputé pour avoir contribué largement à la dévaluation de la livre sterling de juillet 1992 et gagné sur cette opération plus d’un milliard de livres en un jour. Les gains sont gigantesques, mais les pertes sont de même ordre. C’est ainsi qu’en 1994, Soros a perdu plus d’un milliard de dollars en spéculant sur la parité dollar-yen. Suite au krach obligataire de février 1994, d’autres gestionnaires de fonds de couverture ont fait faillite, qui avaient pourtant connu des années fastes avec des rendements annuels supérieurs à 20%. Risques aggravés par la complexité des nouveaux instruments financiers, que peu de spécialistes maîtrisent .
Illusion de sécurité et complexité des transactions: ce mélange explosif a provoqué des pertes spectaculaires à Chicago, à Londres et à Paris, dont ont été victimes tant de grandes entreprises industrielles, comme Procter and Gamble aux États-Unis ou Metallgesellschaft en Allemagne, que des autorités locales, par exemple municipalités, travaillistes de surcroît, au Royaume-Uni. Mais le cas plus spectaculaire est sans doute celui de l’Orange County, en Californie, un des comtés les plus riches des États-Unis, mis en faillite en décembre 1994 après des spéculations malheureuses sur les produits dérivés. Au cours des procès qui ont suivi certaines de ces pertes, les victimes ont souvent expliqué que, manquant de sophistication, elles ne se rendaient pas compte des risques encourus et avaient été induites en erreur par des banquiers trop astucieux. Cet argument, invoqué par des autorités locales anglaises, a convaincu les tribunaux britanniques. Aux États-Unis, il est au centre du procès qui est en cours entre Procter & Gamble et Bankers Trust d’une part, Orange County et Merrill Lynch d’autre part. L’offre d’innovations financières a d’évidence cru beaucoup plus vite que la capacité de les absorber et de les maîtriser.
La nouvelle finance, parce qu’elle dépend étroitement de la télématique et l’informatique, court d’autres risques encore: « le risque Tchernobyl », de paralysie par défaillance généralisée des systèmes et des réseaux, et « le risque Monte Carlo », d’une explosion des baisses ou des hausses par emballement planétaire, qui peut se produire lorsque les systèmes automatisés déclenchent des ventes ou des achats massifs, qui s’autoalimentent et font boule de neige.
Quelques pannes très rares des systèmes de paiement ont montré l’énormité du risque Tchernobyl, des débits de plusieurs milliards de dollars pouvant s’accumuler en quelques heures. Le krach d’octobre 1987 a fourni quant à lui une démonstration saisissante du risque Monte Carlo, l’effondrement total des marchés boursiers n’ayant été évité que de justesse.
Le problème le plus grave est cependant l’accumulation et la superposition des risques. L’avènement des nouveaux risques ne peut éliminer, en effet, les risques traditionnels, comme celui d’un mauvais crédit ou de la fraude. Le cas le plus spectaculaire est celui du Crédit Lyonnais, cette banque nationalisée française ayant accumulé des mauvaises dettes d’un montant sur lequel les experts sont en désaccord, situé entre 50 et 150 milliards de francs français. Les difficultés des banques japonaises sont dues pour l’essentiel, elles aussi, à la détérioration de leur portefeuille classique de prêts industriels et immobiliers. Dans le cas de Daiwa, dont les pertes sont estimées à 1,1 milliards de dollars, s’ajoutent à ces pertes classiques, les pertes dues à la fraude commise onze années durant par un seul homme, trader en obligations du Trésor américain.
L’accumulation des risques, la fréquence des krachs, l’ubiquité des crises financières donnent le vertige — et raison, apparemment, à ceux qui accusent la géofinance de tous les maux. On aurait tort, pourtant, de noircir exagérément son image. Élément de fragilité du système financier international, la géofinance est aussi un élément de sa solidité. En facilitant l’intégration économique mondiale, elle permet une mobilisation et une réallocation rapides des ressources. D’ailleurs, les indicateurs et les jugements des marchés se révèlent souvent, à long terme en tout cas, d’une remarquable justesse. L’innovation financière, utilisée à bon escient, élargit les possibilités de financement, améliore la gestion des risques et stimule le développement des entreprises innovatrices.
Malgré les crises, le système financier international continue de fonctionner et de soutenir, à sa façon, l’intégration économique de la planète. Malgré la volatilité des taux de change, le commerce international continue de croître plus vite que la production mondiale. La stagnation des flux d’investissements transnationaux après le krach d’octobre 1987 n’a été que temporaire. Le recyclage des surplus et des déficits mondiaux reste assuré.
Mais cette résistance du système, loin de rassurer, inquiète. Les krachs y sont devenus d’une trop grande banalité, la volatilité y trop généralisée, l’explosion des marchés dérivés y est trop forte. La finance, au lieu de mécanisme de stabilisation quasi-automatique, fait plutôt figure, désormais, de révélateur et d’amplificateur des déséquilibres.
Les défis de la géofinance. La géofinance pose aux autorités des problèmes complexes de supervision et de contrôle et menace la survie des institutions financières les mieux établies.
Dire que les autorités ont du mal à contrôler les nouveaux instruments, les intermédiaires et les marchés de la géofinance, est une litote. La maîtrise de la monnaie, instrument essentiel de la politique économique et attribut fondamental du pouvoir échappe aux instances officielles au profit d’une nébuleuse dont elles perçoivent mal les contours et la dynamique. L’indépendance des banques centrales, érigée désormais en dogme, peut-elle compenser le fait que les autorités n’ont plus de pouvoir sur les marchés?
Le contrôle des intermédiaires financiers devient de plus en plus complexe.
Au niveau national, faut-il traiter les banques et autres établissements financiers, comme n’importe quel autre secteur ou lui reconnaître au contraire une spécificité justifie d’un traitement particulier? Traditionnellement, on considère que la faillite d’une banque est beaucoup plus grave que la faillite d’une entreprise industrielle de taille équivalente. Elle provoque donc très souvent une intervention des pouvoirs publics. Le refus d’intervenir, comme dans le cas de la Barings, apparaît encore comme une exception plutôt que comme la règle. Faut-il alléger ou supprimer les contraintes (dépôt de réserves auprès de la Banque centrale, normes de capitalisation, etc.) qui pèsent sur les banques, ou faut-il plus imposer plutôt ces mêmes normes aux para-banques et quasi-banques créées par les entreprises industrielles et commerciales?
Dans le contexte international, ces questions sont encore plus difficiles, comme l’a montré la chute spectaculaire de la BCCI en 1991. Banque d’origine pakistanaise, avec un actionnaire principal du Golfe, siège social à Luxembourg et centre des opérations à Londres, la BCCI était inclassable, ce qui lui a permis d’échapper pendant de longues années à la surveillance des Banques centrales.
Traditionnellement, les marchés financiers s’autogèrent, sous l’œil attentif des autorités. Mais leur taille est telle, aujourd’hui, que cette manière de faire apparaît désormais obsolète. La mise en place des nouvelles structures de transaction et de surveillance s’avère cependant laborieuse. Alors que les grandes Banques centrales disposent, à travers le G-10 siégeant à Bâle, d’une structure de coordination bien rodée et capable de répondre rapidement aux crises, les organismes de surveillance des marchés boursiers commencent à peine à coordonner leurs efforts. La directive sur les activités des intermédiaires boursiers dans les pays de l’Union Européenne n’est appliquée que depuis le 1er janvier 1996 alors que celle sur les activités bancaires est en vigueur depuis 1990. Et que dire des difficultés continues de coopération, aux États-Unis et ailleurs, entre les marchés boursiers et les marchés des produits dérivés?
Périodiquement, des voix augustes s’élèvent pour réclamer une réforme d’ensemble du système financier international et des mesures particulières pour ramener la stabilité et éliminer les excès. Puisqu’on ne peut accélérer la circulation des marchandises, certains proposent, selon l’expression de James Tobin, Prix Nobel d’économie, reprise en France par Jean Peyrelevade (et Lionel Jospin lors de sa campagne présidentielle), de jeter des « grains de sable » dans les rouages trop performants de la géofinance —en introduisant par exemple une taxe sur les transactions financières à caractère spéculatif. La théorie du grain de sable est séduisante, mais pose un problème sérieux de calibrage. Si le « grain » est trop petit, il risque de n’avoir aucune influence, s’il est trop fort, il risque de provoquer des évasions de capitaux.
Force est de constater en tout cas que, depuis trente ans, aucun projet de réforme d’ensemble n’a abouti. Cet échec reflète le désarroi intellectuel provoqué par l’émergence de la géofinance. Sa dynamique est déroutante, en effet: autrefois pilier de stabilité, aujourd’hui foyer actif de volatilité; hier servante docile, aujourd’hui maîtresse exigeante et capricieuse; jadis emblème matérialiste, aujourd’hui phénomène dématérialisé. Nombre de responsables économiques et politiques refusent pour cette raison de reconnaître sa légitimité, et la prennent pour une aberration.
Il est impossible cependant de revenir en arrière. On ne peut plus fermer les frontières ou déconnecter les ordinateurs. Et pourquoi le ferait-on, puisque l’économie ne cesse de se mondialiser, que le commerce international ne cesse de croître plus rapidement que la production mondiale, et que les investisseurs privés ont réussi à prendre le relais des fonds publics défaillants afin de financer le développement de l’Amérique latine, de l’Asie et de l’Europe centrale? La géofinance participe, par son essor, à l’évolution de l’économie vers l’immatériel. La contrepartie ultime de la nouvelle monnaie n’est plus la marchandise physique, facile à identifier et à manipuler, mais l’information, insaisissable, impalpable, abondante, volatile.
ADDENDA
LES DÉFIS DE LA GEOFINANCE
Les banques devront s’adapter ou mourir
Note sur une révolution culturelle annoncée
La géofinance ne laisse guère de choix aux établissements financiers que de s’adapter ou mourir. Les banques, affligées d’une surcapacité énorme et d’une rentabilité incertaine, en sont toutes, aujourd’hui, à s’interroger sur leur raison d’être.
Difficultés des unes, volonté expansionniste des autres, les pressions de consolidation sont devenues irrésistibles. Aux États-Unis, les fusions et regroupements à grande échelle ont commencé entre banques régionales du centre-ouest et du sud du pays, avant de s’étendre aux grandes banques de Californie (Bank of America et Security Pacific) et de New York (Chemical Bank, Manufacturers Hanover et Chase Manhattan). Au Japon, quelques fusions ont pris place entre banques de premier rang. L’Europe, elle, se contente pour l’instant de fiançailles plutôt timides (participations minoritaires croisées et accords de coopération) ne modifiant pas la structure fondamentalement morcelée du marché européen. Seule opération internationale d’envergure, l’acquisition, en 1992, de Midland, la quatrième banque anglaise, par la Hongkong Shanghai Bank, qui suggère que la géofinance est en train de prendre le pas sur l’eurofinance. L’intégration de l’espace financier européen ne peut que s’accélérer.
Les nouveaux supermarchés de la finance
En vérité, les banques sont en train de vivre une véritable révolution culturelle. Elles ont perdu le statut particulier que leur assurait contrôle quasi-exclusif de la monnaie scripturale et du crédit. Pourront-elles garder leur position dans le monde désintermédié de la monnaie électronique et informationnelle? Toutes s’efforcent d’élargir la palette de leurs produits et de leurs activités. L’idée est de dépendre moins de la marge financière (différence entre les intérêts payés et les intérêts reçus) et d’accroître les revenus des commissions. Les banques se convertissent ainsi en prestataires de services financiers. Les cloisons étanches entre les produits et les catégories d’intermédiaires sont en train de disparaître. Aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, se créent de véritables supermarchés de la finance, offrant crédit, courtage, assurance, placement, leasing, conseil, prêts hypothécaires, cartes de crédit, chèques de voyage, etc. Les Allemands parlent de l’Allfinanz, les Français et les Suisses de la bancassurance. Les services financiers sont un vaste chantier dont le périmètre est sans cesse déplacé. Longtemps cloisonnés et protégés, ils s’ouvrent désormais à la concurrence. Les banques envahissent l’assurance, en particulier l’assurance-vie, mais doivent, dans le même temps, résister à l’assaut de grands distributeurs, comme Marks & Spencer ou Les Galeries Lafayette; de gestionnaires de portefeuille, comme Fidelity ou Robeco; de grandes sociétés de Bourse, comme Merrill Lynch. Les services financiers de sociétés industrielles comme General Electric, Ford ou Renault, contribuant souvent plus de 20% à leur profit total.
La force résiduelle des banques
La notion de « services financiers » consacre une telle banalisation de la banque, que certains pronostiquent sa fin prochaine. Pour ma part, je pense, comme l’aurait dit Mark Twain, que l’annonce de cette mort est prématurée. Les banques ne sont pas dépourvues d’atouts dans le nouveau paysage: elles entretiennent des contacts fréquents, récurrents et variés avec les entreprises et les ménages. Les plus grandes d’entre elles grandes banques ont plusieurs millions de clients, avec lesquels il leur arrive de communiquer plusieurs fois par jour. Elles disposent là de véritables trésors de données sur les entreprises et les ménages, qui s’étendent bien au-delà de leur seule situation financière. Leur système de distribution est très diversifié: agences avec guichets, automates spécialisés, réseaux de télécommunication vocale et de télématique, et elles couvrent une grande variété de fonctions: recueil et transmission d’informations, transactions simples et complexes, standardisées ou sur mesure. Elles ont peut-être changé de métier, mais restent néanmoins capables de tirer parti des changements mieux que quiconque.
Preuve en est qu’elles ont réussi à établir des positions concurrentielles fortes sur des segments aussi variés que les cartes de crédit, les fonds de placement, l’assurance-vie ou les marchés financiers. Seules leur donnent du fil à retordre certaines entreprises qui pratiquent les services financiers depuis longtemps, comme les grandes sociétés américaines de Bourse comme Merrill Lynch, les sociétés financières spécialisées comme GE Capital, ou dépendantes des grandes chaînes de distribution comme Marks & Spencer.
En fait, la désintermédiation a provoqué moins une réduction du rôle des banques qu’une redistribution interne de leur portefeuille de produits et une restructuration de leur bilan —lequel est désormais plus liquide, les prêts non liquides ayant été remplacés par une dette négociable, et plus solide, les fonds propres ayant été considérablement renforcés. Lorsque les ménages réduisent la part des dépôts à vue dans leurs actifs financiers, ils le font au profit de fonds de placement et de SICAV, gérés par les banques. Et lorsque les gouvernements français et belge décident, pour financer leur dette, de remplacer les consortia bancaires par les Spécialistes des Valeurs du Trésor (SVT), les principaux de ces SVT sont banques.
Celles qui vivront, celles qui mourront
Avant de proclamer la victoire des banques, il faut introduire néanmoins quelques notes de précaution. D’abord, le fait que les banques disposent d’un avantage concurrentiel ne diminue en rien la nécessité dans laquelle elles se trouvent de rationaliser leurs activités, afin de résister aux concurrents « extérieurs ». Mais si l’on peut parier que les banques seront les principales bénéficiaires de la bataille des services financiers, il est également certain qu’elles fourniront le plus gros contingents de victimes. Seules survivront, triomphales, les meilleures.
Par ailleurs, quiconque entend donner des services financiers doit assumer plusieurs métiers: courtiers, contreparties, conseillers, prestataires de services. Le potentiel des conflits d’intérêts internes entre ces différents métiers est important. Et il est délicat pour une banque de jouer le rôle de conseiller financier d’une entreprise tout en finançant un acquéreur hostile, ainsi que cela est arrivé à plusieurs banques américaines dans les années quatre-vingt. Le gestionnaire de portefeuille faisant partie d’un groupe intégré doit-il chercher, pour exécuter ses transactions, le courtier le moins cher et le plus efficace, ou utiliser systématiquement le courtier « maison »? Afin d’éviter ce genre de conflits, autorités et entreprises tendent à introduire des sauvegardes appelées « murailles de Chine », visant à séparer les activités et les métiers potentiellement conflictuels en restreignant entre eux les flux d’information, voire les contacts. Ces restrictions mettent évidemment en question l’intégration d’activités qui fonde la notion même de service financier.
Les client seraient-ils finalement rois?
La technologie donne de surcroît au client les moyens de mettre en concurrence plusieurs services financiers, de choisir entre eux, et donc de ne plus dépendre d’une seule banque. Cette tendance va également contre la logique du fournisseur privilégié « tout compris ». A cette poussée d’indépendance de leurs clients, les banques répondent en développant des activités pour leur propre compte. Leur accès privilégié à l’information leur offre des opportunités, nombreuses mais souvent éphémères, d’investissement et d’arbitrage potentiellement profitables. Doivent-elles les indiquer à leurs clients ou les saisir elles-mêmes ? On constate en tout cas que leurs activités pour compte propre se développent fortement et représentent souvent une part substantielle de leurs profits. En 1992, par exemple, l’arbitrage sur les marchés de change représentait 40% du profit des banques américaines. Dans les grandes banques d’affaires comme Salomon Brothers ou Morgan Stanley, les activités de trading pour les clients servent de support au trading pour le compte propre.
De l’extrême vertu des réseaux capillaires
La rigueur de la gestion, la qualité des équipes, la cohérence de la stratégie, la sûreté de l’exécution, sont désormais, pour les banques, les variables essentielles et déterminantes de leur succès. Entre elles, plus de hiérarchies préétablies. Leur univers est plein d’anges déchus et de phénix ressuscités. La Bank of America, qui était dans les années soixante-dix la plus grande banque du monde et une gagnante indiscutable, s’est retrouvée dans les années quatre-vingt au bord de la faillite, puis a rebondi, après un changement radical de direction. La Lloyds Bank, qui était au début des années quatre-vingt la plus petite et la plus vulnérable des quatre grandes banques britanniques de dépôt, a mieux pris que ses concurrentes le virage des services financiers, d’où une performance économique et une valorisation boursière meilleures que celles de ses rivales. La Lloyds Bank a su réconcilier une plus grande sélectivité — elle a abandonné l’international et les grandes entreprises pour se concentrer sur les ménages — avec un élargissement de son portefeuille des produits, en direction notamment de l’assurance-vie. La Lloyds cherche désormais à capitaliser sur son succès à travers une série de fusions-acquisitions. Après avoir absorbé au début de 1995 une grande caisse d’épargne, Cheltenham et Gloucester, elle a annoncé en octobre 1995 sa fusion avec une grande banque à réseau, TSB. Cette fusion fera d’elle la plus grande banque d’Angleterre pour particuliers. Son succès montre que si la finance s’est aujourd’hui bel et bien transformée en géofinance, la proximité et la capillarité des réseaux de distribution constituent néanmoins un atout essentiel dans la grande bataille des services financiers. Ce que confirme, aux Etats-Unis, le succès des banques régionales, ou en France, celui des banques à réseaux comme le Crédit Agricole.
C.G
Glossaire
1. La monnaie
Monnaie d’échange. Si vous voulez une pomme et que n’en ayez pas dans votre cave, il vous faut trouver quelqu’un qui accepte de vous abandonner sa pomme en échange de quelque chose. Au cours de l’histoire, ce quelque chose a été tantôt des perles, des coquillages, des hameçons, du blé ou tout autre objet utilisé comme « monnaie d’échange ».
Monnaie métallique. La monnaie-objet présente cependant de sérieux inconvénients: les perles se cassent, le blé pourrit… Les Égyptiens résolurent le problème au 26e siècle avant Jésus-Christ en inventant les premières monnaies métalliques: durables, portables et que l’on pouvait subdiviser en pièces plus petites, utiles pour les achats modestes.
Papier-monnaie. La premier papier-monnaie connu a été le « kwan » chinois émis par la dynastie Ming entre 1368 et 1399. A l’heure actuelle, cette monnaie, dite fiduciaire parce que fondée sur la confiance accordée à celui qui l’émet, prend la forme de « billets de banque » émis par les diverses Banques nationales.
Monnaie scripturale. Le volume de la monnaie fiduciaire en circulation est infiniment moins important que celui de la monnaie appelée scripturale, parce que générée par les mouvement d’écritures (électroniques de plus en plus souvent) des comptes courants bancaires.
La masse monétaire est l’ensemble des différents monnaies en circulation sur un territoire donné.
Les agrégats monétaires sont les différentes catégories de monnaie et d’actifs liquides de la masse monétaire. Ceux-ci comprennent la masse monétaire au sens strict (M1) et les différents actifs financiers, plus liquides (M2) ou moins liquides (M3).
- M1 comprend les actifs liquides: monnaie, billets, dépôts à vue en francs
- M2 comprend M1 plus les comptes sur livret (épargne, etc.) ainsi que les placements à vue non utilisables immédiatement
- M3 comprend M2 plus les placements monétaires en devises, les placements à terme non négociables, les titres de créance négociables émis par les établissements de crédit, bref tous les instruments financiers qu’il n’est pas facile de convertir rapidement en argent liquide.
2. Les indices
Les indices boursiers sont des moyennes calculées sur les cours d’un certain nombre de valeurs que l’on estime représentatives de l’évolution générale du marché. Moyennes simples (comme le Dow Jones) ou moyennes pondérées (comme le Standard & Poor’s 500), les indices jouent le rôle de baromètres des marchés boursiers.
L’indice Dow Jones est le plus connu des indices boursiers. A sa création, en 1884, par Charles H. Dow et Edward D. Jones, le Dow Jones Industrial Average était fondé sur la moyenne simple du cours des actions de 11 grandes entreprises américaines (20 en 1916, et 30 depuis 1928). Publié à l’origine dans un petit journal financier ancêtre du Wall Street Journal., le Dow Jones clôtura sur une baisse de 12.8% lors du krach historique du 29 octobre 1929, et de 22.6% lors du krach du 16 octobre 1987. Le Dow Jones reflète bien l’évolution des valeurs américaines de premier ordre ou blue chips : ATT, Eastman Kodak, General Electric et autres NCR.
Il est d’autres indices boursiers: le Standard & Poor’s 500 de New York (indice de 500 valeurs américaines), le Nikkei de Tokyo (225 valeurs), le Footsie de Londres (100), le CAC 40 de Paris (40), le Swiss Performance Index ou SPI de Zurich (362). Outre ces indices généraux, il existe des sous-indices (du Dow Jones, du Standard & Poor’s 500, du SPI, etc.), qui reflètent les différents segments du marché: par branches (industrielles, transports, finances) ou par catégories de titres (actions au porteur, nominatives, bons de participations).
3. Les taux
Taux d’intérêt. Le niveau des taux d’intérêt sont fixés par les autorités monétaires en fonction de leur objectif final de croissance économique interne. L’intérêt est la rémunération du capital prêté que l’emprunteur verse au prêteur. Son taux dépend des conditions du marché, de la longueur du prêt (taux longs, taux courts) et de la réputation de l’emprunteur. Il existe plusieurs taux de l’intérêt.
Taux de change. Les taux de change des monnaies varient en fonction des taux d’intérêt pratiqués dans les pays concernés. Si le pays A hausse ses taux d’intérêts, des capitaux étrangers vont aussitôt affluer, en quête de placement plus rémunérateur. La monnaie du pays devient plus recherchée et tend donc à s’apprécier sur le marché des changes. Inversément, si le pays A baisse ses taux d’intérêt provoque, le taux de change de sa monnaie (moins recherchée) baissera.
4. Les instruments dérivés
Les instruments dérivés sont des instruments financiers que l’on acquiert pour s’assurer contre de fortes variations de cours. On lira dans ce numéro, à leur propos, l’article de Martin Baker, « Dans l’univers de la finance, rien n’est calcul, tout est intuition! » Ces instruments sont appelés « dérivés » parce qu’ils sont fondés sur le cours d’autres instruments financiers (actions, obligations) ou d’autres biens (matières premières), et qu’ils « dérivent » donc leur valeur de la valeur de ces autres actions, devises ou matières premières « sous-jacentes ». Comme on peut acquérir des instruments dérivés en ne s’acquittant que d’un faible dépôt (de l’ordre de 5%), ils ont un effet de levier important et peuvent conduire très vite à des gains ou à des pertes considérables.
Les pères spirituels des instruments dérivés sont mathématiciens. En 1973, Fischer Black, physicien et mathématicien formé à Harvard, et Myron Scholes, économiste du Massachusetts Institute of Technology (MIT) publiaient dans le Journal of Political Economy un article (« The Pricing of Options and Corporate Liabilities ») où ils démontraient leur fameuse équation de Black-Scholes, qui fournit des outils précis de calcul des risques financiers des marchés à options. Cette formule fut unanimement appréciée pour son élégance mathématique, mais elle commence aujourd’hui à être critiquée pour ses effets euphorisants sur les marchés. Parce qu’elle postule que l’incertitude est maîtrisable, elle rassure intellectuellement ceux qui pratiquent le jeu souvent dangereux des instruments dérivés.
5. D’autres termes et noms cités
Le G10 est le « club » des banques centrales des grandes puissances monétaires. Il compte en fait onze pays (les Etats-Unis, l’Allemagne, l’Angleterre, le Japon, la France, le Canada, l’Italie, la Suède, les Pays-bas et la Belgique, plus la Suisse qui y dispose d’un statut spécial).
SICAV signifie Société d’investissement à capital variable. Il s’agit d’un produit financier français. On distingue, selon la nature des investissements réalisés, les SICAV d’obligations, les SICAV d’actions, les SICAV investies à court terme, les SICAV de trésorerie, et selon la politique de distribution menée, les SICAV de capitalisation et les SICAV de distribution. Les SICAV sont dites de court terme lorsqu’elles sont destinées aux placements liquides, et « monétaire » lorsque leur capital est investi en produits financiers à courte durée, rémunérés au taux du marché monétaire avec un régime fiscal approprié.
L’arbitragiste est un opérateur exploitant les différences de prix ou de cours d’un même bien ou instrument sur différents marchés. Il achète là où les prix sont bas pour vendre là où ils sont élevés. Pour tirer un profit de distorsions de prix souvent faibles (1/16 ou 1/32 de dollar par exemple), l’arbitragiste doit négocier simultanément de très nombreux contrats.
George Soros est un spéculateur américain d’origine hongroise spécialisé dans la gestion des « hedge funds » ou fonds de couverture. Né à Budapest en 1930, il s’est installé en Grande-Bretagne en 1947 où il a étudié l’économie, puis s’est rendu aux Etats-Unis en 1956. George Soros a écrit entre autres The Alchemy of Finance (Simon & Schuster, 1987), Opening the Soviet System (Weidenfeld & Nicholson, 1990),Underwriting Democracy (The Free Press, 1991), Ideas and Actions (Wiley and Sons, 1995).
C.G
Pour ne point trop dériver
Introduction aux marchés financiers
Les marchés financiers, par Jean Saint-Geours. Paris, Flammarion, collection Dominos, 1994.
La planète bourse, de bas en hauts, par Michel Turin. Paris, Gallimard, collection Découvertes, 1993.
« Dossier sur les marchés financiers ». In: Futuribles, Paris, No 192, novembre 1994.
Monnaie Monnaies, par Michèle Giacobbi et Anne-Marie Gronier. Paris, Marabout, Le Monde-Editions, 1994.
Guides pratiques pour baguenauder dans les marchés financiers
Guide to understanding money & markets, par Richard Saul Wurman, Alan Siegel et Kenneth M. Morris. New York, The Wall Street Journal, 1990.
Guide bancaire et financier, par Marian Stepczynski et Michael Wyler. Lausanne, l’Hebdo, 1991.
Lexique boursier, petit vocabulaire de la bourse. In: « Cahiers du Crédit Suisse », No 36. Zurich, 1992.
Dossier: les produits dérivés, Tribune Finance in: Tribune de Genève, Genève, 8 novembre 1995.
Comprendre (enfin) les nouveaux instruments financiers, par Pierre Novello. Genève, Journal de Genève & Gazette de Lausanne, 1995.
A propos de géofinance
« La finance internationale / sauvageonne dangereuse que nul n’apprivoisera jamais? » Par Charles Goldfinger. In: Le Temps stratégique, No 31, hiver 1989-90.
A propos des crises de liquidités et d’insolvabilité
« Les dettes bancaires des pays de l’Est et du tiers-monde, une goutte d’eau dans l’océan financier international! » par Philippe de Weck. In: Le Temps stratégique, No 1, été 1982.
« Sauver les banques qui ont prêté au tiers monde? Surtout pas! » Par Karl Brunner. In: « Le Temps stratégique », No 10, automne 1984.
A propos des mutations bancaires
« Pour les banques internationales c’est la révolution! » Par Richard O’Brien. In: Le Temps stratégique, No 21, été 1987.
« Le voile mystique qui recouvrait jadis la banque a disparu », par David Lascelles. In: Le Temps stratégique, No 35, septembre 1990.
« Pauvre Martin, pauvre banquier… » Par Klaus Jenny. In: Le Temps des Affaires, No 51, mars 1993.
A signaler la naissance, à Genève, d’un Observatoire de la Finance dont secrétaire-général de l’Observatoire est Paul Dembinski, économiste, qui avait publié dans « Le Temps stratégique » No 16 du printemps 1986 « Les milliards dépensés par les militaires sont-ils du gaspillage? » L’Observatoire édite un bulletin, Finance et Responsabilité, dont le No 1 est paru en novembre 1995 (32, rue de l’Athénée, 1206 Genève, tél. 022/346 30 35, fax 022/789 14 60).
C.G