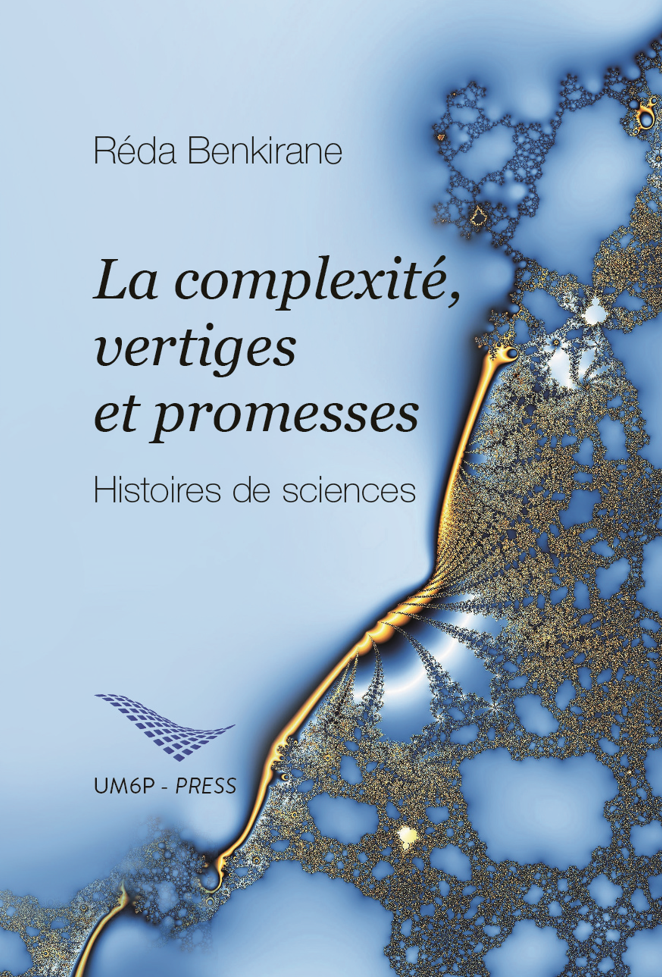SOCIÉTÉ
A Tchernobyl
les hommes, les animaux, les plantes
vivent mieux qu’avant le désastre
Par Eric Voice
Eric Voice, docteur ès sciences, spécialiste en biochimie, radio-chimie et physique nucléaire, a visité Tchernobyl pour le compte de l’Académie russe des sciences, de l’Université d’Essex et du Comité pour l’étude du cheminement biogéochimique des radionucléides dans l’environnement. Consultant indépendant, auteur de très nombreux articles, Eric Voice est connu en Grande-Bretagne pour s’être fait injecter volontairement un isotope du plutonium pour en étudier in vivo les effets sur le métabolisme.
 Au printemps, Tchernobyl est irrésistible. Assis dans les bois, je prends le soleil. Pissenlits et tussilages piquent l’herbe brillante, un pommier sauvage est en fleurs, pins et bouleaux argentés portent déjà leur feuillage d’été. Au sommet d’un arbre, une cigale lance son chant
Au printemps, Tchernobyl est irrésistible. Assis dans les bois, je prends le soleil. Pissenlits et tussilages piquent l’herbe brillante, un pommier sauvage est en fleurs, pins et bouleaux argentés portent déjà leur feuillage d’été. Au sommet d’un arbre, une cigale lance son chant
Paradis terrestre? Le crépitement de mon petit compteur de Geiger rompt le silence, révélant, tout autour de moi, un océan de radiations. Cinq microsieverts par heure, cinquante fois la radiation moyenne d’une forêt en Suisse ou en France.
A travers les arbres, j’aperçois le village de Tchernobyl, et plus loin la ville abandonnée de Pripyat, proche des six réacteurs nucléaires. Je me trouve dans la tristement célèbre « zone d’exclusion » de Tchernobyl, un cercle de trente kilomètres de rayon autour du réacteur détruit le 26 avril 1986. Après l’explosion, les niveaux de radioactivité étaient si élevés dans cette zone que toute la population en fut évacuée. Je me trouve au cur même de la zone dont les media de la planète entière – radios, journaux, télévisions – disent depuis des années, je cite ici un journal londonien de 1994, que « pas un être humain n’y survit, pas un oiseau n’y chante » et que « ses forêts sont rabougries et les animaux y naissent avec d’horribles mutilations ».
Je m’enfonce dans la forêt. Je suis maintenant sous la trajectoire suivie plusieurs jours durant par le nuage radioactif produit à l’époque par le réacteur en feu. Le niveau de radiations y est vraiment élevé. Certains jeunes sapins ont une drôle d’allure: ils ne ressemblent plus guère à des arbres de Noël, leur sommet est plus large que leur base, parce que les radiations, à doses non-léthales, stimulent la croissance des plantes.
J’arrive à la « Forêt Rouge », à deux ou trois kilomètres du réacteur détruit, site qui a absorbé, au moment de l’accident, la plus grande densité de particules radioactives. En 1986, la radioactivité y était si intense qu’elle tua les feuilles des arbres -mais pas les aiguilles des pins, plus résistantes. Les feuilles, avant de tomber, devinrent d’un rouge brillant (« superbe, juste comme en automne », devait me déclarer plus tard, avec un sourire désabusé, un employé de la centrale). Le plutonium était si abondant que l’armée rasa la forêt et enterra les troncs au bulldozer. Aujourd’hui, les arbres sont en train de repousser; ils atteignent déjà un à deux mètres de hauteur.
Je repère sur le sol sablonneux de nombreuses empreintes. Des lièvres notamment, lesquels s’enfuient à travers les broussailles à mon approche. D’élans aussi, beaucoup plus grandes, sabots fendus. Plus loin, les traces confuses d’une famille de sangliers. Depuis que les hommes l’ont abandonnée, la « zone d’exclusion » est devenue une réserve de vie sauvage. Un rapport, publié chaque année par le Centre International de Recherche à Tchernobyl, montre que certaines populations animales y sont aujourd’hui dix fois plus nombreuses qu’en 1986. Il estime que vivent actuellement, dans la zone des trente kilomètres, 3000 renards, 600 élans, 450 chevreuils, 40 loups et quelque 3000 sangliers. Avant l’accident, les sangliers, sur-chassés pour leur chair délicate, avaient pratiquement disparu de la région.
Lorsque les gens furent évacués, la plupart des animaux domestiques, gravement contaminés, furent abattus. Quelques-uns en réchappèrent cependant. Dès que des recherches scientifiques systématiques devinrent possibles, on créa pour eux, dans la zone d’exclusion, deux fermes expérimentales. Dans celle que je visite, à quelques kilomètres du réacteur détruit, je trouve un troupeau composé d’une trentaine de vaches et d’un taureau (nommé « Uranium »!), appartenant à la troisième génération après l’accident. Ces animaux ont été nourris de fourrage hautement radioactif, cultivé spécialement dans la zone d’exclusion. Ces descendants du troupeau « originel » ne semblent souffrir pour l’instant d’aucun trouble particulier, sanitaire ou physique. Même constatation pour les descendants des porcs, des chèvres, des chiens, des renards, des visons et des nombreuses autres espèces élevées au même endroit.
Avant l’accident, le plus grand centre de population de la zone était Pripyat, une ville de plus de 40’000 habitants, construite pour accueillir les travailleurs appelés pour construire et faire fonctionner les six réacteurs, situés deux kilomètres plus loin. Se promener dans cette ville est une expérience étrange. Les rues sont vides et silencieuses. Les portes des immeubles de cinq étages sont grandes ouvertes, les rebords de fenêtres et les toits couverts sont couverts d’herbes folles. Des couvertures et des meubles, des cuisinières et des réfrigérateurs, ont été éparpillés par des pillards, qui ont pénétré de nuit dans la zone interdite. Les rues sont dégagées, mais tout le reste est envahi par la mauvaise herbe locale, l’absinthe, Artemisia absinthium,haute d’un mètre. En russe, armoise se dit « Tchernobyl ».
Vide, silence… Mais pas tout à fait. Les habitants évacués en 1986 n’avaient pas été autorisés à emmener leurs chats domestiques avec eux. Depuis lors, la population féline de Pripyat a explosé. Sauvage, craintive, elle se terre au moindre bruit suspect dans le Grand Hôtel du Parti Communiste, dans le Centre Sportif ou dans les immeubles abandonnés.
Avant la catastrophe, quelque 130 000 personnes vivaient dans la zone d’exclusion: 135 000 furent évacuées, mais 2000, qui vivaient là bien avant la construction des réacteurs et possédaient un petit lopin, refusèrent obstinément de s’en aller. Faute d’emploi, ou parce que personne ne voulait de leurs récoltes, nombre d’entre elles finirent par s’en aller quand même. Si bien qu’il ne reste, aujourd’hui, dans la zone d’exclusion, que 700 habitants.
Je me rends avec mon interprète, Irene Zhilinskaya, dans le petit village d’Opachichi, l’un des 74 villages qui ont été évacués après la tragédie. Les buissons commencent à couvrir les maisons abandonnées, les jardins sont redevenus sauvages, les vergers sont touffus et impénétrables. Une seule maison est habitée, propre et bien rangée. Nous y sommes reçus par Olga Kusherenko, sa propriétaire, après qu’Irène l’eût assuré que je n’étais ni un fonctionnaire du gouvernement, ni un gradé de l’armée, de la police ou du KGB. Olga me gratifie d’un sourire timide: « Ah, vous venez du monde capitaliste? »
Le soleil filtre à travers le verger, poules et poussins grattent la poussière, des tulipes tardives ornent l’entrée. Olga vit avec sa mère. Toutes deux sont nées dans cette maison et y ont grandi. Elles disent ne pas comprendre pourquoi l’on fait un tel foin avec l’affaire. Oui, elles ont été évacuées, il y a un bon bout de temps, en 1986: « Le jeune soldat qui avait frappé à notre porte nous dit: Voilà, il y a là un bus, montez dedans, vous n’avez le droit d’emporter que ce que vous pouvez tenir dans vos bras. Il ne nous pas expliqué pourquoi. Nous n’avions jamais quitté la maison auparavant. Nous n’avons pas aimé ça. Alors nous sommes revenues à pied. Ca nous a pris deux semaines, nous avons marché tout le temps dans la forêt, pour éviter les gardes. »
Olga dit avoir 61 ans, sa mère en a 80. Non, sa mère n’est pas là pour l’instant; il fait beau, elle est allée travailler leurs champs. Un tracteur? Ne dites pas de bêtises. Pas non plus de cheval, non, ni de charrue. « Dans cette région, loin des fermes collectives, loin de tout, nous avons toujours cultivé nos champs à la main. » Olga et sa mère, avec leur porc, leurs poulets, leurs pommes de terre, leurs légumes et leurs arbres fruitiers, semblent vivre en complète autarcie. Olga ne se plaint que d’une chose: ses voisins sont tous partis, elle ne sait à qui parler. « Mais je vais bien. Dites, j’ai l’air bien, n’est-ce pas? ».
Le niveau de radiations gamma autour de la maison d’Olga et de sa mère varie entre 0.5 et 1.0 microsievert par heure, soit cinq fois la radiation naturelle moyenne de pays comme la Suisse ou la France. Le niveau de plutonium y dépasse 0.1 curie par kilomètre carré.
Un moment plus tard, Olga nous invite à entrer dans la maison. Les fenêtres sont petites, il fait sombre. Peu à peu, je parviens à distinguer les murs, qui sont tapissés de pages de magazines, des bouquets de lilas dans chaque pièce et un autel avec ses icônes et sa lampe allumée. Partout des broderies, au mur, encadrées comme des peintures, ou sur les meubles, qui figurent des fleurs, des animaux, des paysages, des dessins géométriques; certaines sont anciennes, d’autres sont des propres mains d’Olga. Avec son accord, je prends quelques photos. Sans penser, je lui fais compliment d’une broderie représentant un bouquet de lilas; elle l’arrache de son cadre, l’enveloppe dans un prospectus de propagande électorale qu’on vient de glisser sous sa porte (« Oh! non! Plus de politique! ») et m’en fait cadeau. Une générosité spontanée, sans cesse présente en ex-Union soviétique. Olga nous embrasse chaleureusement, nous dit adieu, puis continue à nous faire de grands signes de la main jusqu’à ce qu’elle nous perde de vue.
Olga Kusherenko paraît en éclatante santé. Mais qu’en est-il des autres habitants de Tchernobyl? Chaque jour, quelque 12’000 personnes viennent travailler dans la zone d’exclusion, 3000 pour faire fonctionner les deux réacteurs encore en service, le reste pour continuer de nettoyer la zone, sans rien dire des scientifiques qui étudient l’environnement, les animaux et les gens.
Je ne suis pas médecin, et ne puis que citer ceux qui le sont. Autour d’une table, au Centre de recherche de Tchernobyl, j’ai posé de nombreuses questions au professeur Nicolai Arkhipov, directeur de recherche, et à sept de ses collaborateurs. Non, me dirent-ils, on n’a constaté dans la population animale du territoire, aucune hausse anormale du nombre des naissances difformes. Pour ce qui est des êtres humains, les femmes qui signalent leur grossesse sont immédiatement éloignées de la zone d’exclusion; en tout cas, aucune hausse anormale de défauts congénitaux n’a été observées chez leurs enfants, pas plus d’ailleurs que chez les enfants nés dans la campagne ukrainienne entourant la zone d’exclusion. Oui, il existe un nombre anormalement élevé de cancers de la thyroïde, mais pas en Russie, ni en Ukraine, ni aux alentours de la zone d’exclusion: en Biélorussie. Non, on n’a pas observé d’accroissement des leucémies infantiles; en fait, dans les villages les plus contaminés, ceux de la région de Gomal, à 150 kilomètres au nord, le taux de leucémies infantiles est aujourd’hui inférieur à ce qu’il était avant l’accident. Quant aux 700 habitants qui n’ont jamais quitté la zone d’exclusion, leur santé est meilleure que la normale, me dit la doctoresse Ekaterina Ganja, médecin-chef du Centre, pour la raison sans doute qu’ils ont été suivis médicalement de très près depuis 1986.
La région de Tchernobyl a par ailleurs été l’objet de plusieurs études médicales à grande échelle. L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a mis sur pied en 1990 un « Projet international Tchernobyl », auquel ont participé l’Union Européenne, l’Organisation des Nations-unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), le Comité des Nations-unies pour l’étude des effets des radiations atomiques, et l’Organisation Internationale du Travail. Sous la direction du professeur Itsuzo Shigemitsu, directeur, à Hiroshima, de la Fondation pour la Recherche sur les effets des radiations, quelque 200 scientifiques appartenant aux principales institutions médicales de 25 pays ont travaillé dans la région de Tchernobyl en 1990 et 1991. Leur rapport final conclut ceci: « Nous avons trouvé, dans les populations de la zone contaminée et des zones de contrôle [les zones de contrôle sont situées dans des régions n’ayant pu être contaminées par l’accident de Tchernobyl], des problèmes sanitaires importants, mais qui ne sont pas liés à un phénomène d’irradiation. Nous n’avons pas trouvé de problèmes sanitaires attribuables directement à un phénomène d’irradiation. » La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge a réalisé, elle aussi, à la même époque, une étude qui concluait que les problèmes sanitaires relevés « ne découlent pas de l’exposition aux radiations, même si le public et un certain nombre de médecins sont convaincus du contraire. [Nous avons constaté en revanche que] le stress psychologique et l’anxiété des gens [consécutifs à l’accident] a provoqué chez eux des symptômes physiques et affecté leur santé de plusieurs manières. »
Il est clair que Tchernobyl a été, pour une population très nombreuse, et pour toute une nation, un désastre de première grandeur. Un désastre social, culturel, industriel, économique, oui, mais pas un désastre écologique, puisque la vie sauvage, les animaux, les plantes n’en ont subi pratiquement aucun dommage. Et que les êtres humains n’ont pas souffert (ou pas encore souffert) de maux de santé directement liés à l’irradiation.
Le personnel chargé du nettoyage de la zone d’exclusion est inquiet, cependant. Les efforts de recherche scientifique qui devraient y être conduits de façon urgente sont si considérables, et les ressources dégagées pour le faire si faibles, qu’ils ont le sentiment de se trouver confrontés à une mission impossible. Le professeur Nicolai Arkhipov nous a fait remarquer que la majorité de ses collègues et lui-même sont des volontaires. Les instituts scientifiques russes et ukrainiens responsables de la recherche radioécologique à Tchernobyl connaissent aujourd’hui de graves difficultés financières. Les travaux qu’ils ont entrepris ont souffert en outre de la discorde entre la Russie et les autres républiques de l’ex-URSS. La perspective d’une remise en état du site est menacée, comme la possibilité de tirer du désastre quelques leçons utiles.
Il semble pourtant évident que l’accident de Tchernobyl devrait servir au moins à une étude en profondeur des conséquences qu’entraîne la destruction d’une grande centrale nucléaire. Une « expérience involontaire » d’un tel ordre de grandeur, qui a affecté la planète entière, de manière aussi bien environnementale que sociale, médicale, économique et psychologique, est unique en effet. Or malgré cela, l’après-Tchernobyl est une histoire de tâtonnements, de manque d’expérience, d’absence de connaissances de base.
Il serait tragique que le monde néglige de se donner les moyens d’évaluer cet accident scientifiquement, et jusque dans ses derniers détails. Si, ce qu’à Dieu ne plaise, une irradiation importante devait se produire à nouveau, quelque part dans le monde, que ce soit par la faute d’un autre accident de réacteur ou à cause d’une attaque atomique, il serait évidemment vital que nous disposions alors d’une importante expertise de terrain.
Et puis, il y a autre chose. L’accident de Tchernobyl est devenu, pour beaucoup de gens, le symbole même des dangers mortels de la puissance nucléaire civile. Or, on l’a vu, de ce que l’on sait maintenant de l’accident de Tchernobyl, cette crainte est infondée.
Il serait donc tragique que cette crainte retienne le monde de développer sa capacité de générer de l’électricité nucléaires. Cette énergie sera en effet essentielle si l’on veut éviter que les hommes du XXIe siècle ne soient condamnés à de réelles catastrophes. Il y a aujourd’hui, sur la Terre, près de 6 milliards d’habitants; on estime qu’il y en aura 10 milliards en 2030. Si nous voulons qu’à cette date la population de la planète jouisse simplement du même niveau de vie qu’aujourd’hui, il nous faudra doubler d’ici là notre production d’énergie. Plus encore: si l’on veut qu’en 2030 les pays du tiers monde jouissent d’un niveau de vie approchant celui du monde occidental, il nous faudra non pas doubler, mais quadrupler, d’ici là, notre production d’énergie.
Moins pour faire rouler nos voitures ou tourner nos ordinateurs-joujoux, que pour chauffer nos maisons et cuire nos aliments le jour où les forêts auront disparu de la surface de la Terre, pour synthétiser les engrais qui nous permettront de mettre en culture de sols aujourd’hui inutilisables, pour faire fonctionner nos tracteurs et nos systèmes d’irrigation. A défaut de quoi, la vie humaine se dégradera à une vitesse tragique et dangereuse, dont nous n’avons aujourd’hui aucune idée.
En 2030, les réserves de pétrole de la planète seront en voie d’épuisement. Le charbon, pollue et aggrave l’effet de serre, raisons pour lesquelles les Sommets de l’environnement de Rio (1992) et de Berlin (1995) ont exigé que l’on cesse d’en brûler autant. Ne reste donc, comme moyen de générer les quantités massives d’énergie dont nous allons avoir besoin, que le nucléaire.
Tchernobyl nous enseigne une rude leçon sur les dangers de conceptions au rabais, d’organisations miteuses et de surveillances laxistes. Mais cette leçon, pour amère qu’elle soit, ne doit pas nous inciter à renoncer à l’avenir.
© Le Temps stratégique, No 66, Genève, octobre 1995.
ADDENDA
Tchernobyl, 26 avril 1986, 01 h 23…
Rappel des faits
Le 26 avril 1986, à 01h 23, une explosion détruisit le réacteur no 4 de la centrale électronucléaire de Tchernobyl, soulevant presque verticalement la dalle supérieure du réacteur, qui pèse 2000 tonnes. Tous les tubes de force contenant les grappes de combustible furent rompus, une partie du coeur du réacteur fut projetée autour de l’installation et sur les bâtiments voisins. Les rejets, entretenus par la combustion du graphite, durèrent 10 jours, jusqu’au comblement du « trou » du réacteur par des matériaux (sable, bore, plomb) largués par des hélicoptères. Plus de 1,8 milliard de becquerels de produits de fission furent propagés par le vent qui soufflait du sud au nord. Le panache radioactif toucha sévèrement le nord de l’Ukraine, le sud de la Biélorussie et de la Russie.
Un « sarcophage » pourri
Dans la semaine qui suivit l’accident, 135 000 personnes furent évacuées. Dans les premiers mois suivant l’accident, les interventions consistèrent essentiellement à regrouper dans le réacteur et autour de lui les débris radioactifs les plus importants. Ce combustible fut alors confiné dans un « sarcophage » de béton et d’acier de 50 mètres de haut, achevé en novembre 1986. En 1991, le réacteur no 2 fut arrêté à la suite d’un incendie. Les réacteurs 1 et 3 n’ont jamais cessé de fonctionner.
Le « sarcophage » construit à la hâte dans des conditions extrêmement difficiles, présente de nombreux défauts: le toit fait de tôles n’est pas étanche et repose, par l’intermédiaire d’une longue poutre métallique, sur des appuis appartenant au bâtiment d’origine, qui ne sont pas stables. Le mur séparant le sarcophage du bâtiment intermédiaire qui le relie à l’unité 3 toujours en fonction est également instable, comme le sont d’autres éléments de la structure interne du bâtiment.
Un magma radioactif « irrigué »
Le combustible resté dans le réacteur pendant l’explosion a coulé dans le fond du bâtiment sous forme de lave, et se transforme actuellement en poudre. Par les fuites du toit et la condensation, des milliers de mètres cubes d’eau traversent le magma radioactif. Il n’est pas certain que la dalle inférieure en béton du réacteur soit étanche. La nappe phréatique se situe à un mètre en dessous de cette dalle.
Les experts estiment que 5% seulement des éléments radioactifs présents dans le coeur du réacteur au moment de l’explosion ont été projetés au loin. Il est très difficile d’estimer la quantité de combustible qui est resté dans le coeur, et, selon les mesures, les écarts sont considérables. Les valeurs probables sont comprises entre 120 et 140 tonnes sur les 190 tonnes d’origine. Les 50 tonnes manquantes furent projetées autour de la centrale et une grande partie fut enfouie au bulldozer autour du « sarcophage » et dans les 800 fosses de stockage.
La grande quantité d’eau qui fut déversée sur le réacteur après l’accident a été pompée et déversée dans le bassin artificiel utilisé pour le refroidissement des réacteurs de Tchernobyl. La radioactivité s’est concentrée dans les sédiments au fond du bassin et s’écoule au rythme de plusieurs centimètres par an vers la rivière.
La centrale est morte, vive la centrale!
Le 27 mai 1995, un consortium international mené par la multinationale helvético-suédoise ABB, avec Kawasaki (Japon), CMS (États-Unis), Shanska (Suède), Mannesbaum Anlagenbau (Allemagne) et Danish Power (Danemark), a signé avec le gouvernement ukrainien a signé un accord pour le remplacement de la centrale nucléaire de Tchernobyl par une centrale au gaz dans un délai de trois ans. Plusieurs compagnies ukrainiennes participeront également au consortium . Cette reconversion, rapide et peu coûteuse, devrait fournir du travail à 6000 personnes en Ukraine.
ABB n’est pas novice en la matière, puisqu’elle a déjà reconverti deux centrales nucléaires en centrales à énergie fossile, à Midland Power Plant et Zimmer Power Plant, aux États-Unis, en réutilisant autant que possible l’équipement des centrales nucléaires pour l’exploitation de la nouvelle centrale. ABB est déjà installée en Russie et dans la CEI, où elle possède 60 usines employant environ 20’000 personnes.
Sources: Tchernobyl 9 ans après, par l’Institut français de sûreté et de protection nucléaire. Paris, 1995, et ABB.
CONTREPOINT
A Tchernobyl,
aujourd’hui, tout n’est pas si rose
De quelques conséquences médicales de la catastrophe
Dans la centrale même, trois personnes ont péri par traumatisme et brûlures au moment de l’explosion. Parmi les sauveteurs qui sont intervenus juste après la catastrophe, 237 ont été hospitalisés pour un syndrome aigu d’irradiation et 28 sont morts quelques semaines plus tard. On ne connaît pas l’état de santé actuel des survivants.
Les « liquidateurs »
Le sort des personnes ayant participé ultérieurement aux tâches d’assainissement dans le périmètre de 30 km autour de la centrale (les liquidateurs) est également incertain. Leur nombre officiel, de 600’000 à 800’000, originaires d’Ukraine, de Russie, de Biélorussie et des pays baltes, est actuellement revu à la baisse par les gouvernements respectifs, le statut de liquidateur, qui donne certains avantages, un suivi médical régulier notamment, coûtant cher aux autorités. Quelles que soient les populations de référence prises par les différents experts de la CEI, aucune surmortalité n’est actuellement rapportée chez les « liquidateurs ». Un rapport publié en 1994 a même trouvé, dans un groupe de 140 000 liquidateurs, une mortalité inférieure à celle de la population témoin. En revanche, la plupart des recherches ont mis en évidence, dans ces groupes, une augmentation importante des affections habituelles de la population générales (maladies cardio-vasculaires et digestives, bronchites chroniques, rhumatisme articulaire), une fréquence inhabituelle de désordres neuro-psychologiques et un vieillissement accéléré de l’organisme.
Les enfants
L’un des effets marquants de la catastrophe de Tchernobyl est l’augmentation des cancers de la thyroïde en Biélorussie, en Ukraine et en Russie. Une forte augmentation des cancers chez l’enfant a été détectée en Biélorussie dès 1989-1990, ensuite en Ukraine, plus récemment dans une des zones contaminées de Russie, la région de Briansk. De nombreuses recherches médicales et épidémiologiques ont été menées en Biélorussie, en particulier par le professeur Theodor Abellin, directeur de l’Institut de Médecine sociale et préventive de l’Université de Berne et expert de l’OMS. Parce que le cancer de la thyroïde chez l’enfant est particulièrement agressif, qu’il se manifeste rapidement et que sa détection clinique est aisée, le professeur Abellin considère que l’on ne saurait attribuer l’augmentation constatée à la seule mise en place de campagnes de dépistage.
Entre 1986 et 1994, les médecins ont diagnostiqué dans les régions contaminées 333 nouveaux cas de cancer chez l’enfant. Ce qui signifie que le taux de cancer de la thyroïde chez les enfants âgés de moins de 15 ans en 1986 a été multiplié par 30 depuis la catastrophe de Tchernobyl.
Pour l’ensemble de la Biélorussie, le taux de cancer est actuellement de 3,06 pour 100’000 enfants, alors que le taux naturel (celui des pays baltes par exemple) est de 0,1 cas pour 100’000 enfants. Dans la région de Gomel, où les retombées radioactives furent particulièrement importantes, le taux varie entre 8,39 et 13,08 pour 100 000 enfants. Le taux de cancer de la thyroïde chez les adultes a été multiplié par trois. En Ukraine, les médecins ont diagnostiqué entre 1986 et 1994 quelque 200 cas dans les cinq régions les plus contaminées situées au nord du pays, soit un taux 10 fois supérieur à celui des années précédentes. En Russie, 120 nouveaux cancers ont été détectées entre 1990 et 1994, mais les données sont, là, plus lacunaires.
Après la catastrophe, les scientifiques s’attendaient par ailleurs à une forte augmentation des cancers solides et des leucémies, en raison de la sensibilité de la moelle osseuse aux rayonnements. A ce jour, cependant, aucun excès de ce type de cancers n’a été mis en évidence, éventuellement à cause de l’absence de statistiques fiables et comparables.
En revanche, les conséquences psychosociales de la catastrophe de Tchernobyl – insomnies, fatigues chroniques, états dépressifs et autres maladies induites par le stress – constituent un problème majeur pour les trois républiques concernées.
Point de vue étroit
ou point de vue large
Le jugement porté sur les conséquences sanitaires de l’accident de Tchernobyl dépend du point de vue adopté.
Si, comme les défenseurs du nucléaire, l’on compte comme victimes les seules personnes atteintes aujourd’hui dans leur santé, les chiffres sont relativement faibles, pas supérieurs en tout cas à ceux relevés dans d’autres catastrophes technologiques ou naturelles.
Si l’on se fonde en revanche sur la définition de l’OMS selon laquelle « la santé est un état complet de bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité », le nombre de victimes de Tchernobyl est très élevé: la catastrophe a eu un effet déstabilisateur global sur la société; des millions de personnes ont été irradiées à doses faibles, des centaines de milliers à doses plus élevées. Or à moyenne ou faible dose, la radioactivité choisit ses victimes au hasard, les risques se transmettant aux générations futures. Une menace plane donc constamment sur la population affectée, qui vit dans un état de stress post-traumatique caractérisé par une grande anxiété, des dépressions, des troubles du sommeil, des fatigues chroniques, des maladies physiques ou psychosomatiques, des réalités médicales qui nécessitent des soins. A quoi il faut ajouter que 130 000 personnes ont été déplacées qui, en plus d’avoir tout perdu, y compris l’espoir de retourner chez elles, se sentent ostracisées par leurs nouveaux voisins, jaloux des avantages (rations alimentaires supplémentaires, suivi médical) dont elles bénéficient.
Sources: Tchernobyl 9 ans après
(Institut de protection et de sûreté nucléaire, Paris 1995), et conférence du Dr Jacques Moser (Lausanne) sur« les aspects médicaux et psychosociaux de la catastrophe de Tchernobyl », Université de Genève, 1995.