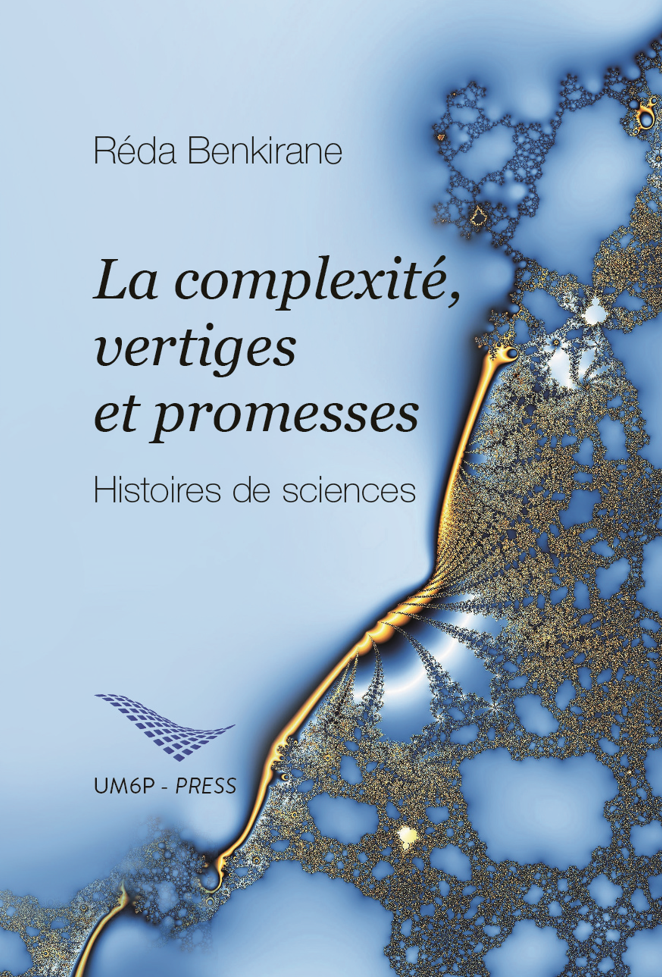Le mythe du développement
ouvrage collectif, Seuil, Paris, 1977.
« Et si le développement, cette étoile vers laquelle on voulait faire marcher les peuples du monde, n’était qu’un astre mort ? (…) Le « développement », expression de la mystique industrielle, est entré en agonie… »
Les auteurs sont des penseurs de ce temps ; économistes, sociologues et philosophes : J. Attali, R. Dumont, C. Mendes, E. Morin, etc…
extraits significatifs
p. 10 ; « Et le cadavre encore tiède du concept de développement s’est trouvé enterré pour laisser place à une nouvelle vision du processus social, axée sur les nouvelles entéléchies, sur l’harmonie avec la nature qu’exige la nouvelle conscience écologique. »
p. 11 ; « Dans quelle mesure peut-on encore parler de systèmes de valeurs distincts de celui de la société d’abondance, lui opposant une alternative viable et opérationnelle par-delà le néo-rousseaunisme naïf du sermon écologique ? »
p. 13 ; « Nous pouvons contribuer à changer un pathos en éthos, et de deux manières. D’abord par une analyse critique, par une ascèse conceptuelle, qui déconsidère l’usage lyrique et indéterminé de mots comme croissance, expansion, progrès, développement. »
p. 15 ; « (…) la croyance plus modeste à laquelle s’était ralliée notre époque et que Heidegger exprimait en écrivant que, au sein de l’activité technique, là où surgit le mal surgit le remède. »
p. 17 ; « Il faut s’attendre également à ce que l’entreprise capitaliste cherche de nouveaux bénéfices du côté des biens immatériels, qui échappent encore plus ou moins à son contrôle : le loisir, la sexualité, l’éducation, la médecine, etc… »
p. 21 ; « Si cette analyse est exacte, il faut admettre que la crise du développement est d’abord une crise de la raison et de la culture occidentale ce qui ne réduit son extension qu’en apparence… »
p. 22-23 ; « Le développement au sens correct du terme, implique une prise en considération de la « base », c’est-à-dire de ce qui est latent dans un groupe et qui précisément doit être développé : sa langue, son tempérament, sa culture, son autonomie, tout ce qui donne rythme et signification à l’effort collectif. Or la conception prédominante du développement n’intègre ce dynamisme qu’au titre de moyens au service d’un processus dont l’orientation et la cadence sont soumis à des calculs eux-mêmes déterminés par l’imitation du modèle industrie et le mécanisme général de la concurrence. Loin de parvenir à un équilibre dynamique entre campagne et ville, entre « base » et superstructure administrative, on assiste, presque partout, à la constitution de métropoles gigantesques, au déclin des communautés populaires, à la disparition de sub-cultures au profit d’outillages hypertrophiés, d’administrations bureaucratisées et de cultures pré-fabriquées. Le discours du développement devient ainsi tautologique et finalement contradictoire. Ce n’est pas un équilibre dynamique qui est créé, mais un déséquilibre étouffant ; et les originalités, loin d’être stimulées, sont paralysées. On devrait parler d’enveloppement plutôt que de développement.
(…) Avons-nous d’autres moyens d’aider les pays sous-développés que de modifier la finalité, la structure et la cadence de notre propre développement ?
(…) Si forte est cette conviction qu’elle a même intégré le marxisme qui pourtant reposait sur une affirmation inverse : le mal de l’homme a des causes sociales et politiques, la pénurie et l’inégalité ne s’expliquent pas par des causes extérieures mais par des causes intérieures aux sociétés… »
p. 24 ; « En conséquence, la critique et la réforme du développement doivent être déplacées du domaine de l’évaluation matérielle (potentiel des ressources) à celui de l’évaluation sociale, morale, culturelle : quel est le degré, quelle est la qualité de bonheur, d’amitié, de paix, de culture souhaités par tel groupe -ce qu’Illitch résume sous le nom de convivialité? Quels sont les moyens politiques, intellectuels, spirituels pour organiser la société de telle sorte que les choses deviennent suffisantes? »
p. 27 ; « A la racine de la crise du développement se trouvent l’atrophie des libertés et l’hypertrophie des pouvoirs et des outils. »
p. 30 ; « On a beaucoup parlé du développement. On ne l’a pas défini.
(…) Et c’est bien là que le développement se trouve le plus contesté, car c’est là qu’il fait le plus de dommages. Je crois qu’à partir d’un certain seuil, le développement, qui jusqu’alors avait eu des conséquences favorables dans la réanimation des cultures, dans la reprise de conscience des peuples, agit comme une force d’anesthésie, de réduction, comme un égalisateur. Le « être plus » dégénère en un « être comme », un « être de la même manière que », de plus en plus contraignant et en même temps de plus en plus séduisant. Car la contrainte s’accompagne ici d’une immense séduction. Mais si vraiment nous nous inquiétons, qu’est-ce que nous pouvons faire ? Je suis frappé de ce que la critique du développement se situe exactement au niveau de ce qu’elle conteste, c’est-à-dire au niveau de la mathématique, de l’addition des chiffres, de la quantité pure. A l’origine de cette controverse se trouve cette conviction selon laquelle toute l’histoire est le produit de la rareté. »
p. 31 ; « C’est là où la politique devient notre souci principal.
Donc, je propose de déplacer la critique du développement, de l’enlever à ces arguments chiffrés, matériels, et de la reporter au plan politique et moral. Il faut passer à une invention morale, politique et technique, qui permette autre chose que le développement tel que nous le connaissons. L’industrialisation, la mythologie productiviste ont asservi toutes les traditions culturelles de notre époque, aussi bien le socialisme que le christianisme. Or, si nous revenons à des éléments de base dans le christianisme ou le socialisme, nous trouvons la frugalité, pour parler comme Proudhon, nous trouvons la pauvreté évangélique, nous trouvons un mode de rapport avec la nature, qui est quelque chose dont nous sommes encore assez proches.
(…) Il s’agit de nous interroger sur ce que nous appelons notre science, notre technologie. »
p. 33 ; « Si on faisait la liste de tous les mots stéréotypés, surrannés, vieillis, qu’on utilise encore, on en arriverait à cette notion qu’au fond c’est encore une idée de Rousseau, celle d’un mariage avec la nature, même si on parle d’Ivan Illich et de Jérôme Bosch. »
p. 35 ; « Une société en devenir n’est plus une société en équilibre, ou mieux en homéostasie. Elle va de crise en crise, de rupture en rupture. Ainsi on comprend aujourd’hui que le développement industriel est un phénomène d’hubris . Désormais, le problème qui se pose à nous n’est pas de retrouver les anciennes régulations, c’est celui d’un nouveau processus de régulation dans le devenir. »
p. 37 ; « Et je reconnais que, de ce point de vue, je relève d’un certain empire qui est l’empire occidental. Là-dessus, j’ai accepté mes responsabilités et j’ai dit que le modèle occidental était le seul opératoire, le seul efficace en ce moment dans le monde.
(…) La culture occidentale n’est pas supérieure aux autres mais elle a toujours su se reprendre, se revivifier et se régénérer à partir de ses données fondamentales. Ce qui ne signifie pas qu’elle soit meilleure, ni qu’elle soit éternelle. »
p. 67 ; « L’Inde est un exemple frappant : elle a exporté pour 2,5 milliards de dollars de marchandises l’année dernière, et elle devra payer cette année un milliard de dollars suplémentaires pour son pétrole et un milliard de dollars suplémentaires pour ses produits alimentaires et ses engrais, soit une augmentation de 2 milliards de dollars en un an.
On peut dire sans risque d’erreur que maints gouvernements s’effondreront dans ces pays, sous l’effet de ces tensions au cours des prochains dix-huit à vingt-quatre mois. »
p. 68 ; « Depuis plusieurs années, les stocks de produits alimentaires ont diminué, malgré la récolte de 1974 qui fut la plus riche dans l’histoire de l’humanité. »
p. 151 ; « Le point de départ sera une tentative de définition des principaux objectifs ultimes du développement, qui sont, à notre avis, les suivants :
a) L’objectif principal du développement doit être la satisfaction des besoins élémentaires comme la nourriture, le logement, la santé et l’éducation. Le premier principe doit être que tout être humain -du seul fait de son existence- a le droit absolu de satisfaire ces besoins qui sont essentiels à une intégration complète et active dans sa culture. Un objectif parallèle et complémentaire consiste à diminuer et éventuellement à éliminer complètement l’inégalité sociale.
b) L’amènagement rationnel de l’environnement physique devrait être une des lignes d’orientation du développement économique ; il est essentiel de construire une société entièrement en harmonie avec son environnement ; cela signifie que les objectifs définis au point a) doivent être atteints en utilisant une quantité minimale de ressources naturelles compatible avec le niveau adéquat des besoins élémentaires.
c) Le développement de chaque pays ou de chaque région devra être fondé, dans la mesure du possible, sur ses propres ressources -naturelles et humaines. »
p. 152 ; « Cependant, une fois les décisions politiques prises, l’instrument le plus important de la mise en place du processus est l’existence d’une capacité scientifique et technologique élevée. Un domaine pratiquement inexploré par les pays développés et qui soulève des problèmes, c’est celui de l’utilisation rationnelle et de la « création » de ressources naturelles, le développement de nouvelles technologies appropriées aux conditions spécifiques des pays attardés, etc.
Une approche imaginative et ouverte est indispensable dans cette recherche technologique et scientifique, et son absence s’est fait cruellement sentir dans les systèmes R et D des pays sous-développés.
Les changements dans les relations de pouvoir à l’intérieur d’une société ne sont pas suffisants en eux-mêmes pour adapter automatiquement les éléments de la superstructure à la nouvelle situation. Les systèmes R et D des sociétés modernes, dans les pays avancés comme dans les pays en voie de développement, ont des traditions quant aux critères pour effectuer et orienter les recherches qui se sont développées dans les sociétés occidentales avancées. C’est pourquoi, compte tenu des contraintes politiques, ils se sont révélés si peu efficaces face à une situation radicalement nouvelle posée par le secteur traditionnel des pays en voie de développement. Le problème important à résoudre est de savoir modifier cette situation pour changer la conception et l’orientation des systèmes scientifiques et technologiques. »
p. 153 ; « Cette disposition formelle manque presque complètement dans d’autres pays, et le système fonctionne plus ou moins indépendamment de la structure définie par la planification sur le plan national. Toutefois, et dans les deux cas, l’efficacité de ces systèmes reste plus ou moins la même. Il ne s’agit pas ici, bien entendu, de porter un jugement de valeur sur les avantages intrinsèques présentés par l’orientation donnée au développement, mais de dire que les systèmes de recherche et de développement des pays développés répondent avec la même insuffisance à la demande implicite de leurs sociétés.
(…) Déterminer la technologie qui conviendra à une société donnée soulève un problème comportant de nombreuses variables, dont fort peu sont strictement technologiques. La plupart d’entre elles se rattachent aux domaines de l’économie, de la sociologie et de la psychologie sociale, pour former ce que l’on pourrait appeler un ensemble d’hypothèses qui constituent, si l’on veut, le cadre de référence du système de recherche et de développement. Elles sont l’expression des caractéristiques les plus fondamentales de ces sociétés, et sont rarement explicitées car elles ont été assimilées par chaque membre des systèmes en question. C’est pourquoi tout savant ou technologue du monde industrialisé, indépendamment de sa situation sociale ou de son idéologie politique, rejette automatiquement et presque inconsciemment, lorsqu’il est confronté à un problème technologique, toute solution non conforme aux hypothèses généralement admises. C’est ce premier filtrage qui détermine la solution technologique possible applicable aux problèmes spécifiques des pays en voie de développement. Le point important est que, sans cet ensemble d’hypothèses ou leur équivalent, aucun problème technologique ne peut faire l’objet d’une recherche scientifique qu’à la condition que ses paramètres sociaux et économiques ainsi que ses variables soient définis sans ambiguïté. »
p. 159 ; « Ainsi, les Chinois connaissaient la poudre à canon bien avant les Occidentaux, et pendant des siècles ils s’en sont servis pour les feux d’artifice des fêtes populaires, mais dès que la poudre a pénétré en Occident, on a inventé le canon!
(…) Ainsi le problème posé par les pays sous-développés est de savoir s’ils pourront mettre au point un nouvel ensemble de paradigmes susceptibles d’exprimer réellement les aspirations de leurs peuples, les valeurs et les besoins d’une société nouvelle. Si nous admettons la nécessité de développer une nouvelle technologie, j’insiste pour que l’on comprenne bien qu’il ne s’agit pas, comme on le dit souvent, de créer toutela technologie, mais qu’il est possible de créer une variété particulière de technologie répondant à une situation particulière. Si nous acceptons cette notion, nous voyons que le monde en voie de développement est dans une situation presque semblable à celle du monde occidental au début de la Révolution Industrielle, mais qu’en plus, il dispose d’un avantage qui n’existait pas alors, c’est-à-dire d’immenses connaissances scientifiques pouvant fort bien s’appliquer à la solution de ses problèmes. »
p. 182 ; « Les stratégies de la onzième heure n’ont pas été utilisées ; elles ont été délaissées comme des sinalèphes à la marge du tourbillon final du populisme »
p. 183 ; « L’homéostase profite des stratifications et de l’anomie qui marquent la vieille organisation coloniale encore incomplètement éliminée par le développement.
(…) Les compartiments deviennent alors des valvules, ou plutôt des vases communicants, qui retiennent et modulent le flux général du changement. Ils l’empêchent d’atteindre une limite synergique et surtout veillent à ce que ses rythmes et ses impulsions éventuelles se fassent selon une logique de renvois, selon un modèle de loops excentriques. »
p. 184 ; « Dans cette optique et en réponse déjà à l’analyse du discours logique et à son impatience, l’on peut interpréter la révolution telle qu’elle apparaît dans l’eschatologie occidentale, comme un « luxe » du processus historique, un « surplus » de l’auto-organisation atteinte par la société.
(…) Les stratégies de cloisonnement actuellement en vogue dans le continent latino-américain supposent des nodules de haute fonctionnalité dans l’articulation des facteurs de production au reste du complexe social ; le jeu d’équilibre de ce système se fait par l’écoulement continu et réglé des masses individualisées dans le champ de forces du devenir. »
p. 186-187 ; « Il ne s’agit pas seulement de voir de quelle manière l’idéologie nouvelle peut altérer les anciennes priorités du « que faire » international, de noter que dans l’ordre du jour du développement elle a remplacé les éthiques de « performances » par celles de l’accomodation, de recherche d’un éqilibre entre l’homme et oecumene , dont l’Occident s’éloigne depuis des siècles au point d’en arriver à une quasi-« lobotomisation ». »
p. 188 ; « Ce n’est pas par les mêmes détours ni par le filtre de la même règle d’or écologique que passent les problèmes qui se situent comme un contre-feedback à l’évolution globale du système -comme celui de la pollution ou de l’accroissement démographique -ni les décisions relatives à la concentration des grands protagonistes du devenir économique ou à la composition organique de son capital, ni non plus, dépouillée, dans sa dernière liberté sauvage, la vision a-critique qui fait de l’innovation, dans toute analyse prédictive, la folle du système.
(…) Nous nous référons à la sensibilité éthique qui traverse les années 1970, à ce nouveau placenta de visions, d’attentes et d’inquiétudes. »
Pour ma part, je vais essayer de discuter un peu sur ce que peut être une approche heuristique de la notion de « crise ». »
p. 192 ; « En d’autres termes, comment obtenir la trêve des épochè où le discours fermé et concentrationnaire du développement classique se trouverait enfin suspendu ? »
p. 205 ; « »La crise du progrès » était le thème des années 30.
(…) Cette clef, c’était la croissance économique, réalisable sans difficultés grâce aux nouvelles méthodes de régulation de la demande, et les taux de croissance du P.N.B. par habitant contenaient la réponse à toutes les questions. »
p. 206 ; « Certes aussi, la faim était (comme elle l’est toujours) réalité quotidienne pour une énorme partie de la population de la planète, et le Tiers Monde ne réalisait pas une croissance économique, ou bien sa croissance restait trop faible et trop lente. Mais la raison en était que les pays du Tiers Monde ne se « développpaient » pas. Le problème donc consistait à les développer, ou à les faire se développer. La terminologie internationale officielle a été adaptée en conséquence. Ces pays, auparavant nommés, avec une sincère brutalité, « arriérés », puis « sous-développés » et finalement « pays en voie de développement » -joli euphémisme, signifiant en fait que ces pays ne se développaient pas . Comme les documents officiels l’ont formulé à maintes reprises, les développer voulait dire : les rendre capables d’entrer dans la phase de la « croissance auto-entretenue ».
(…) Limitée à l’origine à l’intérieur d’un cercle très étroit de penseurs politiques et sociaux hétérodoxes, ces critiques se sont largement répandues, en l’espace de quelques années, parmi les jeunes et ont commencé d’influencer aussi bien les mouvements étudiants des années 60 que le comportement effectif des divers individus et groupes, qui décidèrent d’abandonner la « course de rats » et tentèrent d’établir pour eux-mêmes de nouvelles forme de vie communautaire. »
p. 207 ; « Depuis l’enfoncement de Venise dans les eaux jusqu’à la mort peut-être imminente de la Méditerranée ; depuis l’eutrophisation des lacs et des fleuves jusqu’à l’extinction de douzaines d’espèces vivantes ; depuis les printemps silencieux jusqu’à la fonte éventuelle des calottes glaciaires des pôles ; depuis l’érosion de la Grande Barrière de Corail jusqu’à la multiplication par mille de l’acidité des eaux de pluie… »
p. 214 ; « Ce qui importe ici est la « coïncidence » et la convergence que l’on constate à partir, disons, du XIVème siècle, entre la naissance et l’expansion de la bourgeoisie, l’intérêt obsédant et croissant porté aux inventions et aux découvertes, l’effondrement progressif de la représentation médiévale du monde et de la société, la Réforme, le passage « du monde clos à l’Univers infini », la mathématisation des sciences, la perspective d’un « progrès indéfini de la connaissance » et l’idée que l’usage propre de la Raison est la condition nécessaire et suffisante pour que nous devenions « maîtres et possesseurs de la Nature » (Descartes).
(…) il n’y a pas de limites aux pouvoirs et aux possibilités de la Raison, et la Raison par excellence, du moins s’il s’agit de la res extensa, est la mathématique : Cum Deus calculat, fiat mundus (« Au fur et à mesure que Dieu calcule, le monde est fait », Leibniz). N’oublions pas que Leibniz chérissait également le rêve d’un calcul des idées. »
p. 216 ; « (…) -divers lemmes sur l’homme et la société, qui ont changé avec le temps mais qui tous impliquent soit que l’homme et la société sont naturellement prédestinés au progrès, à la croissance, etc. (homo economicus, la « main cachée », libéralisme et vertus de la libre concurrence), soit-ce qui est beaucoup plus approprié à l’essence du système- qu’ils peuvent être manipulé de diverses manières pour y être amenés (homo madisoniensis Pavlovi, « ingéniérie humaine » et « ingéniérie sociale », organisation et planification bureaucratiques en tant que solutions universelles applicables à tout problème). »
p. 227 ; « Il serait également catastrophique de mal comprendre, mal interpréter et sous-estimer ce que le monde occidental a apporté. A travers et par-delà ses créations industrielles et scientifiques, et les ébranlements correspondants de la société et de la nature, il a détruit l’idée de physis en général et son application aux affaires humaines en particulier. Cela, l’Occident l’a fait moyennant une interprétation et une réalisation, « théorique » et « pratique », de la « Raison » – interprétatrion et réalisation spécifiques, poussées à leur limite. Au bout de ce processus, il a atteint un lieu où il n’y a plus et il ne peut plus y avoir de point de référence ou d’état fixe, de « norme ».
Dans la mesure où cette situation induit le vertige de la « liberté absolue », elle peut provoquer la chute dans l’abîme de l’esclavage absolu. Et dès maintenant, l’Occident est esclave de l’idée de la liberté absolue. La liberté, conçue autrefois comme « conscience de la nécessité » ou comme postulat de la capacité d’agir selon la pure norme éthique, est devenue liberté nue, liberté comme pur arbitraire (Willkür). L’arbitraire absolu est le vide absolu ; le vide doit être rempli, et il l’est avec des « quantités ». Mais l’augmentation sans fin des quantités a une fin -non seulement d’un point de vue extérieur, puisque la Terre est finie, mais d’un point de vue interne, parce que « plus » et « plus grand » n’est plus désormais « différent », et le « plus » devient qualitativementindifférent . (Une croissance du P.N.B. de 5 % dans une année signifie que, qualitativement, l’économie est dans le même état que l’année précédente ; les gens estiment que leur condition a empiré si leur « niveau de vie » ne s’est pas « élevé », et n’estiment pas qu’elle s’est améliorée si ce « niveau » ne s’est élevé que suivant le pourcentage « normal ».) Tout cela, Aristote et Hegel le savaient déjà parfaitement. Mais, comme c’est souvent le cas, la réalité suit la pensée avec un retard considérable. »
p. 228 ; « Mais ce savoir peut nous aider beaucoup s’il nous rend capables de dénoncer et de détruire l’idéologie rationaliste, l’illusion de l’omnipotence, la suprématie du « calcul » économique, l’absurdité et l’incohérence de l’organisation « rationnelle de la société, la nouvelle religion de la « science », l’idée du développement pour le développement. Cela, nous pouvons le faire si nous ne renonçons pas à la pensée et à la responsabilité, si nous voyons la raison et la rationnalité dans la perspective appropriée, si nous sommes capables d’y reconnaître des créations historiques de l’homme. »
p. 232-233-234 ; « Pourquoi rappeler, si vite et si mal, tout cela? Pour souligner le plus fortement possible que le paradigme de « rationnalité » sur lequel tout le monde vit aujourd’hui, qui domine aussi toutes les discussions sur le « développement », n’est qu’une création historique particulière, arbitraire, contingente. J’ai essayé de le montrer de manière un peu plus circonstanciée dans les paragraphes de mon rapport écrit relatifs à l’économie, d’une part, à la technique, de l’autre. J’ajouterai seulement ici que si ce paradigme a pu « fonctionner », et avec l' »efficacité » relative, mais néanmoins terrifiante qu’on lui connaît, c’est qu’il n’est pas totalement « arbitraire » : il y a certes un aspect non trivial de ce qui est, lequel se prête à la quantification et au calcul ; et il y a une dimension inéliminable de notre langage et de tout langage qui est nécessairement « logico-mathématique », qui incarne en fait ce qui est, sous sa forme mathématique pure, la théorie des ensembles. Nous ne pouvons penser à une société qui ne saurait pas compter, classer, distinguer, utiliser le tiers exclu, etc. Et en un sens, à partir du moment où l’on comprend que l’on peut compter au-delà de tout nombre donné, toute la mathématique est virtuellement là, et puis les possibilités de son application ; en tous cas, cette « virtualité » est aujourd’hui développée, déployée, réalisée, et nous ne pouvons ni revenir en arrière, ni faire comme si elle ne l’avait pas été. Mais la question est de réinsérer cela dans une vie sociale où il ne soit plus l’élément décisif et dominant, comme il l’est aujourd’hui. Nous devons remettre en cause la grande folie de l’Occident moderne, qui consiste à poser la « raison » comme souveraine, à entendre par « raison » la rationnalisation, et par rationnalisation la quantification. C’est cet esprit toujours opérant (même ici, comme l’a démontré la discussion) qu’il faut détruire. Il faut comprendre que la « raison » n’est qu’un moment ou une dimension de la pensée, et qu’elle devient folle lorsqu’elle s’autonomise.
Qu’est-ce qui est donc à faire ? Ce qui est à dire, ce qui se trouve devant nous, est une transformation radicale de la société mondiale, qui ne concerne pas et ne peut pas concerner seulement les pays dits « sous-développés ». Il est illusoire de croire qu’un changement essentiel pourrait jamais se produire dans les pays « sous-développés » s’il ne se produisait pas aussi dans le monde « développé » ; cela est évident à partir de la considération aussi bien des rapports « idéologiques ». Si une transformation essentielle a lieu, elle ne pourra concerner que les deux parties du monde. Et une telle transformation politique -que je ne peux pas concevoir, pour ma part, que comme l’instauration de la démocratie, démocratie qui actuellement n’existe nulle part. Car la démocratie ne consiste pas à élire, dans le meilleur des cas, tous les sept ans un président de la République. La démocratie, c’est la souveraineté du demos, du peuple, et être souverain c’est l’être vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Et la démocratie exclut la délégation des pouvoirs ; elle est pouvoir direct des hommes sur tous les aspects de la vie et de l’organisation sociales, à commencer par le travail et la production.
L’instauration de la démocratie ainsi conçue -et dépassant les formes de vie « nationales » du présent- ne peut venir que d’un immense mouvement de la population mondiale, ce que l’on peut concevoir que comme couvrant toute une période historique. Car un tel mouvement -excédant de loin tout ce que l’on a l’habitude de penser comme « mouvement politique »- ne pourra exister s’il ne met pas aussi en cause toutes les significations instituées, les normes et les valeurs qui dominient le système actuel et sont consubstantielles à celui-ci. Il ne pourra exister que comme transformation radicale de ce que les hommes considèrent comme important et comme sans importance, comme valant et comme ne valant pas-, bref une transformation psychique et anthropologique profonde, et avec la création parallèle de nouvelles formes de vie et de nouvelles significations dans tous les domaines.
(…) La transformation sociale et historique la plus importante de l’époque contemporaine, que nous avons pu tous observer pendant la dernière décennie car c’est alors qu’elle est devenue vraiment manifeste mais qui était en cours depuis trois quarts de siècle, ce n’est ni la révolution russe, ni la révolution bureaucratique en Chine, mais le changement de la situation de la femme et de son rôle dans la société. Ce changement, qui n’était au programme d’aucun parti politique (pour les partis « marxistes », un tel changement ne pourrait être que le sous-produit, un des nombreux sous-produits secondaires d’une révolution socialiste), n’a pas été fait par ces partis. Il a été effectué de manière collective, anonyme, quotidienne par les femmes elles-mêmes, sans même que celles-ci s’en représentent explicitement les buts : sur trois quarts de siècle, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, à la maison, au travail,à la cuisine, au lit, dans la rue, face aux enfants, face au mari, elles ont graduellement transformé la situation. Cela, les planificateurs, les techniciens, les économistes, les sociologues, les psychologues, les psychologues, les psychanalystes non seulement ne l’avaient pas prévu, ils n’ont même pas pu le voir lorsqu’il a commencé à se dessiner. »
p. 248-249 ; « (…) dans l’évolution des magazines féminins où à la mythologie euphorique du bonheur (conseils d’amour et conseils domestiques qui assurent infailliblement le bonheur) succèdent une problèmatique du bonheur (comment affronter le vieillissement, la maladie, la séparation, la solitude, les malentendus avec les enfants) puis une revendication émancipatrice ; on découvre que là où sont atteintes certaines conditions de bien-être, se posent soudain des problèmes existentiels jusque là masqués.
(…) c’est non seulement que la croissance économique ne résoud pas quelques-uns des problèmes les plus fondamentaux des êtres humains, mais c’est aussi que ce développement suscite et développe, si l’on peut dire, un sous-développement moral, affectif, psychologique. Il développe, en même temps que ces possibilités d’épanouisement humain, des carences qui précisément minent cet épanouissement. »
p. 256 ; « Mais, bien entendu, il ne s’agit pas que de la crise d’un concept. Il s’agit en même temps d’une crise anthropo-sociale. Crise culturelle/civilisationnelle. Crise de la croissance industrielle/économique. Crise de la société bourgeoise. Là apparaît à la fois la vérité et l’erreur de la prédiction marxienne. La crise de la bourgeoisie est arrivée, mais non sur le marché mondial, non sous l’effet de la montée révolutionnaire des masses ouvrieères, mais crise interne, dans le principe culturel qui justifiait son hégémonie et sa domination, dans son aptitude à surmonter ses contradictions. Comme toujours, la crise de l’idéologie et de la classe dominante est la crise des fondements mêmes de la société. Les notions de science, technique, rationalité, qui semblaient être les notions guides, contrôleuses, régulatrices, apparaissaient au contraire comme les notions aveugles, incontrôlées, fabriquant de l’irrationalité, irrationalité dont toujours la forme la plus extrême (parce que la mieux camouflée) a été la rationalisation : rationalisation idéologique (où l’on scotomise tout ce qui ne peut être intégré par le schème doctrinaire abstrait)… »
p. 258 ; « Leurs solutions ne peuvent venir que de la conjonction d’une nouvelle conscience (dans la pensée et dans l’action) et d’innovations surgies de l’inconscient même du corps social. »
p. 263 ; « (…) ce sont les bases civilisationnelles et culturelles de notre société qui se nécrosent, précisément dans et par leurs développements. »