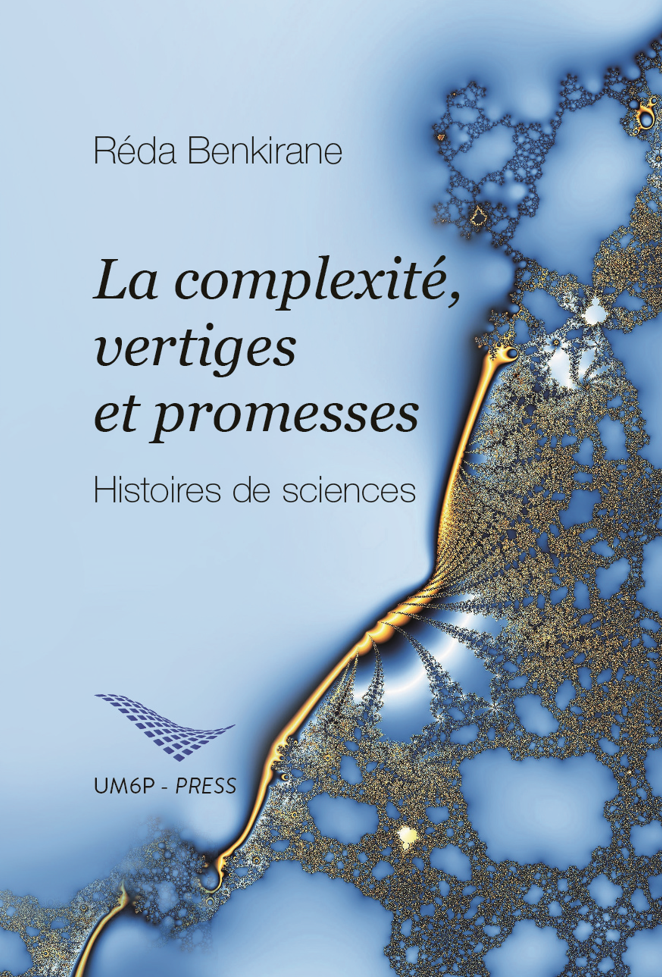Chez les Indiens, la drogue structure,
chez nous, elle détruit…
Lorsqu’un phénomène angoisse profondément – ainsi la toxicomanie – il faut tout faire pour le comprendre, l’exorciser, s’en rendre maître enfin. Pour y réussir il faut se distancer d’abord de ce qui nous fait peur: oser des comparaison, dans l’espace ou le temps, risquer des analogies, marquer les différences. C’est le défi que nous avons proposé à Michel Perrin, ethnologue.
Michel Perrin, ethnologue, membre du Laboratoire d’anthropologie sociale du Collège de France (Paris), est l’auteur de plusieurs livres, dont Le chemin des Indiens morts, mythes et symboles Guajiro (Paris, Payot, 1976, réed. 1983) et Dictionnaire d’ethnologie, en collaboration avec M. Panoff (Paris, Payot, 1973). Il prépare actuellement un ouvrage sur le chamanisme.
Dans les sociétés dites « primitives » la drogue est souvent associée au « sacré ». Par exemple pour leindiens guajiro du Venezuela, avec qui je travaille depuis plus de dix ans, les infortunes frappant les hommes sont le fait d’êtres aux pouvoirs surhumains, dits pülasü – qu’en Occident nous appellerions créatures surnaturelles, dieux ou esprits.
Les chamanes sont censés communiquer avec ces créatures surnaturelles pour en obtenir qu’elles guérissent les malades, fassent tomber la pluie ou revenir le gibier. Mais pour entrer en communication avec elles, les chamanes doivent eux aussi devenir pülasü, et ingérer à cette fin une substance pülasü, c’est-à-dire une drogue, en l’occurrence du jus de tabac à très haute dose.
La drogue conduit les indiens dans
un paysage qui leur est familier
Les Guajiro considèrent donc la drogue non seulement comme une substance capable de « disloquer » leur perception normale du monde mais aussi comme un véhicule transportant à volonté le chamane dans un « ailleurs » où résident les êtres surnaturels. Dans d’autres sociétés, ce voyage sera obtenu sans drogue, au travers de techniques corporelles: danse, jeûne, immobilisation prolongée, etc.
La plupart des Occidentaux tendent à considérer que ces « ailleurs » sont de simples effets des substances chimiques absorbées. Or, manifestement, il n’en est rien. Toutes les cultures pratiquant ce type de communication spirituelle disposent de termes ou de métaphores grâce auxquels leurs hallucinés peuvent décrire leurs pérégrinations dans le « monde surnaturel »: en d’autres termes, le voyage est modelé, souvent inconsciemment, par les représentations culturelles de ceux qui l’accomplissent, par l’univers de signes et de symboles qui est leur mythologie. Cet « encadrement culturel » est si fort qu’à tout le moins il relègue à l’arrière-plan les effets purement chimiques de la drogue. On a des preuves. Les Guajiro, comme les Warao, autre population indienne du Venezuela, usent du tabac pour communiquer avec le surnaturel. Or leurs visions hallucinées, les rencontres qu’ils sont censés faire dans leur voyage, leurs mythologies enfin, sons fort éloignées. Inversement, les Piaroa vivant dans le bassin de l’Orénoque et les Tukano du bassin du Vaupès, qui utilisent deux alcaloïdes dont les effets psychédéliques – sinon les structures moléculaires – sont assez différents (les Piaroa absorbent le yopo, légumineuse contenant un hallucinogène du groupe des tryptamines, les Tukano le yagué, boisson contenant de l’harmaline) décrivent leurs « voyages » en termes culturels et mythologiques très proches.
On pourrait, bien sûr, se demander également si certains aspects de la mythologie, de l’art, bref des activités intellectuelles des peuples consommateurs de drogue, découlent de cette consommation. Sans doute, dans une faible mesure, mais à ce jour aucune étude n’a pu en apporter une preuve convaincante. Pour Claude Levi-Strauss, « les hallucinogènes ne recèlent pas un message naturel, dont la notion même apparaît contradictoire; ce sont des déclencheurs et des amplificateurs d’un discours latent que chaque culture tient en réserve et dont les drogues permettent ou facilitent l’élaboration ».
Même dans les modifications de comportement social que provoque la drogue, le « culturel » l’emporte sur le « naturel »: ainsi la fameuse amanite muscarienne (Amanita muscaria) qui suscite, dit-on, des comportements pacifiques dans la population sibérienne des Koriak, aurait été associée chez les Vikings à la « fureur berserk », accès de violence assassine et suicidaire culturellement déterminée.
Avec la drogue l’Occidental
n’a aucun « ailleurs » où aller…
En Occident, nombreux sont les adeptes des drogues hallucinogènes qui évoquent la « dimension mystique » à laquelle ils ont accès, disent-ils, grâce à elles. Hypersensibilisés, ils affirment communiquer directement avec la nature et le cosmos, perçus comme anthropomorphes.
Considérée ainsi, la drogue semble donc être, comme pour les indiens, un véhicule. Mais, dans les cultures occidentales il n’existe pas un « ailleurs » bien défini où ce véhicule permettrait de se rendre, même si tout un vocabulaire a surgi pour exprimer les effets du voyage (« vibration », « flip », « stone », etc.), même si certaines musiques, poésies ou peintures sont censées en déterminer le cours. Le voyage, dans nos sociétés est infiniment moins structuré que dans les sociétés traditionnelles. Il nous est en quelque sorte « extérieur ».
Ce qui permet à chaque groupe social, en Occident, de tenir sur la drogue, ses effets et les raisons de sa consommation, un discours qui reflète ses valeurs culturelles spécifiques qu’elles soient « populaires », « bourgeoises », « intellectuelles » ou autres. Ainsi par exemple les chantres de la culture « underground » assuraient que la toxicomanie allait permettre l’expérience de valeurs nouvelles – le rêve, le nomadisme, le retour à la nature, etc. – qu’ils définissaient évidemment par opposition aux idéaux alors dominants.
Chez les indiens l’usage de la drogue
est strictement codifié
Dans les sociétés traditionnelles, l’usage de la drogue, comme d’ailleurs l’accès au surnaturel, est très codifié. N’y sont autorisés que quelques personnes bien définies (le chamane, le sorcier, le prêtre, etc.) ou alors des groupes restreints dans des occasions très spécifiques: initiations, rituels, fêtes annuelles. Enfreindre les règles, c’est susciter une punition « sacrée ». Chez les Guajiro, boire le jus de tabac sans droit, c’est risquer une maladie grave, punition infligée par les êtres surnaturels.
Le droit à la drogue est donc un signe distinctif qui peut, dans d’autres sociétés, séparer les initiés des non-initiés, les vieux des jeunes, les hommes des femmes, ceux qui ont le pouvoir de ceux qui ne l’ont pas. Par exemple, dans la société inca, l’usage de la coca était réservé aux prêtres et aux « curaca », les chefs locaux; tout manquement à cette règle, parce qu’il était une atteinte à leur autorité, était puni. Dans de nombreuses sociétés, enfin, la drogue est associée au travail. Chez les Guajiro, la consommation d’alcool accompagne et encourage les travaux collectifs. Au Pérou, la coca semble avoir servi, depuis l’époque coloniale, à faire travailler les indiens en dépit de la faim.
En revanche, dans nos sociétés occidentales, les comportements sociaux face à la drogue sont très variables – est-elle bonne, néfaste, tolérable? Aucun point de vue fixe. Suivant leur situation dans la société, les uns font l’éloge de la drogue: force créatrice, qui élève l’âme et assure l’indépendance, les autres la maudissent: force de destruction, de déchéance, de dépendance.
Même les législateurs sont peu sûrs de leur fait. En 1937, par exemple, le Congrès américain interdit la consommation de marijuana qu’il jugeait encore criminogène. En 1965, il la condamne non plus comme criminogène mais comme antisociale; il l’associe alors aux attitudes « subversives » des non-violents.
Il y a là, soit dit en passant, confusion entre les défauts attribués à une minorité et les effets supposés de la drogue que tous ses membres sont censés consommer. Ce qui permet de penser que ceux qui dénoncent la consommation de drogue le font parfois, consciemment ou non, pour vouer un groupe entier à la réprobation sociale: il semble que tel fut le cas lorsque les États-Unis, au début du siècle, prohibèrent l’usage de l’opium, associé dans l’opinion avec la communauté chinoise, jugée « contaminante », mais qui, surtout, était ressentie comme dangereusement concurrente sur le marché du travail.
Chez nous, la drogue est tantôt louée,
tantôt maudite, elle obéit aux modes…
Plus symptomatique encore, peut- être, le discours des médecins sur la nature épidémique de la toxicomanie (ne parlent-ils pas de « contamination », « prédisposition », « terrain à haut risque », etc.?). En effet, si la toxicomanie est épidémique et donc contagieuse, il en découle logiquement que le toxicomane, deve-nu véritable symbole de toutes les valeurs négatives d’une société, doit être socialement « contrôlé ».
Mais la drogue dans nos sociétés, parce qu’elle est précisément un signe sans cesse changeant, peut aussi être rejetée par un groupe qui la consommait, si elle se banalise, et qu’elle ne leur permet plus de se démarquer. Ainsi du cannabis qui, aux États-Unis, s’est généralisé au point que certains États ont même songé à le légaliser: les groupes qui en faisaient un signe de leur marginalité semblent en train de l’abandonner, en quête de nouveaux moyens de se distinguer.
Cette perspective, si elle est exacte, permet de penser que répression ou libéralisation de la consommation de drogue pourrait bien avoir des résultats exactement contraires à ceux que l’on en escompte, et que l’escalade ou la chute de la courbe de toxicomanie pourrait obéir à des lois paradoxales.
Tous ces éléments suggèrent que nos sociétés se préoccupent moins des drogues pour leur toxicité que pour ce qu’elles y voient de défi à l’ordre social. La preuve banale en est que des produits qui, comme l’alcool, font, quantitativement, bien plus de ravages que la drogue, ou, comme les médicaments tranquillisants, coûtent globalement bien plus cher, sont en vente libre; c’est que ni l’alcool ni les tranquillisants ne sont perçus comme « subversifs ». Il faut rappeler aussi que la drogue sous toutes ses formes est, dans les sociétés occidentales, un bien économique important – qu’il s’agisse d’alcool, de médicaments, ou de drogues interdites enrichissant gros producteurs et trafiquants internationaux. Dans l’histoire récente, l’administration coloniale française prescrivait même la vente de quantités minimales d’alcool et d’opium en Indochine, pour le bien du Trésor; l’Angleterre déversait les surplus de sa production de whisky sur les populations australiennes et mélanésiennes.
Se droguer devient parfois un acte
de rébellion contre les Blancs
Dans de nombreuses sociétés colonisées par l’Occident, des mouvements dits « messianiques » ou « nativistes » se sont développés depuis longtemps, qui, dénonçant la répartition inégale des richesses, et le décalage énorme qui existe entre les valeurs proclamées par les Occidentaux et leurs pratiques colonisatrices, réclament l’avènement d’une « société nouvelle » ou le retour à un « état originel » jugé supérieur.
Ces mouvements prônent souvent l’usage de la drogue ou de techniques corporelles provoquant un état de perception extraordinaire, pour faciliter la prise de conscience de leurs adeptes et répandre plus aisément leurs idées. Ainsi, le mouvement des Tupi-Guarani d’Amérique du Sud, pratiquant danses et jeûnes intenses afin d’atteindre la « Terre-sans-Mal »; celui de nombreux groupes indiens d’Amérique du Nord recourant au peyotl et à la « Danse-du-Soleil » pour exprimer leur rébellion contre la société américaine; celui des indiens du Pérou qui, au XVIIIe siècle, se rallièrent à la religion syncrétique et rebelle de Santés Atahualpa, qui prônait l’usage généralisé de la coca; celui des indiens Tukano qui, vers 1850, se livrèrent à des beuveries et des flagellations à l’appel de l’un d’eux, qui se disait émissaire de Dieu.
Aux Nouvelles-Hébrides, l’ingestion excessive de kava (Piper methysticam) stimulait les zélateurs du « cargo », mouvement contestataire déclenché, au milieu de ce siècle, par des prophètes indigènes. Les exemples sont infiniment nombreux. Le dernier en date étant peut-être le mouvement de rébellion suscité dans les Caraïbes par Bob Marley…
Dans tous ces cas, la drogue n’induit plus un « voyage psychédélique », mais tout au contraire menace l’ordre social, en stimulant la contestation, ou l’expression ouverte du désespoir. Elle est devenue un catalyseur. Son mode de consommation en est profondément modifié; le rituel ancien est subverti, remplacé par un usage nouveau, impliquant fréquemment une ingestion abusive, par un nombre croissant de personnes.
mais la drogue « populaire » se répand…
En Occident, intellectuels et artistes ont invoqué volontiers aussi cet effet « désinhibant » et dynamisant de la drogue. Baudelaire et d’autres écrivains du XIXe siècle demandaient au haschich et à l’opium de les aider à créer. Les écrivains américains de la « contre-culture » préconisent la drogue comme moyen d’accéder à une conscience nouvelle. (En revanche la toxicomanie des classes modestes est vue comme une « déchéance » justifiant un contrôle social).
La grande vague de toxicomanie qui a commencé en Europe autour de mai 68 obéit en fait au modèle américain de la « contre-culture ». Elle s’est développée essentiellement en milieu lycéen et étudiant. Des chercheurs ont suggéré une explication sociologique à ce phénomène. Les jeunes qui ont eu recours à la drogue appartenaient pour la plupart à un milieu social relativement homogène, disons bourgeois et/ou intellectuel.
L’hypothèse est que ces jeunes ont perçu alors, plus ou moins consciemment, que la réussite sociale à laquelle ils étaient théoriquement promis allait se heurter à un nouveau contexte socio-économique. Leur pressentiment de déclassement et de frustration se serait alors traduit par un rejet de la culture de leurs aînés, exprimé et stimulé à la fois par l’usage de la drogue.
Se droguer aurait été pour eux le signe qu’ils appartenaient à une classe d’âge « libérée » et « inspirée », et qu’ils entendaient, grâce aux perceptions extraordinaires que permettent les hallucinogènes, accéder à une mentalité nouvelle, très différente de celle de leurs aînés.
Mais l’ordre social n’a pas été bouleversé, aucune culture nouvelle ne s’est imposée, l’usage de la drogue comme signe de libération et de contestation devrait donc s’estomper. D’autant que les générations actuelles de jeunes gens, plus contraints, nourrissant moins d’illusions, sont mieux adaptées à la situation socio-économique critique prévalant aujourd’hui en Occident.
Par ailleurs, la « mode » de la drogue s’est répandue, s’est « démocratisée »; sa valeur de signe distinctif s’est donc effritée. La toxicomanie affecte désormais les milieux bourgeois adultes et, surtout, les jeunes des « milieux populaires » qui expriment sans doute, par la drogue, l’alcool, la violence, leur angoisse face à une crise économique dont ils sont les premières victimes. C’est là une raison de plus pour penser que le milieu lycéen et étudiant cherchera bientôt de nouvelles manières d’être différent.
Malheureusement, aucune statistique n’a été compilée qui permette de savoir si l’augmentation actuelle du nombre absolu de toxicomanes reflète une hausse de la consommation dans toutes les couches de la population, ou un simple glissement de cette consommation des classes favorisées, vers les classes modestes, dont les effectifs sont plus nombreux.
Peut-être nous reprochera-t-on de proposer du phénomène de la drogue, une vision trop détachée. Mais l’anthropologie ne peut faire l’économie de cette distance par rapport aux individus et à leur drame personnel. Grâce à ce détachement, on comprend mieux les paradoxes extraordinaires que recèle la drogue, associée tout à la fois au bon et au mauvais, à l’interdit et au prescrit, à la liberté et à la dépendance, au religieux et au profane, à la vie et à la mort, à « l’acte gratuit » et à l’exploitation économique. La drogue se situe à la charnière de l’individuel et du social, du physique et du mental; pour cela elle permet un jeu social et un jeu intellectuel d’une ampleur exceptionnelle, suffisant peut-être à expliquer son développement quasiment universel.
Ce texte est paru dans Le Temps stratégique, No 12, printemps 1985.
Bibliographie
Hallucinogènes et société, par P. Alain. Paris, Payot, 1973.
La chair des dieux: l’usage rituel des psychédéliques, par P. T. Furst. Paris, Seuil, 1974.
Hallucinogens and Shamanism, éd. par J. M. Harner. New York, Oxford University Press, 1973.
« Drogues, déclassements et stratégies de disqualification », par P. Pinell et M. Zafiropoulos. In: Actes de la Recherche en Sciences sociales, No 42, avril 1982.
L’expérience hallucinogène, par J. P. Valla. Paris, Masson, 1983.
Soma, Divine Mushroom of Immortality, par R. G. Wassoll. New York, Harcourt Blanc Jovanovitch, 1968.
Drogue et civilisation Refus social ou acceptation. Entretiens de Rueil du 16 mars 1981, publiés sous la direction de G. Nahas. Paris, Pergarmon Press, France, 1982.
« Drogue et Société » (dossier collectif), Esprit, No 11-12, 1980.
Rausch und Realität, Drogen im Kulturvergleich, Cologne, Rautenstrauch-Joest-Museum Köln, 1981, 2 vol.