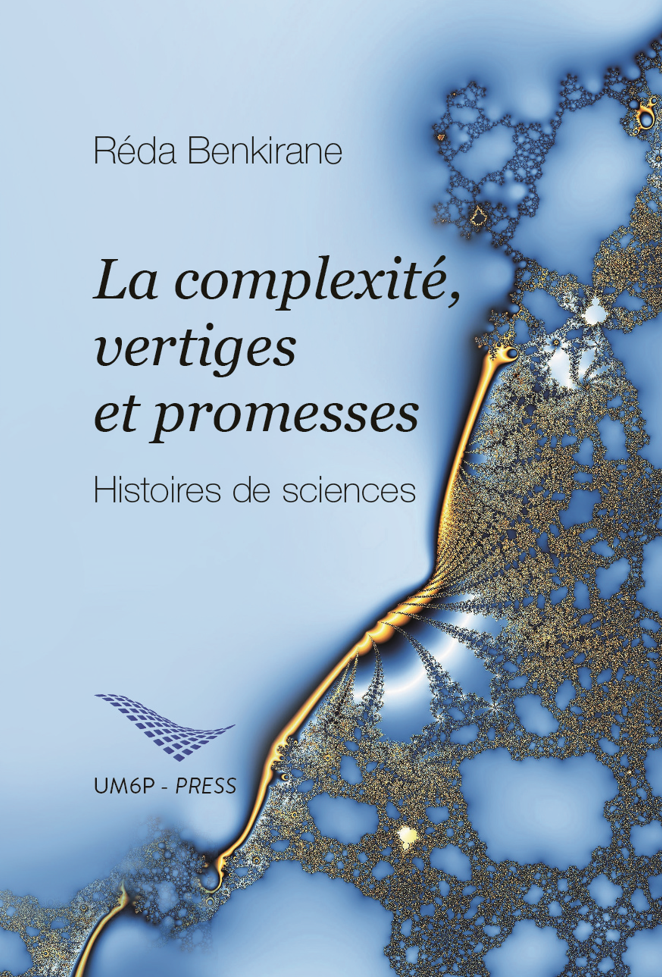L’universel sans totalité
[extraits]
 L’écriture et l’universel totalisant
L’écriture et l’universel totalisant
Pour bien comprendre la mutation contemporaine, il faut passer par un retour réflexif
sur la première grande transformation dans l’écologie des médias : le passage des
cultures orales aux cultures de l’écriture. L’émergence du cyberespace aura
probablement a même déjà aujourd’hui sur la pragmatique des communications
un effet aussi radical que l’eut en son temps l’invention de l’écriture.
Dans les sociétés orales, les messages linguistiques étaient toujours reçus dans le
temps et le lieu où ils étaient émis. Émetteurs et récepteurs partageaient une identique
situation et, la plupart du temps, un semblable univers de signification. Les acteurs
de la communication plongeaient dans le même bain sémantique, dans le même
contexte, dans le même flux vivant d’interaction.
L’écriture a ouvert un espace de communication inconnu des sociétés orales, dans
lequel il devenait possible de prendre connaissance de messages produits par des
personnes situées à des milliers de kilomètres, ou mortes depuis des siècles, ou bien
s’exprimant depuis d’énormes distances culturelles ou sociales. Désormais, les
acteurs de la communication ne partageaient plus nécessairement la même situation,
ils n’étaient plus en interaction directe.
Subsistant hors de leurs conditions d’émission et de réception, les messages écrits se
tiennent « hors contexte ». Cet « hors contexte » qui ne relève d’abord que de
l’écologie des médias et de la pragmatique de la communication a été légitimé,
sublimé, intériorisé par la culture. Il deviendra le noyau d’une certaine rationalité et
mènera finalement à la notion d’universalité.
Il est difficile de comprendre un message quand il est séparé de son contexte vivant
de production. C’est pourquoi, du côté de la réception, on inventa les arts de
l’interprétation, de la traduction, toute une technologie linguistique (grammaires,
dictionnaires…). Du côté de l’émission, on s’efforça de composer des messages qui
soient capables de circuler partout, indépendants de leurs conditions de production,
qui contiennent autant que possible en eux-mêmes leurs clés d’interprétation, ou leur
« raison ». À cet effort pratique correspond l’Idée de l’Universel. En principe, il
n’est pas besoin de faire appel à un témoignage vivant, à une autorité extérieure, à
des habitudes ou à des éléments d’un environnement culturel particulier pour
comprendre et admettre les propositions énoncées dans Les Éléments d’Euclide. Ce
texte comprend en lui-même les définitions et les axiomes à partir desquels découlent
nécessairement les théorèmes. Les Éléments sont un des meilleurs exemples du type
de message autosuffisant, auto-explicatif, enveloppant ses propres raisons, qui serait
sans pertinence dans une société orale.
La philosophie et la science classiques, chacune à leur manière, visent l’universalité.
Nous faisons l’hypothèse que c’est parce qu’elles ne peuvent être séparées du
dispositif de communication instauré par l’écrit. Les religions « universelles » (et je
ne parle pas seulement des monothéismes : pensons au Bouddhisme) sont toutes
fondées sur des textes. Si je veux me convertir à l’Islam, je peux le faire à Paris, à
New-York ou à la Mecque. Mais si je veux pratiquer la religion Bororo (à supposer
que ce projet ait un sens) je n’ai pas d’autre solution que d’aller vivre avec les
Bororos. Les rites, mythes, croyances et modes de vie Bororo ne sont pas
« universels » mais contextuels ou locaux. Ils ne reposent en aucune manière sur
un rapport aux textes écrits. Ce constat n’implique évidemment aucun jugement de
valeur ethnocentrique : un mythe Bororo appartient au patrimoine de l’humanité et
peut virtuellement émouvoir n’importe quel être pensant. Par ailleurs, des religions
particularistes ont aussi leurs textes : l’écriture ne détermine pas automatiquement
l’universel, elle le conditionne (pas d’universalité sans écriture).
Comme les textes scientifiques ou philosophiques qui sont censés rendre raison
d’eux-mêmes, contenir leurs propres fondements et porter avec eux leurs conditions
d’interprétation, les grands textes des religions universalistes enveloppent par
construction la source de leur autorité. En effet, l’origine de la vérité religieuse est la
révélation. Or la Thora, les Évangiles, le Coran, sont la révélation elle-même ou le
récit authentique de la révélation. Le discours ne se place plus sur le fil d’une
tradition qui tient son autorité du passé, des ancêtres ou de l’évidence partagée d’une
culture. Le texte seul (la révélation) fonde la vérité, échappant ainsi à tout contexte
conditionnant. Grâce au régime de vérité qui s’appuie sur un texte révélation, les
religions du livre se libèrent de la dépendance à un milieu particulier et deviennent
universelles.
Notons au passage que « l’auteur » (typique des cultures écrites) est, à l’origine, la
source de l’autorité, tandis que « l’interprète » (figure centrale des traditions orales)
ne fait qu’actualiser ou moduler une autorité qui vient d’ailleurs. Grâce à l’écriture,
les auteurs, démiurgiques, inventent l’autoposition du vrai.
Dans l’universel fondé par l’écriture, ce qui doit se maintenir inchangé par
interprétations, traductions, translations, diffusions, conservations, c’est le sens. La
signification du message doit être la même ici et là, aujourd’hui et naguère. Cet
universel est indissociable d’une visée de clôture sémantique. Son effort de
totalisation lutte contre la pluralité ouverte des contextes traversés par les messages,
contre la diversité des communautés qui les font circuler. De l’invention de l’écriture
s’ensuivent les exigences très spéciales de la décontextualisation des discours.
Depuis cet événement, la maîtrise englobante de la signification, la prétention au
« tout », la tentative d’instaurer en chaque lieu le même sens (ou, pour la science, la
même exactitude) est pour nous associé à l’universel.
Médias de masse et totalité
Les médias de masse : presse, radio, cinéma, télévision, tout au moins dans leur
configuration classique, poursuivent la lignée culturelle de l’universel totalisant
initiée par l’écrit. Comme le message médiatique sera lu, écouté, regardé par des
milliers ou des millions de personnes dispersées, on le compose de telle sorte qu’il
rencontre le « commun dénominateur » mental de ses destinataires. Il vise les
récepteurs au minimum de leur capacité interprétative. Ce n’est pas ici le lieu de
développer tout ce qui distingue les effets culturels des médias électroniques de ceux
de l’imprimerie. Je veux seulement souligner ici une similitude. Circulant dans un
espace privé d’interaction, le message médiatique ne peut exploiter le contexte
particulier où plonge le récepteur, il néglige sa singularité, ses adhérences sociales,
sa micro-culture, son moment et sa situation spéciale. C’est ce dispositif à la fois
réducteur et conquérant qui fabrique le « public » indifférencié, la « masse » des
médias de masse. Universalisants par vocation, les médias totalisent mollement sur
l’attracteur émotionnel et cognitif le plus bas, pour le « spectacle » contemporain,
ou , de manière beaucoup plus violente, sur la propagande du parti unique, pour les
totalitarismes classiques du XXe siècle : fascisme, nazisme et stalisnisme.
Cependant, les médias électroniques portent une deuxième tendance, complémentaire
de la première. La décontextualisation que nous venons d’évoquer instaure
paradoxalement un autre contexte, holistique, quasi tribal, mais à plus grande échelle
que dans les sociétés orales. La télévision, en interaction avec les autres médias, fait
surgir un plan d’existence émotionnel qui réunit les membres de la société dans une
sorte de macro-contexte fluctuant, sans mémoire, en évolution rapide. Cela se
perçoit notamment dans les phénomènes de « direct » et en général lorsque
« l’actualité » se fait brûlante. Il faut reconnaître à McLuhan d’avoir le premier
décrit ce caractère des sociétés médiatiques. La principale différence entre le contexte
médiatique et le contexte oral est que les téléspectateurs, s’ils sont impliqués
émotionnellement dans la sphère du spectacle ne peuvent jamais l’être pratiquement.
Par construction, sur le plan d’existence médiatique, ils ne sont jamais acteurs.
La véritable rupture avec la pragmatique de la communication instaurée par l’écriture
ne peut se faire jour avec la radio ou la télévision, car ces instruments de diffusion
massive ne permettent ni de véritable réciprocité, ni d’interactions transversales entre
participants. Le contexte global instauré par les médias, au lieu d’émerger des
interactions vivantes d’une ou plusieurs communautés, se tient hors de portée de
ceux qui n’en consomment que la réception passive, isolée.
Complexité des modes de totalisation
Nombre de formes culturelles dérivées de l’écriture ont vocation à l’universalité,
mais chacune totalise sur un attracteur différent : les religions universelles sur le
sens, la philosophie (y compris la philosophie politique) sur la raison, la science sur
l’exactitude reproductible (les faits), les médias sur une captation dans un spectacle
sidérant baptisée « communication ». Dans tous les cas la totalisation s’opère sur
l’identité de la signification. Chacune à leur manière, ces machines culturelles tentent
de rejouer, sur le plan de réalité qu’elles inventent, une manière de coïncidence avec
eux-mêmes des collectifs qu’ils rassemblent. L’universel? Une sorte d’ici et
maintenant virtuel de l’humanité. Or, quoiqu’elles aboutissent à une réunion par un
aspect de leur action, ces machines à produire de l’universel décomposent par
ailleurs une multitude de micro-totalités contextuelles : paganismes, opinions,
traditions, savoirs empiriques, transmissions communautaires et artisanales. Et ces
destructions de local sont elles-mêmes imparfaites, ambiguës, car les produits des
machines universelles sont en retour presque toujours phagocytés, relocalisés,
mélangés aux particularismes qu’ils voudraient transcender. Quoique l’universel et la
totalisation (la totalisation, c’est-à-dire la clôture sémantique, l’unité de la raison, la
réduction au commun dénominateur, etc.) aient depuis toujours partie liée, leur
conjonction recèle de fortes tensions, de douloureuses contradictions que la nouvelle
écologie des médias polarisée par le cyberespace permettra peut-être de dénouer. Un
tel dénouement, soulignons-le avec force, n’est en aucune manière garanti ni
automatique. L’écologie des techniques de communication propose, les acteurs
humains disposent. Ce sont eux qui décident en dernier ressort, délibérément ou
dans la semi-inconscience des effets collectifs, de l’univers culturel qu’ils
construisent ensemble. Encore faut-il qu’ils aient aperçu la possibilité de nouveaux
choix.
La cyberculture ou l’universel sans totalité
En effet, l’événement culturel majeur annoncé par l’émergence du cyberespace est le
débrayage entre ces deux opérateurs sociaux ou machines abstraites (bien plus que
des concepts!) que sont l’universalité et la totalisation. La cause en est simple : le
cyberespace dissout la pragmatique de communication qui, depuis l’invention de
l’écriture, avait conjoint l’universel et la totalité. Il nous ramène, en effet, à la
situation d’avant l’écriture mais à une autre échelle et sur une autre orbite dans la
mesure où l’interconnexion et le dynamisme en temps réel des mémoires en ligne fait
de nouveau partager le même contexte, le même immense hypertexte vivant aux
partenaires de la communication. Quel que soit le message abordé, il est connecté à
d’autres messages, à des commentaires, à des gloses en évolution constante, aux
personnes qui s’y intéressent, aux forums où l’on en débat ici et maintenant.
N’importe quel texte est le fragment qui s’ignore peut-être de l’hypertexte mouvant
qui l’enveloppe, le connecte à d’autres textes et sert de médiateur ou de milieu à une
communication réciproque, interactive, ininterrompue. Sous le régime classique de
l’écriture, le lecteur est condamné à réactualiser le contexte à grands frais, ou bien à
s’en remettre au travail des Églises, des institutions ou des Écoles, acharnées à
ressusciter et boucler le sens. Or aujourd’hui, techniquement, du fait de l’imminente
mise en réseau de toutes les machines de la planète, il n’y a quasiment plus de
messages « hors contexte », séparés d’une communauté active. Virtuellement, tous
les messages sont plongés dans un bain communicationnel grouillant de vie, incluant
les personnes elles-mêmes, dont le cyberespace apparaît progressivement comme le
coeur.
La Poste, le Téléphone, la Presse, l’Édition, les Radios, les innombrables chaînes de
Télévision forment désormais la frange imparfaite, les appendices partiels et tous
différents d’un espace d’interconnexion ouvert, animé de communications
transversales, chaotique, tourbillonnant, fractal, mû par des processus magmatiques
d’intelligence collective. Certes, on ne se baigne jamais deux fois dans le même
fleuve informationnel, mais la densité des liens et la rapidité des circulations sont
telles que les acteurs de la communication n’ont plus de difficulté majeure à partager
le même contexte, même si cette situation est quelque peu glissante, floue et souvent
brouillée.
L’interconnexion généralisée, utopie minimale et moteur primaire de la croissance de
l’Internet, émerge comme une forme nouvelle de l’universel. Attention! Le
processus en cours d’interconnexion mondiale réalise bel et bien une forme de
l’universel, mais ce n’est pas la même qu’avec l’écriture statique. Ici, l’universel ne
s’articule plus sur la clôture sémantique appelée par la décontextualisation, tout au
contraire. Cet universel ne totalise plus par le sens, il relie par le contact, par
l’interaction générale.
L’universel n’est pas le planétaire
On dira peut-être qu’il ne s’agit pas là proprement de l’universel mais du planétaire,
du fait géographique brut de l’extension des réseaux de transport matériel et
informationnel, du constat technique de la croissance exponentielle du cyberespace.
Pire encore, sous couvert d’universel, n’est-il pas seulement question du pur et
simple « global », celui de la « globalisation » de l’économie ou des marchés
financiers? Certes, ce nouvel universel contient une forte dose de global et de
planétaire, mais il ne s’y limite pas. L’ universel par « contact » est encore de
l’universel, au sens le plus profond, parce qu’il est indissociable de l’idée
d’humanité. Même les plus farouches contempteurs du cyberespace rendent
hommage à cette dimension lorsqu’ils regrettent, à juste titre, que le plus grand
nombre en soit exclu ou que l’Afrique n’y ait aucune part. Que révèle la
revendication de « l’accès à tous » ? Elle montre que la participation à cet espace qui
relie chaque être humain à n’importe quel autre, qui peut faire communiquer les
communautés entre elles et avec elles-mêmes, qui supprime les monopoles de
diffusion et autorise chacun à émettre pour qui est concerné ou intéressé, cette
revendication révèle, dis-je, que la participation à cet espace relève d’un droit, et que
sa construction s’apparente à une sorte d’impératif moral.
En somme, le cyberespace donne forme à une nouvelle espèce d’universel :
l’universel sans totalité. Et, répétons-le, c’est encore d’universel qu’il s’agit,
accompagné de toutes les résonances que l’on voudra avec la philosophie des
lumières, parce qu’il entretient un profond rapport avec l’idée d’humanité. En effet,
le cyberespace n’engendre pas une culture de l’universel parce qu’il est partout en
fait, mais parce que sa forme ou son idée implique en droit l’ensemble des êtres
humains.
Plus c’est universel, moins c’est totalisable
Par l’intermédiaire des ordinateurs et des réseaux, les gens les plus divers peuvent
entrer en contact, se tenir la main tout autour du monde. Plutôt que de se construire
sur l’identité du sens, le nouvel universel s’éprouve par immersion. Nous sommes
tous dans le même bain, dans le même déluge de communication. Il n’est donc plus
question de clôture sémantique ou de totalisation.
Une nouvelle écologie des médias s’organise autour de l’extension du cyberespace.
Nous pouvons maintenant énoncer son paradoxe central : plus c’est universel
(étendu, interconnecté, interactif), moins c’est totalisable. Chaque connexion
supplémentaire ajoute encore de l’hétérogène, de nouvelles sources d’information, de
nouvelles lignes de fuites, si bien que le sens global est de moins en moins lisible,
de plus en plus difficile à circonscrire, à clore, à maîtriser. Cet universel donne accès
à une jouissance du mondial, à l’intelligence collective en acte de l’espèce. Il nous
fait participer plus intensément à l’humanité vivante, mais sans que cela soit
contradictoire, au contraire, avec la multiplication des singularités et la montée du
désordre.
De nouveau : plus se concrétise ou s’actualise le nouvel universel et moins il est
totalisable. On est tenté de dire qu’il s’agit enfin du véritable universel, parce qu’il ne
se confond plus avec du local gonflé ou avec l’exportation forcée des produits d’une
culture particulière. Anarchie? Désordre? Non. Ces mots ne reflètent que la nostalgie
de la clôture. Accepter de perdre une certaine forme de maîtrise, c’est se donner une
chance de rencontrer le réel. Le cyberespace n’est pas désordonné, il exprime la
diversité de l’humain. Qu’il faille inventer les cartes et les instruments de navigation
de ce nouvel océan, voilà ce dont chacun peut convenir. Mais il n’est pas nécessaire
de figer, de structurer a priori, de bétonner un paysage par nature fluide et varié :
une excessive volonté de maîtrise ne conduirait, comme souvent, qu’à l’aveuglement
et à la destruction. Les tentatives de fermeture deviennent pratiquement impossibles
ou trop évidemment abusives.
Pourquoi inventer un « universel sans totalité » quand nous disposons déjà du riche
concept de postmodernité? C’est qu’il ne s’agit justement pas de la même chose. La
philosophie postmoderne a bien décrit l’éclatement de la totalisation. En trois mots,
et pour reprendre l’expression bien venue de Lyotard : la fin des grands récits. La
multiplicité et l’enchevêtrement radical des époques, des points de vue et des
légitimités, trait distinctif du postmoderne, est d’ailleurs nettement accentuée et
encouragée dans le cyberespace. Mais la philosophie postmoderne a confondu
l’universel et la totalisation. Son erreur fut de jeter le bébé de l’universel avec l’eau
sale de la totalité.
Qu’est-ce que l’universel ? C’est la présence (virtuelle) à soi-même de l’humanité.
Quant à la totalité, on peut la définir comme le rassemblement stabilisé du sens d’une
pluralité (discours, situation, ensemble d’événements, système, etc.). Cette identité
globale peut se boucler à l’horizon d’un processus complexe, résulter du
déséquilibre dynamique de la vie, émerger des oscillations et contradictions de la
pensée. Mais quelle que soit la complexité de ses modalités, la totalité reste encore
sous l’horizon du même.
Or la cyberculture montre précisément qu’il existe une autre manière d’instaurer une
présence virtuelle à soi de l’humanité (l’universel) que par une identité du sens (la
totalité).
Extraits de Cyberculture, rapport au Conseil de l’Europe de Pierre Lévy. Paris, Odile Jacob, 1998.