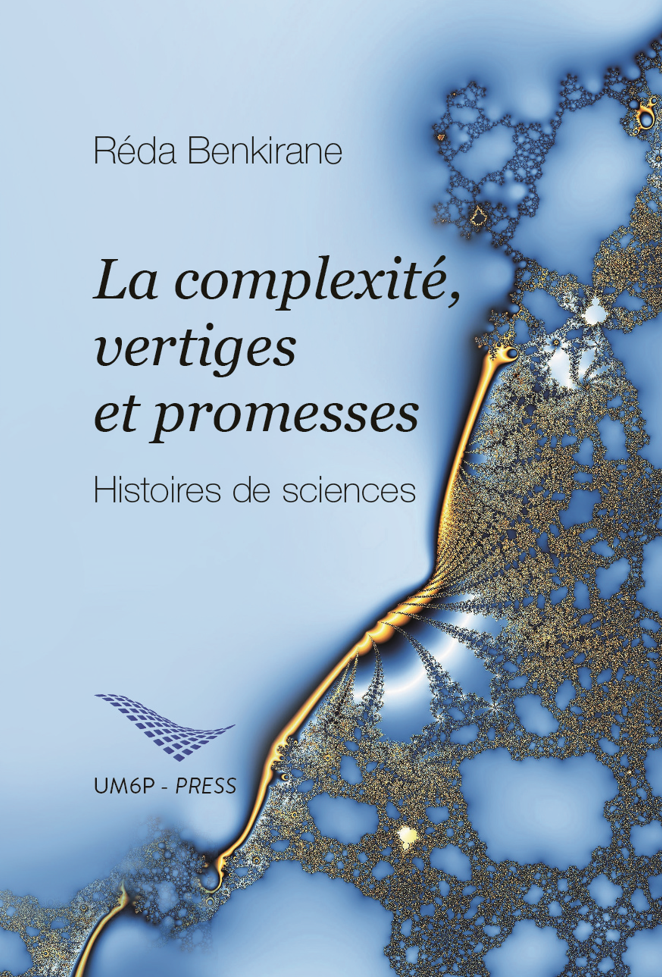Le son de la cyberculture
 [extraits]
[extraits]
La mondialisation de la musique
La musique populaire d’aujourd’hui est à la fois mondiale, éclectique et changeante,
sans système unificateur. On y reconnaît certains traits caractéristiques de l’universel
sans totalité. À l’échelle historique, cet état est fort récent. La première étape vers
une musique universelle sans totalisation a été franchie grâce à l’enregistrement
sonore et à la diffusion radiophonique. Lorsque l’on étudie les premiers catalogues
de disques, qui datent du début du XXe siècle, on découvre un paysage musical bien
plus morcelé et figé que celui qui nous est aujourd’hui familier. À cette époque, les
gens n’avaient pas l’oreille faite à l’écoute de musiques venant de lointains horizons
et voulaient entendre ce qu’ils avaient toujours connu. Chaque pays, voire chaque
région ou micro-région avait donc ses chanteurs, ses chansons dans son dialecte,
appréciait des airs et des instruments spécifiques. Quasiment tous les disques de
musique populaire étaient enregistrés par des musiciens locaux, pour un public local.
Seuls les disques enregistrant la musique savante de la tradition écrite occidentale
possédèrent d’emblée un auditoire international.
Près d’un siècle plus tard, la situation a radicalement changé puisque la musique
populaire enregistrée est bien souvent « mondiale ». De plus, elle est en variation
permanente puisqu’elle ne cesse d’intégrer les apports de traditions locales originales
ainsi que les expressions de nouveaux courants culturels et sociaux.
Deux séries entremêlées de mutations expliquent le passage d’un état à l’autre du
paysage musical international : l’une fait intervenir les transformations générales de
l’économie et de la société (mondialisation, développement des voyages, extension
d’un style de vie urbain et suburbain international, mouvements culturels et sociaux
de la jeunesse, etc.) sur lequel nous n’insisterons pas ici ; l’autre concerne les
conditions économiques et technique de l’enregistrement, de la distribution et de
l’écoute de la musique.
La diffusion des enregistrements provoqua sur la musique populaire des
phénomènes de standardisation comparables à ceux de l’imprimerie sur les langues.
En effet, au XVe siècle, dans des pays comme la France, l’Angleterre ou l’Italie, il
existait autant de « parlers » que de micro-régions rurales. Or un livre devait viser
un marché suffisamment étendu pour que son impression fut rentable. Comme on
imprimait des ouvrages en langue vernaculaire, et non plus seulement en latin, il
fallait choisir parmi les parlers locaux pour en extraire « la » langue nationale. Le
toscan, le dialecte de touraine, l’anglais de la cour devinrent l’italien, le
français et l’anglais, reléguant, avec l’aide des administrations royales, les
autres parlers au rang de patois. Dans sa traduction de la Bible, Luther amalgama
différents dialectes germaniques et contribua ainsi à forger « la » langue allemande,
c’est-à-dire l’allemand écrit.
Pour des raisons analogues, l’évolution des catalogues de disques de musique
populaire depuis le début du XXe siècle montre qu’à partir de la fragmentation
initiale, il se crée progressivement des musiques nationales et internationales. Cette
mutation est particulièrement sensible dans les pays non occidentaux, où
l’urbanisation et l’influence culturelle d’un État central étaient encore relativement
limitées au début du siècle. Le fait que la musique soit indépendante des langues (à
l’exception notable des paroles des chansons) a évidemment facilité ce phénomène
de désenclavement. Si l’écriture décontextualise la musique, son enregistrement et sa
reproduction créent progressivement un contexte sonore mondial… et les oreilles qui
lui correspondent.
Tant que la qualité des enregistrements n’eut pas dépassé un certain seuil, la radio ne
diffusa que des morceaux joués en directs. Lorsque les stations à modulation de
fréquence, qui ne se répandirent qu’après la Seconde Guerre mondiale,
commencèrent à diffuser des disques de bonne qualité sonore, le phénomène de la
musique mondiale de masse prit son essor, avec notamment le rock et la pop dans
les années soixante et soixante dix.
On aurait pu imaginer que la mondialisation de la musique amènerait une
homogénéisation définitive, une sorte d’entropie musicale où les styles, les traditions
et les différences finiraient par se fondre dans une même bouillie uniforme. Or, si la
« soupe » est bien présente, fort heureusement, la musique populaire du monde ne
s’y réduit pas. Certaines zones du paysage musical, on pense notamment à celles
qu’irrigue la circulation des cassettes dans le Tiers-monde, restent protégées ou
déconnectées du marché international. La musique mondiale continue à s’alimenter
de ces isolats imperceptibles mais très vivants, des anciennes traditions locales, ainsi
que d’une créativité poétique et musicale intarissable et largement distribuée. De
nouveaux genres, de nouveaux styles, de nouveaux sons apparaissent constamment,
recréant les différences de potentiels qui agitent l’espace musical planétaire.
La dynamique de la musique populaire mondiale offre bien une image approchée de
l’universel sans totalité. Universel par la diffusion d’une musique et d’une écoute
planétaire ; sans totalité puisque les styles mondiaux sont multiples, en voie de
transformation et de renouvellement constants.
Mais la figure exemplaire du nouvel universel n’apparaît dans toute sa précision
qu’avec la numérisation, et plus particulièrement avec la musique techno : le son de
la cyberculture. Afin de bien saisir l’originalité de la musique techno, qui tient à son
processus de création et de circulation, nous devons, de nouveau, faire un détour par
les modes antérieurs de transmission et de renouvellement de la musique.
Musique orale, écrite, enregistrée
Dans les sociétés de culture orale, la musique se reçoit par écoute directe, se diffuse
par imitation, évolue par réinvention de thèmes et de genres immémoriaux. La
plupart des airs n’ont pas d’auteurs identifiés, ils appartiennent au « fond » de la
tradition. Certes, poètes et musiciens sont capables d’inventer des chansons, et
même de gagner en leur propre nom des prix ou des concours. Le rôle créateur des
individus n’est donc pas ignoré. Il reste que la figure du grand interprète, celui qui
transmet une tradition en lui insufflant une vie nouvelle, est plus répandu dans les
cultures orales que celle du grand « compositeur ».
L’écriture de la musique autorise une nouvelle forme de transmission, non plus de
corps à corps, de l’oreille à la bouche et de la main à l’oreille, mais par le texte. Si
l’interprétation, c’est-à-dire l’actualisation sonore, continue à faire l’objet d’une
initiation, d’une imitation et d’une réinvention continue, la part écrite de la musique,
sa composition, est désormais fixée, détachée du contexte de la réception.
Fondé sur l’écriture et sur une combinatoire de sons aussi neutre que possible
(détachée d’adhérences magiques, religieuses ou cosmologiques), le système
musical occidental se présente comme « universel » et il est d’ailleurs enseigné
comme tel dans les conservatoires du monde entier.
L’apparition d’une tradition écrite renforce la figure du compositeur qui signe une
partition et prétend à l’originalité. Plutôt qu’à la dérive insensible des genres et des
thèmes, typique de la temporalité orale, l’écriture conditionne une évolution
historique, où chaque innovation se détache nettement des formes précédentes.
Chacun peut constater le caractère intrinsèquement historique de la tradition savante
occidentale : à la simple écoute d’un morceau, il est possible de le dater
approximativement, même si l’on n’en connaît pas l’auteur.
Pour compléter cette évocation des effets de la notation, soulignons le lien entre
l’écriture statique et ces trois figures culturelles : l’universalité, l’histoire, l’auteur.
L’écriture avait noté la musique de tradition orale, pour l’entraîner dans un autre
cycle culturel. De même, l’enregistrement fixe les styles d’interprétation de la
musique écrite, en même temps qu’il règle leur évolution. En effet, ce n’est plus
seulement la structure abstraite d’un morceau qui peut être transmise et
décontextualisée, mais également son actualisation sonore. L’enregistrement prend
en charge à sa manière l’archivage et la mise en histoire de musiques qui étaient
restées dans l’orbite de la tradition orale (ethnographie musicale). Enfin, certains
genres musicaux, comme le jazz ou le rock n’existent aujourd’hui que par une
véritable « tradition d’enregistrement ».
Vers la fin des années soixante, le studio d’enregistrement multipiste devient le
grand intégrateur, l’instrument principal de la création musicale. À partir de cette
époque, pour un nombre croissant de morceaux, la référence originale devient le
disque enregistré en studio, que la performance en concert ne parvient pas toujours à
reproduire. Parmi les premiers exemples de cette situation paradoxale où l’original
devient l’enregistrement, citons certaines chansons de l’album Sergent Pepper, des
Beatles, dont la complexité requiert des techniques de mixage impossibles à mettre
en oeuvre en concert.
La musique techno
Comme en leur temps la notation et l’enregistrement, la numérisation instaure une
nouvelle pragmatique de la création et de l’écoute musicale. Je relevais plus haut que
le studio d’enregistrement était devenu le principal instrument, ou méta-instrument,
de la musique contemporaine. Or l’un des premiers effets de la numérisation est de
mettre le studio à portée de la bourse individuelle de n’importe quel musicien. Parmi
les principales fonctions du studio numérique piloté par un simple ordinateur
personnel, citons le séquenceur pour l’aide à la composition, l’échantillonneur pour
la numérisation du son, les logiciels de mixage et d’arrangement du son numérisé et
le synthétiseur qui produit du son à partir d’instructions ou de codes numériques.
Ajoutons que la norme MIDI (Musical instrument digital interface), permet à une
séquence d’instructions musicales produite dans un studio numérique quelconque de
se « jouer » sur n’importe quel synthétiseur de la planète.
Les musiciens peuvent dorénavant contrôler personnellement l’ensemble de la chaîne
de production de la musique et mettre éventuellement sur le Réseau les produits de
leur créativité sans passer par les intermédiaires qu’avaient introduits les régimes de
la notation et de l’enregistrement (éditeurs, interprètes, grands studios). En un sens,
on retourne ainsi à la simplicité et à l’appropriation personnelle de la production
musicale qui était le propre de la tradition orale.
Quoique la reprise d’autonomie du musicien soit un élément important de la nouvelle
écologie de la musique, c’est surtout dans la dynamique de création et d’écoute
collective que les effets de la numérisation sont les plus originaux.
Il est de plus en plus fréquent que des musiciens produisent leur musique à partir de
l’échantillonnage (sampling en anglais) et du réarrangement de sons, voire de
morceaux entiers, prélevés sur le stock des enregistrements disponibles. Ces
musiques faites à partir d’échantillonnages peuvent elles-même faire à leur tour
l’objet de nouveaux échantillonnages, de mixages et de transformations diverses de
la part d’autres musiciens, et ainsi de suite. Cette pratique est particulièrement
répandue parmi les divers courants de la musique techno. À titre d’exemple, le genre
Jungle ne pratique que l’échantillonnage, l’Acid jazz est produit à partir du sampling
de vieux morceaux de jazz enregistrés, etc.
La musique techno a inventé une nouvelle modalité de la tradition, c’est-à-dire une
façon originale de tisser le lien culturel. Ce n’est plus, comme dans la tradition orale
ou d’enregistrement, une répétition ou une inspiration à partir d’une écoute. Ce n’est
pas non plus, comme dans la tradition écrite, le rapport d’interprétation qui se tisse
entre la partition et son exécution, ni la relation de référence, de progression et
d’invention compétitive qui se noue entre compositeurs. Dans la techno, chaque
acteur du collectif de création prélève de la matière sonore sur un flux en circulation
dans un vaste réseau technosocial. Cette matière est mélangée, arrangée,
transformée, puis réinjectée sous forme de pièce « originale » au flot de musique
numérique en circulation. Ainsi, chaque musicien ou groupe de musiciens
fonctionne comme un opérateur sur un flux en transformation permanente dans un
réseau cyclique de coopérateurs. Jamais, comme dans ce type de tradition
numérique, les créateurs n’ont été en relation aussi intime les uns avec les autres
puisque le lien est tracé par la circulation du matériau musical et sonore lui-même, et
non seulement par l’écoute, l’imitation ou l’interprétation.
L’enregistrement a cessé de constituer le but ou la référence musicale ultime. Il n’est
plus que la trace éphémère (destinée à être échantillonnée, déformée, mélangée),
d’un acte particulier au sein d’un processus collectif. Je ne veux pas dire que
l’enregistrement n’a plus aucune importance, ni que les musiciens techno sont
totalement indifférents au fait que leurs productions fassent référence. Je veux
seulement souligner qu’il est plus important de « faire événement » dans le circuit
(par exemple au cours d’une rave party) que d’ajouter un item mémorable aux
archives de la musique.
La cyberculture est fractale. Chacun de ses sous-ensembles laisse apparaître une
forme semblable à celle de sa configuration globale. On peut retrouver dans la
musique techno les trois principes du mouvement social de la cyberculture dégagés
plus haut.
L’interconnexion est évidente par la standardisation technique (norme MIDI),
l’usage de l’Internet, mais aussi par le flux continu de matière sonore qui circule
entre les musiciens et la possibilité de numériser et de traiter n’importe quel morceau
(interconnexion virtuelle). Notons bien que cette circulation dans un réseau
d’échantillonnage récursif ou chaque opérateur nodal contribue à produire le tout est
valorisé pour lui-même ; c’est a priori une « bonne forme ».
La musique techno s’accorde avec le principe de communauté virtuelle puisque les
événements musicaux sont souvent produits au cours de rave parties et prennent
sens dans des communautés plus ou moins éphémères de musiciens ou de
disc-jockeys.
Enfin, quand un musicien offre une oeuvre finie à la communauté, il ajoute en même
temps au stock à partir duquel les autres vont travailler. Chacun est donc à la fois
producteur de matière première, transformateur, auteur, interprète et auditeur dans
un circuit instable et auto-organisé de création coopérative et d’appréciation
concurrente. Ce processus d’intelligence collective musicale s’étend constamment et
intègre progressivement l’ensemble du patrimoine musical enregistré.
La musique techno et, en général, la musique à matière première numérique,
illustrent la singulière figure de l’universel sans totalité. L’universalité résulte certes
de la compatibilité ou de l’interopérabilité technique et de la facilité de circulation des
sons dans le cyberespace. Mais l’universalité de la musique numérique prolonge
aussi la mondialisation musicale favorisée par l’industrie du disque et la radio à
modulation de fréquence. Toutes sortes de musiques ethniques, religieuses,
classiques ou autres sont échantillonnées, arrachées à leur situation d’origine,
mixées, transformées et finalement offertes à une écoute engagée dans un
apprentissage permanent. Le genre Transe global underground, par exemple,
participe intensément au processus en cours d’universalisation du contenu par
contact et mélange. Il intègre des musiques tribales ou liturgiques à des sons
électroniques, voire « industriels », sur des rythmes planants ou frénétiques qui
visent à provoquer des effets de transe. Contrairement à ce qui fut un moment la
vocation de la musique savante occidentale à base écrite, le nouvel universel musical
n’instaure pas le même système partout : il répand un universel par contact,
transversal, éclectique, constamment mutant. Un flux musical en transformation
constante invente progressivement l’espace qu’il étend. Ce flux est également
universel dans la mesure où, suivant l’avancée de la numérisation, il s’alimente
du « tout » ouvert de la musique, de la plus moderne à la plus archaïque.
Et cet universel se passe effectivement de totalisation puisqu’il ne repose sur aucun
système particulier d’écriture ou de combinatoire des sons. Les deux principaux
modes de clôture de la musique que sont la composition et l’enregistrement, n’ont
certes pas disparu, mais ils apparaissent nettement secondaires eu égard au
processus récursif et continu de l’échantillonnage et du réarrangement au sein d’un
flux continu de matière sonore.
Nous retrouvons avec la musique techno la formule dynamique qui définit
l’essence de la cyberculture : plus c’est universel, moins c’est totalisable.
Extraits de Cyberculture, rapport au Conseil de l’Europe de Pierre Lévy. Paris, Odile Jacob, 1998.