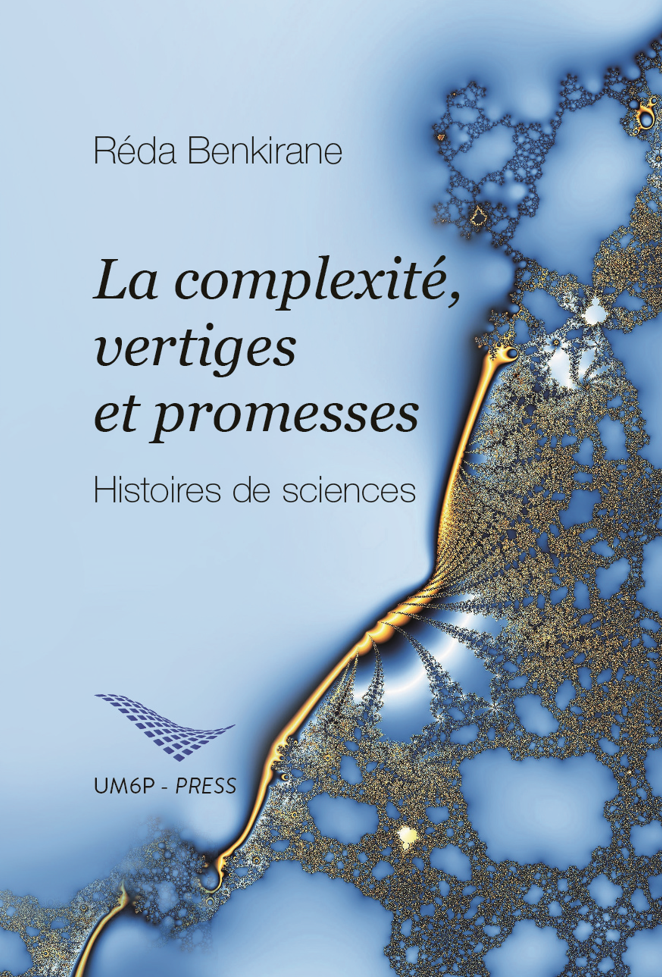La dernière frontière, les Tiers-Mondes et la tentation de l’Occident
Sophie Bessis (J-C. Lattès, Paris, 1983)
Panorama de la problèmatique développement-Tiers-Monde pour la décennie 80 où est affirmé ici « les limites d’un modèle ».
L’auteur est historienne de formation et a enseigné quelques années en Afrique. Elle a écrit l’arme alimentaire (Maspéro, 1979), puis est devenue journaliste économique.
extraits significatifs
p. 11 ; « Voilà donc le spectre de la pauvreté conjuré grâce à l’exemple de la Corée du Sud, du Brésil et de leurs épigones et, du même coup, le bon vieux capitalisme rénové par ce bain de jouvence.
A moins que ces pionniers officiels de la prospérité planétaire ne soient les derniers avatars d’un système au bout de sa course et que les autres, ceux qu’on appelle les plus démunis, ne s’essoufflent vainement à les poursuivre, alors qu’il n’y a plus de place sur terre pour leur propre enrichissement. »
p. 33 ; « (…) les exportations de l’Inde sont par exemple trois fois moins importantes que celle de Hong-Kong. Tous les pays ayant un produit national brut annuel par tête de moins de 1000 francs français, soit, Chine comprise, la moitié de l’humanité, ne réalisaient en 1977 que 8 % des exportations totales du tiers-monde. »
p. 35 ; « En ce qui concerne l’industrialisation proprement dite, le groupe des 77, ainsi nommé bien qu’il regroupe en fait l’ensemble des pays en développement membres de l’O.N.U., réclamait à New Delhi une aide des pays développés à l’industrialisation du tiers monde de 600 milliards de dollars en vingt ans, soit davantage pour ce seul secteur que la totalité des transferts publics et privés dont ont bénéficié les pays en développement de 1970 à 1980. »
p. 40 ; « En effet, outre l’encouragement aux investissements directs des firmes étrangères, ces pays ont fait, on le sait, massivement appel aux capitaux bancaires internationaux. Le problème de leur dette extérieure est une des questions les plus débattues depuis quelques années. La corrélation est étroite entre la liste des principaux producteurs-exportateurs de biens manufacturés du tiers monde et celle des gros emprunteurs internationaux. En 1981, treize pays en développement totalisaient 64 % de la dette totale du tiers monde, soit 300 milliards de dollars. A eux seuls, le Brésil, le Mexique, la Corée du Sud, l’Argentine et Taïwan comptaient pour le tiers du montant total de cette dette, soit plus de 150 milliards de dollars. Les autres très gros emprunteurs sont des pays semi-industrialisés -l’Inde est débitrice de 18 milliards de dollars, dont la moitié à l’égard des Etats-Unis et de la Banque Mondiale, l’Algérie de 18 milliards, l’Egypte d’une quinzaine de milliards- et les deux gros exportateurs pétroliers possédant un secteur industriel non négligeable -l’Indonésie a une dette de 17 milliards de dollars et le Vénézuela a vu la sienne passer de 13,2 milliards en 1980 à 18,5 milliards en 1982 pour la seule partie publique.
Ces chiffres, que l’on dit démesurés, semblent moins déraisonnables dès lors qu’on les compare à ceux des grands Etats occidentaux : la dette extérieure d’une petite nation comme les Pays-Bas s’élève par exemple à 50 milliards de dollars, celle de la France dépasse les 40 milliards. Quant aux Etats-Unis, le seul déficit de leur balance commerciale se montait à 70 milliards de dollars fin 1982. Mais il paraît que ces dettes-là ne mettent pas en danger l’équilibre financier mondial… »
p. 45 ; « Dans la luxueuse salle du palais des congrès à peine achevé pour la circonstance, Mac Namara fit donc frémir son auditoire en déclarant simplement : « Tout aussi préoccupant est le peu d’attention accordé par un grand nombre de ces pays au principe d’équité… Cette grave négligence n’a pas manqué d’entraîner de fortes distorsions dans la répartition des revenus. Ces distorsions peuvent, dans certains cas, tenir en partie à une phase de transition dans le processus de développement. Aucune théorie de la croissance ne saurait toutefois justifier des disparités aussi marquées que celles qui caractérisent la structure des revenus dans l’ensemble de ces pays. » Sachant que, pour l’ex-ministre de la Défense de Lyndon Johnson, le concept de sécurité internationale passe par la réduction des tensions sociales génératrices de trop graves conflits, on aurait pu s’attendre à ce qu’il élabore une autre « théorie de la croissance ». Presque sans transition, il poursuivait, toujours au sujet des pays « à revenu intermédiaire » : « Ces pays devront encore redoubler d’efforts pour mobiliser et utiliser efficacement leur épargne. »
p. 49 ; « Dans les pays nouvellement industrialisés, la question alimentaire est beaucoup plus complexe et de nature très différente selon qu’on se trouve en Corée ou au Brésil: C’est, paradoxalement, en Amérique Latine qu’elle atteint les dimensions les plus alarmantes, malgré d’immenses potentialités et un ratio terres/hommes parmi les plus élevés du monde. »
p. 60 ; « Ainsi, à la dictature du prolétariat qui devait à terme engendrer la dégénérescence de l’Etat – Staline lui-même quand il s’appelait encore Djougatchvili écrivait en 1906 : « là où les classes n’existent pas, où n’existent ni riches ni pauvres, l’Etat devient inutile, de même que le pouvoir politique qui opprime les pauvres et défend les riches. Par conséquent, la société socialiste n’aura pas besoin de maintenir le pouvoir politique. » On sait ce qu’il en advint…-, correspond aujourd’hui dans les pays capitalistes en voie d’industrialisation le même shéma au contenu idéologique différent mais à la finalité analogue : une dictature des classes dirigeantes est censée apporter le bien-être général par un développement dont elle s’emploie pourtant à saper les bases. »
p. 70 ; « L’Inde produit beaucoup : de l’acier, de l’aluminium, des biens d’équipement, des produits chimiques, des denrées de consommation courante, des fusées et des bombes atomiques. Sa communauté scientifique et technologique est la troisième du monde par le nombre après celles des deux super-Grands, et d’autres chercheurs du tiers-monde viennent y chercher des techniques et des procédés transposables chez eux.
(…) On oublie souvent à quel point cette destruction a été radicale : « Entre 1815 et 1832, la valeur des cotonades indiennes exportées tomba de 1,3 million de livres sterling à moins de 100 000 livres, soit une perte des 12/13 du commerce en seize années. Au cours de la même période, la valeur des cotonnades britanniques importées en Inde passa de 26 000 livres sterling à 400 000 livres , soit une multiplication par 16. »
p. 95 ; « Qui d’ailleurs, au Nord comme au Sud, pourrait nier la réalité de cette fracture ? Tout y renvoie, les statistiques aussi bien que la vie quotidienne, les grands agrégats de l’économie mondiale tout autant que les visions croisées des travailleurs immigrés peuplant les bas quartiers des métropoles occidentales et des assistants techniques « expatriés » enseignant aux plus démunis les bienfaits de la civilisation industrielle. En 1981, les termes de l’échange se détériorent de 14,5 % : les pays du tiers-monde achètent de moins en moins de biens industriels avec les recettes tirées de leurs produits de base. »
p. 149 ; « Encore ces ressources suivent-elles au plus près les fluctuations de la conjoncture internationale, empêchant les pays qui en disposent de mettre sur pied une planification à long terme en fonction de recettes régulières. De 1970 à 1980, six pays du tiers-monde, dont cinq en Afrique noire, ont connu une croissance négative de leur production intérieure brute. Treize pays ont vu leur P.I.B. augmenter de moins de 2,5 % par an, soit une croissance largement inférieure à celle de la population, ce qui implique une régression de la production par habitant. Dans sept pays, le P.I.B. a péniblement augmenté à un rythme de 2,5 % à 3 % par an. Vingt-six pays du tiers-monde, aux options politiques et économiques très diverses, situés surtout en Afrique mais également en Asie et en Amérique, ont donc vu leur situation se détériorer au cours de la décennie écoulée.
Si l’on prend la croissance du P.N.B. par tête comme critère du progrès économique, la situation générale est encore plus déplorable. De 1960 à 1980, il a connu une croissance négative dans dix pays, tous parmi les plus pauvres d’Asie et d’Afrique. Dans vingt-cinq Etats, sa croissance n’a pas dépassé 2 % par an, ce qui équivaut à une stagnation. Dans près de la moitié des pays du tiers-monde, les habitants n’ont donc connu aucun progrès de leurs conditions de vie au cours des vingt dernières années. Si l’on réfère à la seule production alimentaire, cette détérioration est encore plus accentuée : l’indice de la production par habitant en 1978-1980 est inférieur à celui de la période 1969-1971 dans cinquante-deux pays, qui sont donc tributaires de l’augmentation de leurs recettes en devises ou de la charité internationale, dont on sait ce qu’elle vaut, pour nourrir leur population. Le faisceau de données indiquant qu’une bonne partie des pays « en dévelopement » s’enfonce dans la stagnation pourrait encore être étendu. Dans certaines régions du monde, la réalité dépasse les projections les plus pessimistes. »
p. 152 ; « (…) le président Fidel Castro évoquait récemment pour justifier la demande de moratoire de la dette de son pays auprès de ses créanciers. Celle-ci, qui s’élève en 1982 à 3,5 milliards de dollars, a été contractée en majorité auprès des institutions financières canadiennes, japonaises et espagnoles. »
p. 158 ; « Autre modèle en crise, celui de l’Algérie, qui résume de façon presque exemplaire les contradictions de certains pays du tiers-monde que d’aucuns s’obstinent à qualifier de « non capitalistes ». Cette notion a souvent été utilisée à la place de l’appellation « socialiste » et révèle à elle seule le flou conceptuel qui caractérise les expériences dites de troisième voie. »
p. 159 ; « Malgré l’ampleur des bouleversements qui affectent depuis vingt ans la société algérienne, sa classe dirigeante a fonctionné, au moins jusqu’à la mort de Boumedienne en 1979, sur un sens aigu de la mystification idéologique : la « spécificité » de l’expérience socialiste algérienne autorisait toutes les perversions. Mais une grande partie de l’élite intellectuelle a également vécu d’automystification, satisfaite qu’elle était de l’option résolumment « anti-impérialiste » du régime et renforcée périodiquement dans sa foi par des campagnes de mobilisation dont certaines, comme le début de la Révolution agraire, entraînèrent une véritable adhésion populaire ou d’autres, comme les discussions autour de la Charte nationale, permettaient de satisfaire partiellement ses aspirations à la démocratie. »
p. 161 ; « * source : Dersa : L’Algérie en débat, luttes et développement Cedetim. Ed. Maspéro, Paris, 1981. »
p. 162 ; « La récolte céréalière s’est élevée en 1981 à 19 millions de quintaux, soit la même quantité qu’en 1910 ! L’Algérie a acheté cete année-là à l’étranger 25 millions de quintaux de céréales, la moitié de sa consommation de lait, la plus grande partie du sucre dont elle a besoin (la production nationale ne dépasse pas 25 000 tonnes), tandis que les importations de viande étaient multipliées par 20 par rapport à 1970. »
p. 163 ; « Mis à part une faible production d’engrais (112 000 tonnes en 1978) et le complexe moteurs-tracteurs de la Sonacome à Constantine qui fonctionne à 25 % de sa capacité installée, l’industrie ne s’est assignée à aucun niveau le but de répondre à la demande de facteurs de production agricole. »
p. 164 ; « La dépendance de l’Algérie vis-à-vis de l’Occident capitaliste est plus forte que jamais, et ses responsables se sont toujours attachés à donner d’eux hors du pays l’image de bons gestionnaires d’un capitalisme national pour faire apel à l’assistance multiforme de l’Occident. Dès 1966, le F.M.I. soulignait les bonnes dispositions de l’équipe dirigeante algérienne. Il écrit alors à propos de l’Algérie : « Tandis que la politique officielle du gouvernement est de poursuivre les buts de l’économie socialiste et de voir l’Etat avoir la haute main sur toutes les nouvelles industries importantes, on engage maintenant les meilleures sociétés d’études étrangères pour avoir leur avis sur les méthodes de gestion des entreprises publiques, et on recherche activement un modus vivendi avec le capital privé international pour l’attirer vers l’Algérie. » Les hydrocarbures constituent actuellement 97 % des exportations algériennes qui se dirigent dans une proportion de 94 % vers les pays capitalistes industriels. Premier client de l’Algérie, les Etats-Unis absorbent la moitié de ses ventes à l’étranger. La dette publique extérieure dépasse 15 milliards de dollards et représente environ la moitié du produit national brut. Gros emprunteur auprès des marchés financiers internationaux, l’Algérie fait aussi largement appel aux institutions internationales comme la Banque Mondiale à qui elle a emprunté plus de 900 millions de dollars entre 1975 et 1981.
L’intégration de l’Algérie au marché capitaliste mondial est donc beaucoup plus étroite que ne le laisseraient supposer les réaffirmations régulières du caractère inéluctable des options socialistes. Loin de conduire à l’indépendance, les choix effectués au milieu des années 60 ont confirmé et accentué l’insertion dépendante dans l’économie mondiale, sans pour autant que cette dépendance résolve les problèmes intérieurs auxquels le pays est confronté. A ce niveau, et quels que soient les aspects positifs dont on puisse par ailleurs créditer l’expérience algérienne, l’échec économique est patent. »
p. 166 ; « On peut expliquer la faiblesse des revenus du secteur moderne en regard des investissements énormes dont il a bénéficié par trois raisons qui, sans être exhaustives, permettent de comprendre l’échec de la « bataille de la production » : Les complexes industriels, installés à grand renfort de « paquets technologiques » conçus pour un environnement totalement différent, ont été incapables de s’insérer dans un contexte socio-économique peu préparé à les assimiler ; mais ils sont également constitué les lieux privilégiés du prélèvement du surplus nécessaire à la bureaucratie pour assurer son assise sociale et sa reproduction ; le détournement de l’appareil productif en vue de cette finalité est une cause non négligeable de son fonctionnement désastreux. Car, pour assurer un tel prélèvement et se réserver la mainmise absolue sur l’appareil, il est nécessaire de multiplier les contrôles administratifs et de porter à son paroxysme la centralisation, malgré leurs conséquences nuisibles pour la productivité du travail.
D’un autre côté, cette classe dirigeante, partenaire du capital transnational, débitrice du système bancaire international, en proie aux exigences d’une population dont l’insatisfaction, de moins en moins canalisée par le discours populiste , pourrait provoquer de graves remous, est bien obligée de tenir compte de la rationalité capitaliste. Le plan 1980-1984 a fait succéder la « bataille de la gestion » à celle de la production. Il s’agit désormais, avant d’entreprendre de nouveaux investissements dans le secteur industriel, de faire fonctionner les entreprises existantes , c’est-à-dire, en réalité, de les faire passer de la sphère bureaucratique à la sphère capitaliste. Mais il n’est toujours pas question d’inverser l’ordre des priorités et de réduire la place prépondérante de l’industrie lourde par rapport aux autres secteurs de l’économie. Ce retour à une gestion plus classique de l’appareil productif constitue une preuve a contrario de la pérennité du modèle capitaliste, puisqu’il apparaît une fois de plus en plus impossible de faire siens ses critères de croissance sans en adopter par la même occasion les modalités.
c’est peut-être la mutation à laquelle se préparent les responsables algériens en rétrocédant progressivement au privé certains secteurs où la faillite a été la plus spectaculaire, comme la gestion des circuits commerciaux, et en comptant davantage sur lui pour répondre à la demande populaire de biens de consommation finale que l’Etat est incapable de satisfaire. »
* « Dans son ouvrage sur l’économie de l’Algérie, T. Benhouria, à qui nous empruntons beaucoup, développe le thème de la « soviétisation » de la bureaucratie algérienne et rappelle que, comme en U.R.S.S., la seule rationalité bureaucratique réside dans la nécessité de sa reproduction. Le primat du politique sur l’économique explique selon lui le caractère sous-développé de l’industrie algérienne : les dirigeants des entreprises d’Etat, « tenant leurs pouvoirs de leur position dans la hiérarchie politique, gaspillent les ressources qui sont attribuées à leurs établissements, en détournent une partie à des fins privées, les sanctions économiques du marché ayant peu de prise sur cette catégorie sociale dont la fonction économique est étroitement dépendante de la puissance politique de ses membres et se trouve par conséquent secondaire » (op.cit., p. 433) »
p. 168 ; « On aurait l’air de vouloir cultiver le paradoxe si on affirmait qu’il y a, en définitive, moins de différences qu’on ne le pense entre l’Algérie et… la Corée, le Brésil et la… Tanzanie. A première vue, tout au moins, rien ne les rapproche.
(…) Tous pourtant, comme les autres pays du tiers-monde, poursuivent un même but primordial : la croissance économique, avec pour corollaire un renforcement de l’intégration au marché mondial. Quelle que soit la nature des régimes politiques, tous, y compris les pays socialistes, estiment nécessaire, à un moment ou à un autre de leur évolution, de faire appel au capital et à la technologie transnationaux.
(…) Dans cinquante-trois des soixante pays en développement pour lesquels la Banque Mondiale fournit des statistiques complètes, la part de l’agriculture dans le produit intérieur brut a décliné entre 1960 et 1980. Elle n’a augmenté qu’au Tchad, en Birmanie, en Ouganda, au Sénégal,en Zambie et au Zaïre. »
p. 169 ; « Dans les pays où elle repose essentiellement sur les ressources minières dont l’exploitation explique la rapidité de leur croissance, on constate que les revenus dégagés de la rente minière n’ont pas été investis dans le secteur agricole qui stagne ou régresse : au Niger, l’industrie (c’est-à-dire l’extraction de l’uranium) a enregistré une croissance de 12,6 % par an, tandis que la croissance de l’agriculture n’atteignait même pas 0,5 %. Celle-ci demeure stationnaire au Nigéria (0,2 % par an), alors que l’industrie, c’est-à-dire essentiellement l’exploitation des hydrocarbures, s’accroissait de 10 % par an. Même constatation pour l’Algérie où les taux de croissance respectifs de l’agriculture et de l’industrie sont de 1,6 % et 9,7 % par an. »
p. 170 ; « La gestion capitaliste, étatique ou non, de la société ne va nulle part de pair avec une réduction durable des inégalités »
p. 171 ; « Quand l’Inde construit un aéoroport en Arabie Séoudite, ou que le Brésil fournit des avions militaires au Gabon, il faut se demander à quoi vont servir les achats effectués par Ryad ou Libreville avant de conclure que leur provenance est le signe d’une autonomisation du Sud par rapport au Nord. Celui-ci, on l’a vu, est de moins en moins un espace géographiquement circonscrit, pour devenir davantage une entité abstraite désignant les principaux centres de décision du monde capitaliste.
(…) Cette force relative, les P.O.M. la doivent aux conditions optimales de rentabilité dans lesquelles s’est déroulé le processus de leur industrialisation. Ils n’ont pu parvenir à un tel résultat que parce qu’ils possèdent leur propre périphérie, taillable et corvéable à merci, et que les ressources économiques et humaines de celle-ci ne sont pas encore épuisées. »
p. 175 ; « L’immense Zaïre, avec ses 2,3 millions de kilomètres carrés, avec son cuivre, son cobalt, son manganèse, ses diamants, avec un sous-sol souvent qualifié de « scandale géologique » tant il fait penser à la caverne d’Ali Baba, avec ses potentialités agricoles à faire rêver, n’empêche pas grand monde de dormir à Paris, Londres ou New York.
(…) Quelques parachutistes restaurent promptement le contrôle de l’Occident sur une zone stratégique à cause de ses richesses qui ne doivent tomber ni dans la zone d’influence soviétique, ni aux mains d’une équipe nationaliste qui pourrait vouloir renégocier dans un sens moins défavorable au pays leur exploitation. »
p. 178-179 ; « Les décideurs économiques des centres capitalistes sont sans aucun doute attirés par des pays dotés de multiples avntages facilitant leur entreprise de redéploiement. L’étroite corrélation existant entre l’importance des prêts des banques occidentales, des investissements directs des transnationales et la rapidité des taux de croissance dans les P.O.M. prouve amplement que l’appareil bancaire et financier du monde industriel ne lance pas ses opérations fortuitement. Pour n’en donner qu’un exemple, la First National City Bank des Etats-Unis accordait, en 1974, 45 % de ses profits de ses opérations à l’étranger, dont moins de 20 % en Europe. Avec seulement 7 % de ses actifs engagés dans le tiers-monde, elle y réalisait près de 40 % de l’ensemble de ses profits, répartis ainsi : plus de 10 % en Asie, 10 % dans les Caraïbes, 9 % en Amérique du Sud, et le reste en Afrique et au Moyen-Orient. Depuis, les créances des banques privées occidentales sur les pays du tiers-monde à revenu intermédiaire n’ont cessé d’augmenter. »
p. 197 ; « Ce sont encore des Brésiliens qui ont réalisé la route de Nouakchott-Kiffa en Mauritanie, pour un montant de 220 millions de dollars, et qui entreprennent au Mozambique une importante étude de factibilité pour l’exploitation des mines de charbon, dont Brasilia se porterait ultérieurement acquéreur. En Algérie, un consortium de firmes brésiliennes participera à la réalisation de l’ambitieux programme de construction, en réalisant une tranche de 100 000 logements en cinq ans dans la région de Ouargla. Pour remporter le contrat, le Brésil a ouvert à Alger une ligne de crédit de 300 millions de dollars. »
p. 201 ; * « P. Judet, Les nouveaux pays industriels, op. cit. »
p. 202 ; « Il ne faut rien exagérer, et la puissance commerciale des « nouveaux riches » du tiers-monde demeure bien modeste par rapport à celle des géants de l’industrie mondiale. La capacité exportatrice des premiers dans les secteurs lourds augmente assez lentement : s’ils satisfaisaient, en 1973, 10,4 % de la demande de l’ensemble du tiers-monde en produits industriels, cette part passe à 13, 3 % seulement en 1980. »
p. 203 ; « En chiffres, le pouvoir de ces firmes (multinationales) est proprement exorbitant. Outre le fait que le chiffre d’affaires des plus grosses d’entre elles excède largement le produit national d’une bonne moitié des Etats représentés à l’O.N.U., leur rôle est immense dans la production et les échanges internationaux. Ainsi, les ventes des trois cents plus grandes multinationales américaines, japonaises et européennes augmentent d’environ 10 % par an, soit en moyenne deux fois plus vite que le P.N.B. des pays où elles sont implantées. La production des filiales des transnationales américaines installées à l’étranger est quatre fois plus importante que les exportations totales des Etats-Unis. En 1975, le chiffre d’affaires des firmes des pays industriels implantées dans le tiers-monde atteignait le double de toutes les exportations du Nord vers ce même tiers-monde. »
p. 205 ; « Selon la C.N.U.C.E.D., l’ensemble des échanges intragroupe et du commerce captif à l’intérieur des multinationales représente plus de la moitié du commerce des produits manufacturés des pays en développement. »
p. 206 ; « Pendant qu’on glose interminablement aux Nations unies de l’élaboration d’un code de conduite pour le comportement des multinationales qui n’aura, en tout état de cause, aucune force contraignante, on n’a jamais discuté au sein des multiples instances du tiers-monde, non alignés ou groupe des 77, sans parler des organisations régionales, d’une éventuelle harmonisation des codes des investissements, qui enlèverait aux sociétés multinationales un important moyen de chantage qu’elles ne se privent pas d’utiliser. Quant aux syndicats, là où ils existent, c’est-à-dire surtout dans les pays occidentaux, leurs efforts pour élaborer une stratégie internationale capable de répondre à la multinationalisation du capital n’en sont qu’à leurs premiers balbutiements. »
récession des P.O.M..
p. 210 ; « Celle-ci s’est déjà ralentie, et l’on assiste, depuis le début de cette décennie, à un essouflement certain de ces économies pourtant « miraculées ». Le triomphalisme fait place partout à l’inquiétude ou, du moins, à une vision moins idyllique de l’avenir. Le réveil est à la fois brutal pour des économies qui s’étaient trop vite habituées à un rythme de croissance sans précédent. Même s’il reste supérieur à celui des pays industriels et de la plupart des autres Etats du tiers-monde, certains ressorts de l’expansion paraissent brisés. En Asie, la Corée a connu en 1980 une croissance négative de moins 6,5 %, doublée d’une inflation de l’ordre de 50 %, annulant l’effet d’augmentations salariales qui n’ont pas dépassé 25 %, et d’une augmentation du chômage sans précédent : à la fin de 1981, 6 % de la population active, soit près de 900 000 personnes, étaient sans emploi.
* P. Tissier : L’industrialisation dans le sous-développement . »
p. 211 , « Au prix d’une répression accrue, Taïwan a retrouvé en 1981 une croissance de 7,5 %, exceptionnelle en ces temps de crise. Il lui a fallu pour ce faire opérer une douloureuse reconversion dans certaines branches industrielles pour diminuer l’importance des exportations par rapport au produit national brut.
La situation des grands pays d’Amérique est beaucoup moins enviable, et tous connaissent depuis peu un ralentissement général de l’économie après le cycle des années fastes. »
p. 213 ; « D’aucuns veulent voir dans les difficultés actuelles une simple phase de réajustements économiques, rendus nécessaires par la trop grande rapidité des mutations des vingt dernières années, et par l’évolution du contexte mondial. L’Argentine ne serait alors qu’un cas malheureux, mais isolé, de régression, et non un exemple prémonitoire. Ce retour du pendule suscite en tout cas des interrogations, car après l’euphorie on se demande un peu partout qui des pays du tiers-monde en voie d’industrialisation surmontera la crise, en valorisant quels atouts, et dans quelles conditions. »
p. 218-219 ; « Même s’ils ont fait entrer le mythe de la croissance dans l’ordre du possible, les P.O.M. sont devenus du même coup un miroir aux alouettes. En effet, si la croissance économique dans le cadre d’une intégration poussée au système central cesse grâce à eux d’être perçue comme une chimère, elle devient impossible pour la majeure partie du tiers-monde à cause de leur existence même. Car le modèle, réalisé comme il l’est au Nord, ou en voie de réalisation dans quelques lieux privilégiés du Sud, est dévoreur d’espaces et d’humanité. Tout le monde souhaite, en toute logique, être du côté où l’on dévore. Mais dans cet ordre implacable qui régit notre planète finie, il faut bien qu’il demeure, dans quelques lieux, des espaces et des êtres à consommer.
A quelques cinq siècles d’intervalle, les caravelles de Cristophe Colomb (dont on enseigne aux descendants des Incas et des Aztèques qu’il a découvert l’Amérique!) et le vaisseau spatial Apollo avaient un but identique. Pour les aventuriers du XVème siècle comme pour les astronautes d’aujourd’hui, les rêves de conquête et la soif d’appropriation accompagnaient toujours, et primaient souvent, le désir de savoir. Derrière ces deux odyssées se profile le même besoin vital de l’Occident, de son économie, de sa culture, d’aller toujours plus avant, de pousser toujours plus loin ses limites, pour alimenter son fonctionnement, c’est-à-dire pour survivre. La Compagnie des Indes s’est engouffrée dans le sillage de Vasco de Gama, et les plantations de caoutchouc souillées de sang du roi Léopold dans celui du docteur Livingstone.
(…) Une fois épuisées les ressources les plus proches, ou les populations intégrées au cercle d’une relative prospérité qui détermine l’appartenance au Centre, il faut aller ailleurs pratiquer cette « extorsion de plus-value » qui n’est plus possible dans le voisinage immédiat des régions centrales du système.
(…) Alors qu’on avait oublié pendant longtemps leur existence, on aperçoit maintenant, de plus en plus près, les limites territoriales de l’expansion. »
p. 221 ; « Dans l’histoire moderne, il est notoire que la conquête, la mise en esclavage, le vol, l’assassinat, en résumé la force, jouent le rôle principal…Et en effet, la force est l’accoucheuse de toute vieille société au travail. La force est un agent économique…Ce fut la traite des nègres qui jeta les fondements de la grandeur de liverpool…En somme, il fallait pour piédestal à l’esclavage dissimulé des salariés en Europe, l’esclavage sans phrase dans le Nouveau Monde. Le capital vient au monde suant le sang et la boue… Karl Marx, Le Capital
Dans aucune des figures qu’il a prises à travers le monde, le modèle n’a pu se libérer de cette matrice sans éliminer du même coup toute possibilité de produire du capital. »
p.222 ; « Le mouvement des enclosures en Angleterre y tient plus de place que la traite négrière.
(…) * Le problème n’est plus tant que les gens sont trop pauvres, mais qu’il y a trop de pauvres. Avec l’impérialisme, la production de la pauvreté prend le pas sur la paupérisation stricto sensu. »
p. 223 ; « Les continents du Sud firent office d’immenses réservoirs dont les chemins de fer , construits avec un incroyable gaspillage humain, dessinent à la fois les voies de pénétration et les lignes de crêtes de cette redoutable et durable saignée. Grâce à cet éventrement, l’Occident put également s’assurer de solides arrières pour écouler la masse de marchandises produites dans le cadre du nouveau processus de production. »
p. 225 ; « Marginalisée à l’extrême puisque, dans sa grande majorité, elle ne jouit d’aucun droit civique, cette énorme réserve de main-d’oeuvre occupant les postes les moins payés, a permis à la frange supérieure des classes ouvrières européennes de poursuivre son ascension sociale et de se fondre progressivement, tout au moins au niveau des comportements et des modes de vie, dans la galaxie petite-bourgeoise. »
p. 231 ; « Très vite, en effet celles-ci (les classes dirigeantes), par l’intermédiaire de leurs porte-parole internationaux, se sont élevées contre ce qu’elles ont considéré comme une stratégie de développement au rabais : à l’Occident la maîtrise technologique et la mise en oeuvre de modes de croissance sophistiqués ; au tiers-monde l’habitat en terre battue, l’agriculture à la houe et l’alphabétisation en langues locales dans des huttes, ce qui interdit bien évidemment tout accès aux sanctuaires scientifiques et technologiques qui dessinent les contours du monde futur. »
p. 232 ; « La mission confiée en 1977 par Mac Namara à une équipe formée par Willy Brandt et le rapport qui en sortit en 1979, marquent l’apogée du mouvement. Nord-Sud : un programme de survie, le titre en lui-même est un cri d’alarme, et l’introduction reprend le thème de la misère, devenu un poncif de toute étude sur l’aide au développement. »
p. 234 ; « Tout a changé depuis que la pauvreté « là-bas » est devenue la pauvreté partout, c’est-à-dire « ici ». Facteur de destabilisation, elle doit être traitée comme tel, et ce n’est pas un hasard si l’on emploie dans ce domaine un langage stratégico-militaire : La pauvreté mondiale est devenue une affaire de containment. »
p. 235 ; « Les déclarations de son nouveau président illlustrent de façon éclatante ce revirement : « La Banque Mondiale n’est pas chargée de redistribuer la richesse entre les groupes de pays. Elle n’est ni le Robin des Bois de la scène financière internationale, ni la dame patronesse des pays en développement. La Banque Mondiale a la tête froide et ne fait pas de sentiment. Elle a de la tâche qu’elle s’efforce d’accomplir une vue pragmatique et apolitique….La Banque Mondiale a pour mandat de contribuer au progrès économique des pays membres en développement. Elle ne peut le faire qu’avec l’appui des gouvernements et des marchés privés des pays membres exportateurs de capitaux. » »
p. 239 ; « Si l’humanité était dès aujourd’hui techniquement capable d’aller extorquer de la plus-value aux Martiens ou aux Vénusiens (à supposer qu’il y en ait), la crise qu’elle traverse serait déjà aux trois quart résolue. On y trouvereait le sol pour en extraire les richesses, et on embaucherait, pour peu que leur anatomie s’y prête, les habitants de ces nouvelles colonies pour en faire les soutiers du progrès économique continu sur la planète Terre. »
p. 240 ; « La population mondiale n’a jamais, nous dit-on, augmenté aussi vite, et toutes les statistiques montrent que cet accroissement s’accèlera pendant encore à peu près un siècle. L’intervalle de doublement de la population ne cesse de se réduire. En ne considérant que le XXème siècle, il était de 150 ans en 1900, de 70 ans en 1970, et il sera de 35 ans en l’an 2000. »
p. 247 ; « si l’Indonésie compte 75 habitants au kilomètre carré, Java est dramatiquement surpeuplé alors que plusieurs îles de l’archipel sont pratiquement vides d’habitants ; mais la politique de la colonisation de ces territoires entreprise depuis une vingtaine d’années par les pouvoirs publics s’est soldée par un échec, pour des raisons essentiellement politiques. Quant au Proche-Orient où la superficie cultivée atteint 0,39 ha/habitant, il n’aura plus que 37 millions d’hectares de réserves dans six-huit ans. Il faut en effet y tempérer la faiblesse relative des densités moyennes par l’étendue des superficies désertiques qui couvrent en son sein de vastes régions. »
p. 248 ; « Mais la gestion étatique des mouvements migratoires, l’excessive bureaucratisation à laquelle ils sont soumis, la dépendance quasi totale dans laquelle se trouvent les immigrants vis-à-vis de l’Etat -qui reste propriétaire éminent de la terre, impose des contrats de culture, contrôle la distribution des intrants et la commercialisation de la production, décourage les initiatives paysannes dans lesquelles il voit des menaces pour son autorité- ont conduit la plupart de ces entreprises à des échecs cuisants. »
p. 250 ; « Que les limites de l’oekoumène soient ou non irrévocablement atteintes, il est en tous cas à peu près évident que ce mouvement ne peut guère se poursuivre au rythme des vingt dernières années sans prendre des proportions qu’il engendrerait justement cette « destabilisation » des Etats concernés, considérée par les tenants du concept de la sécurité « élargie » comme une des plus graves menaces pesant sur la planète.
(…) La bidonvillisation du Tiers-monde n’est pas le seul symptôme de cette lente asphyxie du système mondial que, vu sa durée, on n’ose plus tout à fait appeler crise. La fulgurante avancée de l’autoritarisme d’Etat érigé en méthode de gouvernement en constitue l’un des signes les plus visibles, réduisant de par le monde les espaces de liberté comme une peau de chagrin. »
p. 252 ; « on ne peut, disent-ils en substance, récuser des chiffres qui attestent de la rapidité de la croissance, donc du progrès. Ce glissement sémantique rejette toute opposition dans le champ d’une subversion aux buts inavouables, puisqu’elle s’apposerait par principe aux efforts de transformation économique et sociale entrepris par les régimes technocratico-militaires.
(…) elle peut à la rigueur en affecter les aspects contingents et se situer sur le plan de la critique technocratique, seule acceptée puisqu’elle s’inscrit dans le cadre idéologique défini au sommet. Alors que, dans d’autres secteurs, les P.O.M. tentent de reproduire au plus près le modèle capitaliste historique, ils s’éloignent considérablement de cette matrice dans le domaine politique stricto sensu. Cette démarcation va plus loin qu’une simple adaptation du modèle aux réalités contemporaines : elle le dépouille d’un de ses principaux fondements idéologiques. »
p. 253 ; « C’est que, pendant sa période de grande expansion, à mesure que sa mondialisation progressive en décuplait la force, et que les limites mises à sa progression n’étaient pas encore palpables, le système capitaliste a pu se permettre d’autoriser en son sein le développement d’un pluralisme politique pouvant aller jusqu’à une contestation radicale de ses fondements, à condition que celui-ci cantonne ses manifestations dans le champ « légal ». Le libéralisme politique s’est révélé d’autant qu’il a constitué une arme idéologique de choix contre le « camp socialiste », à mesure que s’approfondissait la déviation totalitaire de l’Union Soviétique. »
p. 272 ; « Dans ce contexte, et malgré les actions ponctuelles entreprises ça et là, on comprend que le principe d’un développement endogène centré sur la recherche de l’autonomie alimentaire et de l’amélioration du niveau de vie général, sans aggraver les déséquilibres déjà préoccupants, soit relégué à l’arrière-plan. A moins que ces régions marginalisées de la planète ne deviennent, sous l’empire de la nécessité, les laboratoires d’expériences aux antipodes des stratégies élaborées par les grands prêtres de la croissance. Certains pays d’Afrique noire en particulier, dont l’intégration à l’économie mondiale est une perspective si lointaine qu’elle apparaît difficilement réalisable, sont en train de voir naître, volens nolens, des tentatives originales de développement autonome. La déliquescence de leurs appareils d’Etat, l’urgence avec laquelle ils doivent pourvoir à une série de besoins qui, dans le contexte actuel, ne peuvent être satisfaits dans le cadre de la reproduction mimétique du modèle, la nécessité de faire face à des échéances vitales obligent certaines élites à ne pas s’opposer à un « développement paysan » qui refleurit ça et là et même parfois à l’encourager concrètement. C’est également de cette façon qu’on peut interpréter certains discours qui ne reprennent plus le langage classique sur le développement par l’industrie. Aussi assiste-t-on en maints endroits du sous-continent à des débuts de synthèse, sans aucune intervention étrangère, entre une tradition encore vivace et certains apports, dûment sélectionnés, des techniques occidentales. Nul n’y a délibérement choisi les voies d’un autre développement, en fait d’un dévelopement tout court, mais celui-ci semble s’imposer de lui-même dans ces régions à l’abandon, où il est la seule alternative possible à la régression économique, sociale et culturelle. Ces quelques zones de la planète où la logique du capital n’a pas encore tout envahi seront-elles les seules à pouvoir se sauver au moindre coût d’un effondrement général qui, quelque forme qu’il prenne, paraît inéluctable ? Leur « retard » actuel constitue-t-il, dans une perspective à long terme, une supériorité par rapport à des nations devenues des rouages essentiels du système, mais où le miracle risque de se transformer en cauchemar ? »
p. 278 ; « En réalité, comme le montre l’expérience dynamique de l’A.S.E.A.N. et celle, avortée, du Pacte Andin, l’objectif essentiel de ces unions régionales n’est pas de promouvoir en priorité un développement complémentaire et équilibré de toutes leurs composantes, qui pourrait hâter la marche vers une relative autonomie vis-à-vis du Nord ; il réside plutôt dans la volonté d’offrir un marché plus vaste et des possibilités plus grandes aux éventuels investisseurs étrangers tout en accroissant, grâce à une stratégie économique plus cohérente et à des assises plus solides, leurs capacités de négociation vis-à-vis du Nord, ce qui leur permet de subir progressivement des conditions moins léonines dans leurs échanges avec celui-ci. »
p. 279 ; « (…) le « tiers-monde » est moins aujourd’hui une zone géographiquement homogène qu’uin ensemble spatialement éclaté.
(…) plus qu’à un espace, le tiers-monde s’apparente aujourd’hui à une trilogie dont les trois éléments sont ces damnés de la terre si souvent rencontrés au long des pages qui précedent : les pays les moins avancés, les paysanneries, les bidonvilles. C’est prise dans son ensemble que cette « périphérie » montre les limites du système et l’incapacité dont il fait actuellement preuve à résoudre les contradictions qui l’affectent le plus dangereusement.
Il lui faut cependant trouver des solutions qui puissent assurer la pérennité de son fonctionnement ou, à tout le moins, une série d’expédients lui permettant de reculer les échéances. »
p. 284 ; « La nécessité unanimement reconnue d’opérer des transferts financiers, si minimes soient-ils, du Nord vers le Sud, l’inquiétude manifestée en hauts lieux sur le danger que fait courir à l’équilibre mondial leur diminution, la multiplication des conférences où l’on discute à l’infini de la meilleure manière de résorber les innombrables poches de misère et de sous-développement montrent en tout cas que personne ne nie l’existence de ces tiers-mondes irréductibles. Ces paysanneries aux abois, ces métropoles tropicales transformées en gigantesques cours des miracles, ces pays qui ne survivent que par le bon vouloir des impératifs géopolitiques sont autant d’affronts à un système dont les tenants proclament urbi et orbi la supériorité sur tous les plans. Mais, en reconnaissant de façon éclatante leur existence, et en avouant de plus en plus explicitement leur impuissance s’il s’agit de les éliminer, le monde industriel n’admet-il pas tacitement l’épuisement du modèle dont il est porteur ? Il faut, devant ces interrogations, se garder des affirmations péremptoires. Le capitalisme a, au cours de sa tumultueuse histoire, déjà surmonté tant de crises, il s’est relevé de tant de débâcles, et tant d’hommes et de femmes, prenant leurs espoirs pour une analyse objective de la réalité, l’ont donné pour moribond qu’il convient d’être prudent.
Il n’empêche que, devenu mondial, le système est désormais confronté à des équations nouvelles. Tandis que les incertitudes se multiplient sur ses marges, l’approfondissement de la crise chez lui, s’accompagnant d’une remise en question de plus en plus radicale des modalités classiques de la croissance, est une autre preuve, qu’il ne peut guère occulter plus longtemps, de ses limites. Conscient d’être arrivé au bout de la course,, il recherche désespérement de nouveaux espaces à conquérir et à exploiter. L’intérêt croissant accordé aux ressources maritimes depuis une quinzaine d’années et les âpres polémiques qui ont fait rage à ce sujet dans le cadre de la conférence internationale sur le droit de la mer sont, avec l’exploration de l’espace, les illustrations les plus récentes de cette quête. En poursuivant celle-ci envers et contre tout, il reconnaît ainsi son incapacité à gérer plus économiquement les ressources planétaires disponibles et la nécessité vitale qui le pousse à explorer sans fin de nouveaux mondes.
Ceux-ci, on l’a vu, ne sont pas légion, et la lenteur des découvertes trouve son corollaire dans l’affolante rapidité avec laquelle s’exaspèrent les contradictions sur la planète. Le caractère irréductible de la pauvreté n’est pas la moindre d’entre elles. A la fois nécessaire et dangereuse, elle ne peut plus aujourd’hui être évacuée nulle part. Stoppé dans son expansion, en quoi résida l’origine de sa toute puissance, c’est de ce tiers-monde là que le système a peur. Au-delà des réussites dites spectaculaires, il manifeste en effet par son incontournable présence que le modèle inlassablement proposé par l’Occident à ses terres de mission ne saurait être partout et, en toute circonstance, dans des proportions au moins égales à la rapidité de la croissance, ces dramatiques scories. Le point de rupture n’est pas encore atteint. Mais il n’est pas sûr que, dans le marasme actuel, les stratèges de la croissance s’avèrent capables de résoudre un tel paradoxe. C’est dans sa solution pourtant que réside la survie du monde dans la forme que nous lui connaissons. »
p. 288 ; « Les continents du tiers-monde, pour peu qu’on les embrasse d’un seul regard, font songer à ces champs d’héliotropes irresistiblement attirés par la lumière du soleil. Non qu’il faille comparer le Nord, sous ses différents avatars, à l’astre solaire. Mais il exerce comme lui un invincible tropisme jusqu’aux marches les plus lointaines de notre planète.
(…) L’heure des miracles semble pourtant terminée. L’émergence contemporaine des P.O.M. est-elle le dernier avatar de cette marche forcée du capitalisme ? Peut-il encore édifier d’autres empires, ou a-t-il atteint l’ultime frontière au-delà de laquelle nulle expansion n’est plus possible?
(…) On a de plus en plus souvent l’impression que notre monde ne distingue plus, au-delà de sa finitude dont il a pris soudainement conscience, qu’un gouffre inconnu et d’autant plus redoutable qu’il n’en saisit pas encore les contours.
(…) Parvenu à ce stade, le système tel qu’on le connaît a cessé d’être viable, non parce qu’il est moralement inacceptable comme l’ont cru tous ceux qui se levèrent contre son implacable domination, mais parce qu’il semble spatialement terminé.
(…) dépourvu désormais des soupapes de sûreté qui ont jalonné son expansion, il ne peut perdurer qu’en se transformant.
(…) Car ces masses deshéritées qui peuplent les continents du Sud, ces talons d’Achille de « l’équilibre » (notre vocabulaire est riche en euphémisme) mondial ne sont pas plus porteuses d’utopies révolutionnaires que d’autres « moteurs » de l’histoire, naguère investis de la mission de transformer le monde. »
p. 289-290 ; « Mais les éternels exclus constituent, et ce n’est pas si mal, des forces qui contribuent à tracer ces fissures lézardant le système, et qui pourraient profiter des brèches ouvertes par la fragilité nouvelle du modèle et sa difficulté à se réaliser universellement pour explorer les voies de leur autonomie et d’une possible rennaissance.
(…) Car si l’on veut bien jeter un dernier regard sur les pages qui précédent, on s’apercevra que ce ne sont pas seulement les inégalités dans la répartition de ses fruits qui sont à l’origine des maux de notre siècle, mais la nature même de cette croissance.
(…) Mais un combat aujourd’hui ne peut trouver son sens que si l’on commence par s’interroger sur ce que produire veut dire, par le savoir dans quelle mesure le Progrès peut engendrer des progrès, par oublier la perspective du Jugement Dernier, qu’il vienne de Dieu ou de l’Histoire, pour cerner ce qui est humainement souhaitable et pour préparer des avenirs vivables.
(…) Victoire à la Pyrrhus sans doute, mais qui risque de s’éterniser jusqu’à ces cataclymes que l’on n’ose prévoir, si aucun mouvement ne se dessine pour apporter un démenti valable à son insupportable, et durable, supériorité. Ce démenti, c’est aujourd’hui dans la construction inlassable, et souvent sans gloire, d’autres présents, et non plus dans les soleils futurs des révolutions, qu’il devient urgent de le trouver. »