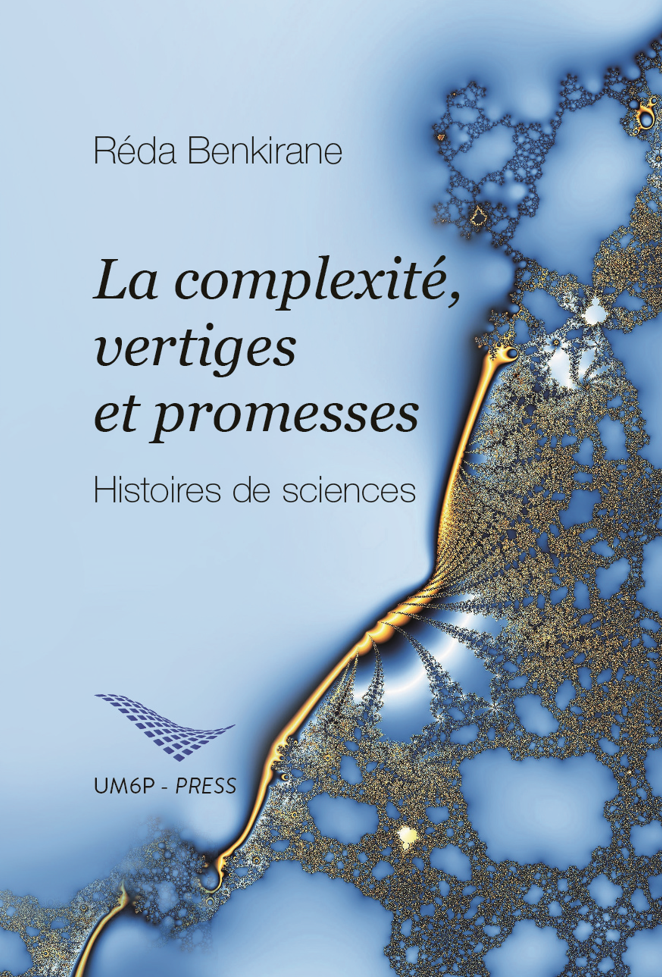François Partant, Seuil, Paris, 1976.
« Que pourrait être le développement, non plus pour un Etat, mais pour un peuple ? Comment abattre concrètement les pouvoirs qui s’y opposent ? »
La réflexion d’un homme de terrain sur ce qu’est et ce que doit être le « développement ». Une analyse intéressante de l’expérience algérienne est présentée en quelques pages.
L’auteur est économiste, « banquier envoyé dans le tiers monde pour y apporter l' »aide » du capitalisme. Quitte ensuite le secteur privé pour le secteur public, observant sous un angle nouveau le même système d’exploitation. Renonce enfin à toute activité professionnelle, « partant » se mettre au service des pays sous-développés mais sans pouvoir servir réellement le développement. »
extraits significatifs
p. 15 ; « Il m’aura fallu renoncer à toute activité et revenir à l’économie théorique, pour enfin comprendre pourquoi, dans la pratique économique et dans un cadre officiel (celui de l’assistance technique ou un autre), il est impossible de travailler contre le « sous-développement ».
p. 16 ; « Démontrer l’irréalisme de cette politique constante de développement et tenter d’en définir une autre, c’était donc là le sujet de l’étude opérationnelle dans laquelle le Congo ne servait que d’exemple. »
p. 17 ; « Or, si un chef d’Etat, surtout dans le tiers monde, se déclare volontiers prêt à diriger (!) la révolution, jusqu’à quel point peut-il accepter qu’elle se fasse en dehors de lui ? »
p. 19-20-21 ; « Il assure (le développement ) en effet une concentration des pouvoirs -et par conséquent des ressources nationales- au profit d’une minorité dont les objectifs économiques et sociaux sont ou deviennent rapidement en opposition avec ceux de la masse de la population. Le « développement » n’est alors qu’une tentation de concentrer davantage de ressources et -toujours par voie de conséquence- davantage de pouvoirs au profit de cette même minorité. Quant au résultat, on le constate partout : il peut y avoir croissance économique, il n’y a jamais de développement.
(…) L’Etat est incompatible avec le développement .
(…) Mais, pour l’instant, il faut accepter l’évidence : il n’existe pratiquement pas de chefs d’Etat « représentatifs du tiers monde », du tiers monde réel, de l’immense majorité de la population qui s’y trouve et qu’on ne peut guère appeler que « le peuple ».
(…) Non, il n’y a pas de leaders du tiers monde, il n’y a que des chefs d’Etat. Ceux qui passent pour en être, soit à l’initiative de leurs pairs (jadis Nehru, Boumedienne aujourd’hui…), soit par la volonté de leurs alliés dominants (Senghor, élu de l’Elysée et de l’Académie française…), soit parce que de vivaces lobbies coloniaux et racistes leur donnent la publicité nécessaire (Idi Amin Dada ou Bokassa exprimerait tous les « délires » de l’Afrique dite indépendante…) ne peuvent représenter que les forces qui sont à l’origine ou à la base de l’Etat : soit une puissance ex-coloniale ou dominante, soit une étroite couche sociale qu’on dit « évoluée », dont l’existence et l’évolution dépendent essentiellement d’une ou plusieurs puissances dominantes, soit enfin les deux. Ils sont l’émanation d’un ensemble de pouvoirs et s’appuient sur des structures institutionnelles également inadaptées à la société « réelle », à laquelle pouvoirs et structures ont bel et bien imposés, parfois à la faveur d’une illusoire indépendance. Ils incarnent eux-mêmes un type de pouvoir qui ne peut être qu’arbitraire et aberrant, précisément parce qu’il ne procède pas de la société sous-jacente .
En admettant qu’il le veuille, il est presque impossible pour un chef d’Etat de favoriser un renversement du rapport de forces, afin de rendre au peuple une possibilité d’évolution autonome. Car il est lui-même prisonnier de la structure étatique.
(…) C’est pourtant en présupposant cette volonté de suicide du pouvoir étatique et en se plaçant dans l’optique d’un peuple « primitif » qu’on cherchera ultérieurement -dans la deuxième partie de cet ouvrage- les conditions, les instruments, la possible dynamique, l’objectif vraisemblable d’un développement. »
p. 22 ; « Ce qui risque de se produire -et qui serait beaucoup plus grave pour les pays industrialisés que la constitution d’un bloc par les Etats du tiers monde- c’est l’éclatement du tiers monde lui-même. »
p. 23 ; « Dans les pays industrialisés, le sort des travailleurs n’est pas indépendant du tiers monde. »
p. 24 ; « La solidarité du tiers monde est une réalité, mais une « réalité future ». Pour l’heure, elle n’est encore qu’une vague complicité entre Etats. Complicité provisoire, occasionnelle, changeante, ambiguè, très souvent malsaine, quand elle ne tourne pas à l’obscénité pure et simple, les baisers qu’échangent les chefs d’Etat pouvant célébrer sans pudeur, devant un public résigné (ce sont des « affaires d’Etat » et non de moeurs) d’étranges mariages d’affaires entre la République et la Dictature, la Monarchie et la Révolution… »
p. 25 ; « Certains, plus chanceux, espèrent davantage : ils pensent être assez forts pour changer de camp et devenir à leur tour « exploiteurs », que ce soit sous le drapeau impérial du chah d’Iran ou sous celui de la révolution socialiste algérienne. »
p. 26 ; « Praticien de l’économie, je suis en quelque sorte tenu à une démarche inverse : rapporter ce qu’enseigne l’expérience ou ce qui paraît possible dans une réalité concrète, pour n’aborder la théorie que dans la mesure où elle donne un cadre conceptuel glaobal aux propositions qui sont faites. »
p. 28 ; « (…) parce que ma préoccupation est la même : s’il y a discours, ce n’est qu’un discours en vue de l’action. »
p. 31 ; « Malgré le poids politique important qu’il a désormais au sein de la collectivité internationale, le tiers monde n’a donc pas été capable de concevoir et d’imposer aux nations riches un ordre économique qui lui soit favorable. La récente crise pétrolière, en modifiant les équilibres entre pays producteurs et pays consommateurs, passe pour avoir amorcé un changement décisif. Pourtant, loin d’être une victoire pour les peuples du tiers monde, elle a certainement retardé la solution des problèmes qui se posent à eux.
En effet, les succès remportés par les exportateurs de pétrole encouragent les autres producteurs de matières premières à s’en tenir à l’attitude strictement revendicative qu’ils ont jusqu’ici adoptée.
Tous vont donc essayer de retirer plus de profits de leurs échanges avec les pays industrialisés, auxquels ils continueront de se référer pour définir ce que peut et doit être leur propre progrès économique. »
p. 32-33 ; « Le concept de sous-développement est né, lorsque les guerres de libération dans le tiers monde ou la décolonisation préventive et pacifique débouchèrent sur la création d’Etats indépendants et inviables. Les difficultés économiques et financières que connaissaient ces Etats ont d’abord été attribuées -officiellement tout au moins- à leur pauvreté.
(…) On sait pourtant bien que la plupart des pays sous-développés sont riches en ressources naturelles ou en potentialités diverses, qu’ils le sont parfois prodigieusement, qu’enfin sur leurs ressources repose, pour une bonne part, la construction économique des pays les plus industrialisés.
Si l’on ne peut plus soutenir qu’ils sont intrinsèquement pauvres, on peut du moins constater qu’ils sont, à tous égards, en retard par rapport à ces derniers.
(…) Bien que les notions de Centre et de Périphérie soient mécaniques et non géographiques, la Périphérie recouvre grosso modo le tiers monde. »
p. 34 ; « Le sous-développement n’est pas inhérent au tiers monde ; il y a été introduit. Ce n’est pas un état d’infériorité qui peut être surmonté. C’est un processus qu’il faut interrompre.
(…) Si elle est fort peu discutée à l’intérieur des Etats, la spécialisation du travail ne l’est pas davantage au plan international. »
p. 35 ; « Car la spécialisation du travail n’existe ni au Centre ni à la Périphérie, mais seulement entre le Centre et la Périphérie .
(…) Car l’économie mondiale, décrite par l’économiste libéral, n’existe pas et ne peut pas exister dans le contexte international actuel. Les relations économiques entre Etats ne relèvent jamais de la libre concurrence, certaines structures empêchant en tout état de cause celle-ci de jouer (multinationales, cartels, monopoles, etc.). »
p. 36 ; « Matières premières : démunir les riches, en faire des « assistés ».
Le « pillage du tiers monde » a commencé dès les grandes expéditions, au cours desquelles « découvertes », conquêtes, razzia et évangélisation allaient de pair, les missionnaires étant armés et les découvreurs de continents ne revenant pas les mains vides. Civilisations détruites, génocides, esclavage, colonisation… L’Europe a bâti des empires et s’est elle-même construite sur ces empires. Parfois avec d’autres méthodes, les Etats-Unis et le Japon en firent de même. Mais c’est la révolution industrielle et l’avance technologique des conquérants enrichis qui va, à partir de la fin du XIXème siècle, donner une ampleur prodigieuse au pillage. Cette avance va d’abord provoquer une régression technologique des peuples dominés (l’Afrique ne peut plus utiliser les métaux dont elle connaissait l’usage avant l’ère coloniale), puis créer pour eux un « retard » qui ne se rattrapera plus, qui au contraire s’auto-entretiendra. Grâce à quoi, aujourd’hui comme hier, les pays dominés sont des esclaves, au service des pays anciennement dominants. »
p. 37 ; « Notons en passant que si l’exploitation minière entraîne un appauvrissement réel du pays, elle n’en provoquera pas moins une augmentation du produit intérieur brut (PIB) : l’économiste y verra la preuve d’une certaine « croissance économique ». A noter aussi que la nationalisation de la mine ne résoudra pas le problème fondamental que pose son exploitation, tout en en créant certainement d’autres, aux niveaux technique et commercial. »
p. 38 ; « Au vrai, on se demande parfois si les gouvernants du tiers monde ne sont pas subjugués par les seuls artifices du langage : « mise en valeur », « croissance du P.I.B. », « investissement lourd », « en voie de développement »…
p. 41 ; « On verra ultérieurement, en cherchant les conditions d’un développement de l’agriculture, qu’il faut d’abord redresser une situation crée par l’histoire, en abandonnant toute référence aux conditions et aux coûts de production dans les pays les plus favorisés. Il faut renoncer à certains critères de rentabilité, qui, dans le cadre d’une zone économique constituée de régions trop homogène, interdisent les projets à long terme et transforment la pauvreté relative en misère absolue. »
p. 42 ; « Ils vont subventionner leurs importations, faute de pouvoir financer leur agriculture. Et du même coup -comble de l’ironie !- ils auront subventionné l’agriculture des pays exportateurs, par exemple celle des Etats-Unis.
Ce n’est pas seulement en Inde, mais dans bien des pays africains et à Madagascar, que cette politique de subventions aux importations a dû être menée en 1974. Bien qu’aberrante, elle est inévitable dans des pays qui doivent, d’une part, nourrir une population appauvrie, d’autre part éviter une réorientation de la production intérieure entraînant un recul des cultures d’exportation. Mais pour quoi doivent-ils cultiver du cacao pour le marché mondial, plutôt que des produits vivriers pour eux-mêmes ? A cette question, on répondra plus tard : elle est « politique ».
Remaniements au plan d’utilisation du tiers monde.
La spécialisation internationale du travail est parfois discutée dans son contenu, mais elle ne l’est jamais dans son principe. C’est ainsi que bien des experts dénoncent les dangers de la monoculture dans certains pays du tiers monde, telle la canne à sucre dans les Caraïbes ou à l’île Maurice. Faut-il leur rappeler que Madagascar n’est nullement en voie de développement, malgré ses exportations de café, de cacao, de vanille, de girofle, de sucre de canne, d’arachides, de tabac, de pois du Cap, de viande, de sisal, de banane, de manioc transformé (tapioca), de minerais divers (graphite, mica, chromites, pierres rares, etc.) cette impressionnante liste de produits exportables venant s’accroître, grâce à l’introduction du thé et d’une nouvelle culture, celle du « petit pois rouge », qui ne trouve de débouché qu’au Japon ?
C’est que les pays sous-développés espèrent, eux aussi, améliorer leur situation grâce à une « diversification des cultures ». Mais cette diversification n’est jamais conçue dans le cadre d’une politique économique globale visant à rebâtir un marché intérieur. Les conditions d’ouverture de ce marché n’étant pas réunies, c’est toujours en vue de l’exportation qu’il faut produire « autre chose ».
A cette politique, qui accentue l’extraversion économique, les organismes internationaux (techniques tel le FAO, ou financiers : BIRD, BEI, FED) apportent volontiers leurs concours, car les grandes puissances qui les contrôlent ont tout intérêt à diversifier leurs sources d’approvisionnement. »
p. 43 ; « Indispensable aux économies du Centre, maintenant la Périphérie dans une position dépendante et subordonnée, la spécialisation internationale du travail est, en quelque sorte, un plan directeur d’utilisation du tiers monde .
(…) Arbitrairement réunies en un seul ensemble économique (en une seule « économie mondiale »), des régions hétérogènes sont devenues des régions inégales. Mais leur inégalité est fonctionnelle, les unes étant mises au service des autres. Le système économique mondial puise sa dynamique dans cette inégalité. Il faut alors que les « pauvres » continuent de jouer leur rôle, pour que les « riches » conservent leur position. »
p. 44 ; « Sur une plantation africaine de cacao, l’ouvrier agricole reçoit un salaire annuel inférieur à 1000 f. A cette condition, la plantation est rentable pour le propriétaire-exploitant, étant entendu que le profit qu’il en tire est souvent exporté, soit directement (placements à l’étranger), soit indirectement (consommation de produits étrangers).
(…) En définitive, le pays exportateur de cacao ne reçoit, en contrepartie réelle de ses livraisons sur le marché mondial, qu’un prix résiduel, fort peu éloigné du cours mondial du cacao.
(…) Puis le pays va importer des produits élaborés, par exemple du chocolat, alors que le cacao n’entre qu’à concurrence de 10 % dans le prix-détail de la tablette de chocolat. »
p. 45 ; « Le tourisme international constitue une monumentale escroquerie, dont la quasi-totalité des pays du tiers monde deviennent victimes, et dont la quasi-totalité des bénéfices reviennent aux Etats centraux : à des sociétés d’études, à des compagnies aériennes, à des sociétés de gestion hôtelière, à des centres d’achats extérieurs, à des agences touristiques, à des intermédiaires de toute espèce… Les pays sous-développés ne parviennent très généralement pas à amortir l’infrastructure d’accueil qu’ils ont construite à leurs frais. Ils ne conservent, sur les milliards brassés, que les sommes dérisoires affectées à des achats locaux (par exemple à un artisanat qui se dégrade pour être au niveau du touriste) à la rémunération d’un personnel domestique et à la prostitution… »
p. 46 ; « Par exemple, des brasseries se sont installées un peu partout dans le tiers monde. En remboursements de l’investissement qu’elles représentent, en achats et en renouvellement de matériels, ainsi que de produits et matières intermédiaires, elles coûtent plus cher aux pays concernés que des importations de bière.
(…) Inintégrables en tant qu’instruments, leur production n’étant elle-même pas intégrée, les industries d’import-substitution aggravent ainsi le chômage au lieu de le résorber. Elles représentent enfin de solides liens de dépendance entre le Centre et la Périphérie, l’un ayant imposé à l’autre, d’abord les produits qu’il avait à vendre, puis les matériels qui permettent de fabriquer ces produits. »
p. 47 ; « Pour éluder le problème de la pollution, certains pays ont déplacé vers la Périphérie leurs industries les plus polluantes (raffineries, cimenteries, papèteries, etc.), le Japon ayant, par exemple, investi dans ce but en Indonésie. D’autres ont été obligés de transférer leurs industries de main d’oeuvre vers les régions où celle-ci peut être surexploitée, tout en étant d’une haute qualification ; ainsi les industries d’optique allemandes ont-elles émigré dans le Sud-Est asiatique…
(…) Il faut ici rappeler que l’ouvrier du tiers monde est payé entre cinq et dix fois moins que l’ouvrier occidental, dans d’identiques usines et à productivité égale. »
p. 48 ; « Autant que l’industrie lourde (aciérie, métalurgie, etc.), l’informatique fait aujourd’hui partie de l’industrie de base d’un pays hautement industrialisé.
En Algérie, par exemple, les industries fondées dans cette optique n’ont favorisé que l’industrialisation des Etats centraux. Le shéma d’industrialisation étant trop ambitieux, les effets heureux qu’on en attendait se sont produits, non pas à l’intérieur du pays, mais à l’extérieur. »
p. 52 ; « Le poids du futur pèse de plus en plus sur le présent, alors même que ce futur qu’on prépare paraît de plus en plus improbable. »
p. 53 ; « La croissance n’est plus un moyen mais une fin en soi, non pas subjectivement, mais objectivement. »
p. 61 ; « Aujourd’hui, on commence pourtant à comprendre que l’avenir ne peut pas être une projection mathématique à partir du présent. »
p. 62 ; « Lorsque la question est posée sous cet angle, à savoir celui de l’invraisemblable déséquilibre démographique dans le monde (Il y a plus d’habitants au km2 en Hollande qu’en Inde), les pays industrialisés y répondent en préconisant une limitation des naissances dans le tiers monde, qui est pourtant, à l’exception de l’Asie, manifestement sous-peuplée par rapport à son potentiel économique.
(…) Cet exemple illustre une évidence, qu’on aura d’autres occasions de mettre en lumière : les pays industrialisés ne peuvent se préoccuper que des manifestations du sous-développement et non de ses causes . »
p. 64-65-66 ; « La construction d’une Algérie « indépendante » et « socialiste » n’a porté atteinte qu’à quelques intérêts privés, fort peu à ceux de la France, nullement à ceux de l’ensemble des Etats centraux et du monde capitaliste en particulier.
Certes, l’Allemagne fédéral, qui détient un monopole de fait en matière d’équipement lourd en Europe occidentale, est sans doute la principale bénéficiaire de la politique algérienne de développement. Mais tous les Etats centraux, de l’Est comme de l’Ouest, et sans oublier le Japon, réalisent des profits à la mesure des ambitions du régime algérien, épongeant, grâce à des fournitures de matériels et de services, les ressources du pays, celles que lui procurent son gaz et son pétrole, celles qu’il attend de son industrialisation, les bénéfices de la haute productivité des instruments de production ayant une fâcheuse tendance à rester dans les pays qui les fabriquent et les vendent. Si la France a plus souvent un rôle de courtier que de fournisseur, la faute en revient à sa propre construction industrielle, elle-même tributaire de l’industrie allemande. Mais les gains des innombrables intermédiaires, au nombre desquels une majorité d’entreprises françaises, qui interviennent depuis le stade des études jusqu’aux réalisations « clés en main », sont loin d’être négligeables : le surcoût des investissement en Algérie est évalué à 30 % de la valeur théorique de ceux-ci !
Que la plupart des investissements soient réalisés dans le cadre de sociétés étatiques ne gêne en rien les pays qui équipent l’Algérie. D’autant que ceux-ci apportent très généralement à ces sociétés une assistance de longue durée, en matière de technique et de gestion, de telle sorte que le statut juridique des sociétés n’est que de pure forme.
Et en quoi la nationalisation (encore partielle) du pétrole et du gaz algérien a-t-elle lésé les intérêts des Etats centraux ? Ceux-ci continuent, comme par le passé, d’être approvisionnés en énergie. Leurs intérêts privés ont été évincés, mais on les retrouve aujourd’hui associés à la SONATRACH, dans des filiales spécialisées de cette société nationale, et dans le cadre d’une « joint venture » de plus en plus appréciée. Comme par le passé, ce sont les Etats centraux qui vendent à l’Algérie les équipements nécessaires à la recherche, à l’exploitation et à l’exportation du gaz et du pétrole, ainsi que ceux qui permettent la valorisation industrielle des produits pétroliers. Bien que leur interlocuteur soit une société étatique, l’échange est déséquilibré, au point de paraître parfois scandaleux.
C’est ainsi, par exemple, que la SONATRACH a acheté, aux USA et au Japon, une installation pour la liquéfaction du gaz arrivant à Arzew, grâce à un crédit que lui a consenti un groupe de banques américaines et japonaises, crédit qui sera remboursé en vingt-cinq ans par des livraisons de gaz à un prix stabilisé. Une telle installation n’ayant aucune chance d’avoir une vie technique aussi longue, il est plus que probable que le gaz algérien ne financera que sa propre exploitation. Il serait question que ce contrat soit renégocié, les avantages qu’en retirent les pays acheteurs d’énergie et fournisseurs de matériels étant jugés excessifs. Excessifs, sans doute, mais nullement « anormaux », si l’on considère la manière dont les richesses naturelles du tiers monde sont mises en valeur.
Le déséquilibre des échanges entre le Centre et la Périphérie s’aggrave, lorsque cette dernière importe des biens auxquels est incorporée une valeur ajoutée maximale. Il s’aggrave quand elle importe une technologie de pointe, d’autant que le coût de l’instrument doté d’une haute technologie est désormais hors de proportion avec la productivité qu’on peut en attendre. Or, c’est précisément le choix qu’a fait l’Algérie. Les Etats centraux tirent évidemment parti de ce choix. Mais comment auraient-ils réagi si l’Algérie avait fait le pari de bâtir, non pas une économie « avancée », mais une société socialiste, de compter davantage sur sa population, aujourd’hui en chômage ou « exportée », que sur une technologie importée ? La construction d’une Algérie réellement indépendante (comptant peu sur l' »ennemi » extérieur) et authentiquement socialiste (comptant davantage sur son peuple), aurait certainement posé un sérieux problème à la collectivité internationale.
(…) il ne sert rien de soigner les petits boutons de fièvre du tuberculeux. »
p. 67 ; « Pour atteindre le but théorique qu’elles poursuivent, les organisations charitables devraient au moins inscrire leurs actions ponctuelles dans le cadre d’une lutte précise contre la cause des maux qu’elles soignent : par exemple, contre les structures agraires, le mode d’appropriation des sols, ou certaines cultures qui favorisent les déséquilibres climatiques, la sécheresse ou les inondations… »
p. 70 ; « Parmi les doctrines (ou les croyances) qui procèdent de leur « idéologie dominante », les plus enracinées et les plus inquiétantes pour l’avenir de l’humanité sont précisément celles qui sont relatives au développement. »
p. 71 ; « L’immense majorité est conservatrice. Pourtant elle croit aussi à l’utopie, puisqu’elle croit que l’humanité avance sur la voie d’un progrès.
(…) Les grands romans de science-fiction -ceux qui sont porteurs de messages- décrivent une humanité future, conditionnée et écervelée par sa propre construction technico-économique (et par conséquent politique). »
p. 72 ; « Désormais le progrès s’autodétruit, en détruisant l’objet auquel il s’applique (le monde physique), tandis que la fraction de l’humanité qui croyait le maîtriser à son profit est contrainte d’en accepter la loi. »
p. 76 ; « La bourgeoisie du tiers monde, qu’elle soit d’origine capitaliste, politique, administrative ou militaire, est ainsi incorporée dans le système économique international qui assure une croissance au Centre. Sans doute s’y trouve-t-elle dans une position subordonnée, puisqu’elle n’a pas un rôle directeur décisif dans les activités qui la font vivre -d’où le qualificatif de lumpen bourgeoisie qui lui a été donné. »
p. 78 , « Tout particulièrement dans les Etats nouvellement indépendants, où la lumpen bourgeoisie a utilisé le nationalisme pour accaparer le pouvoir politique, le socialisme sert de couverture aux ambitions de cette classe composée essentiellement de fonctionnaires, justifiant la bureaucratisation de l’économie, mais tournant court dès lors que l’option impliquerait une rupture avec le monde capitaliste (c.f. L’Algérie, la Tanzanie, etc.).
Il faut se rendre à l’évidence : c’est la formation sociale dans les pays périphériques qui interdit que soit trouvée une voie vers le développement.
(…) Mais il serait absurde de ne pas reconnaître la part considérable de responsabilité que portent les bourgeoisies du tiers monde, dans le fonctionnement d’un système d’exploitation « global », dont elles dénoncent pourtant si volontiers l’injustice sur la scène internationale. Elles représentent un maillon indispensable de la chaîne qui lie les pays exploités aux pays exploiteurs.
(…) Les élites intellectuelles du tiers monde n’appartiennent plus à la civilisation des peuples qui les dirigent. Elles sont porteuses d’une civilisation économique et technique. Et elles n’existent, en tant qu’élites dirigeantes, que parce qu’elles sont porteuses de cette civilisation étrangère. Mais est-ce d’une civilisation à proprement parler, ou d’une idéologie qu’elles sont le cheval de Troie introduit dans leur propre pays ? »
p. 80 , « La lumpen bourgeoisie se trouve donc, à l’échelle d’un Etat, dans la même position que l’Etat central à l’échelle internationale.
(…) C’est d’abord en tant que classe consommatrice que la lumpen bourgeoisie se fixe cet objectif de progrès.
La relation entre consommation et sous-développement est essentielle. On sait que l’échange inégal et sa dégradation dans le temps n’entraînent pas la ruine du pays périphérique et l’arrêt des échanges, si le paysan demeure un producteur, tout en étant exclu de l’économie en tant que consommateur. Pourtant, c’est le consommateur qui impose l’échange inégal : le consommateur privilégié, dont les habitudes de consommation sont modelées par l’étranger. La bourgeaoisie dispose en effet de revenus importants, dont la fraction consacrée à la consommation est trop élevée par rapport à la production nationale directement consommable. »
p. 81-82 ; « … les conflits d’intérêts entre classes sociales se doublent de conflits de civilisations.
De ce mépris, que la lumpen bourgeoisiue se défend bien entendu d’éprouver, on pourrait donner d’innombrables exemples, dont certains sont grotesques (règlement de l’habillement) et d’autres dramatiques (sédentarisation autoritaire de nomades, génocides, etc.).
(…) Car, les élites nationales comme pour ces derniers, le peuple n’est pas victime du sous-développement, il en est responsable . Il le porte en lui. Le sous-développement du pays est dû à son ignorance, à ses traditions malsaines, à sa paresse… Et c’est pourquoi tout le discours résonne de discours à la gloire dutravail. »
p.84 ; « Déjà décrochée à tous égards du peuple, la lumpen bourgeoisie a ainsi tendance à s’en éloigner toujours davantage. Dès lors, son avenir dépend de plus en plus de ses alliances extérieures . »
p. 87 ; « La plupart des spécialistes de la politique mondiale estiment que les révoltes du tiers monde, pour inévitable qu’elles soient ne pourront déboucher sur une mise en question fondamentale de l’ordre économique international. Ils fondent leur opinion sur une série d’évidences. »
p. 88 , « En définitive, la lumpen bourgeoisie, garante de l’ordre économique international, a une positionpolitique beaucoup plus forte que celle d’une bourgeoisie dirigeante du Centre, d’une part grâce à ses alliances extérieures, d’autre part et surtout, parce que le peuple n’existe pas, en tant que force organisée et organisable dans la plupart des pays périphériques. »
p. 90 ; « Ce n’est pas nécessairement le prolétariat qui est porteur de la révolution, mais bien la quasi-totalité de la population. Et c’est la population entière qui peut basculer dans le camp de la révolution, dans tous les pays qui ne disposent pas de ressources naturelles importantes et qui ne peuvent donc assurer le fonctionnement de l’Etat et une rente à leur lumpen bourgeoisie, en dilapidant le capital que représentent ces ressources. »
p. 92 ; « Les peuples du tiers monde se trouvent très exactement, dans la situation qui fut celle de la classe ouvrière au XIXème siècle, au moment où le marxisme (qui ne prévoyait pas toutes les conséquences de l’évolution de l’exploitation dans la Périphérie) démontra au prolétariat qu’il ne servait à rien de réclamer plus de justice dans les rapports socio-économiques au sein de la société bourgeoise, qu’il fallait abattre cette société pour que puisse s’instaurer la justice. Si les gouvernants du tiers monde, dans la mesure où ils sont l’émanation de la lumpen bourgeoisie , ont pu jusqu’ici s’en tenir à une attitude revendicative au sein de la société interétatique, les peuples, quant à eux, n’ont pas le choix : ils ne peuvent échapper à l’exploitation qu’en sortant de la société qui l’organise.
p. 93 ; « Pour un peuple victime du sous-développement, bloqué par le système d’exploitation, à la fois dans la misère et dans une impasse technique , l’objectif à atteindre n’est pas de ressembler aux peuples nantis, d’avoir leur niveau de production et de consommation. »
p. 94 ; « La construction d’une économie nationale n’est jamais envisagée en fonction du pays et de la société concernée, encore moins à partir du rôle théorique qu’a ou que devrait avoir une économie. Elle l’est seulement par référence à un modèle extérieur au pays, par référence à ce que les Etats centraux ont fait de l’économie, de leur niveau technique, de l’organisation sociale qu’implique leur propre construction économique. »
p. 95 ; « Cependant, un impératif s’impose à tous les pays du tiers monde, à tous ceux qui tenteraient de se reconstruire en dehors du système économique mondial : une révolution. Cet impératif n’est pas purement politique. Il est technique.
Certes ! le développement a une dimension politique que trop souvent on oublie. On ne peut le réduire à un shéma technocratique, aussi satisfaisant que celui-ci puisse paraître. On ne peut, par exemple, négliger les conséquences qu’auront les différentes étapes de la construction économique sur la formation sociale (c’est manifestement là le principal vice du « projet algérien »). »
p. 96 , « Un plan de développement digne de ce nom, ne peut être que celui d’une révolution. »
p. 98 ; « Il ne s’agit évidemment pas d’établir un « dialogue », comme on prétend de plus en plus souvent vouloir le faire dans les pays francophones, où les « mots » du Général de Gaulle tiennent lieu de politique. Il s’agit de mettre en forme l’avenir dans l’action, le peuple ayant des pouvoirs à la mesure des responsabilités qui lui incombent et pouvant ainsi orienter les choix du pouvoir. Sa participation, indispensable à la reconstruction d’une économie nationale, ne peut être effective que s’il cesse d’être l’instrument d’une politique qu’il lui est imposée , pour devenir le moteur d’une politique qu’il choisit ou adopte. »
p. 99 ; « Mais ils savent qu’ils sont tout au bas de l’échelle des sociétés. Leur avenir, au mieux, ne peut être que le présent. Il n’a pas de forme précise. Il n’est en tout cas pas « l’objet » ou l’ascension individuelle. Il est vierge. Et ces peuples bloqués et vacants sont nécessairement porteurs d’un autre avenir. Car ils sont condamnés à innover pour échapper au sous-développement et à l’exploitation qui le provoque. ils sont contraints d’aller dans une autre direction que celle qui a été imposée au monde entier par la civilisation jusqu’ici triomphante du Centre. Mais s’ils s’engagent dans une autre voie, ce sont eux qui, à leur tour, condamnent ceux qui les ont exploités. Dans cette mesure (une mesure en quelque sorte « technique »), ils sont ainsi porteurs de la révolution mondiale : si on ne peut pas les empêcher d’aller de l’avant, il faudra les suivre… »
p. 100-101 , « Afficher des options politiques avancées (socialistes, marxistes-léninistes…), se doter d’un nouveau drapeau (rouge évidemment), engager des campagnes verbales de politisation (ou plus précisément de propagande), avant d’avoir atteint quelques objectifs stratégiquement décisifs, avant que la population ait eu la possibilité d’apprécier la valeur de ces options et de se politiser d’elle-même dans une action effective, c’est prendre un risque considérable, non seulement vis-à-vis de l’extérieur, mais au plan interne. Il ne faut pas oublier que les régimes sont jugés (surtout à l’extérieur) beaucoup moins sur ce qu’ils font que sur ce qu’ils prétendent vouloir faire. Le mot « socialisme » ou, a fortiori, « communisme » déclenche bien souvent des réactions allergiques, même chez ceux qui accepteraient avec soulagement un ordre authentiquement socialiste ou communiste, où rapports de production, rapports sociaux et rapports humains sont par définition acceptables par tout le monde, sauf par ceux qui veulent exploiter autrui et se couper de la sorte du groupe social. Il est dangereux d’ignorer ce phénomène de rejet instinctif, particulièrement fort dans les pays idéologiquement dominés, où les aspects les plus choquants de certaines expériences « socialistes » ont puissamment servi la propagande de la puissance dominante et de ses alliés locaux. »
p. 103 ; « Et agir comme si cet espoir était déjà une contribution à la venue de cette utopie internationale, qui est aussi peu vraisemblable qu’elle est nécessaire. »
p. 107 ; « Toutes les subtiles analyses politiques qu’on peut faire pour démontrer le contraire présentent un défaut majeur : elles sont contredites par l’expérience.
L’Etat, gestionnaire des structures étatiques, doit être aussi provisoire que ces structures devraient l’être. Son rôle, en tant que pouvoir politique, est d’abord de mettre en question son pouvoir. il n’est pas d’édicter et d’imposer une loi « idéologique », mais de la solliciter du peuple. »
p. 113 , « Il est rès rare qu’une technique soit « neutre », qu’elle ne procède d’aucune conception politique, d’aucune idéologie, qu’elle ne favorise aucune tendance politique. Il est encore plus rare que le technicien ait conscience du choix politique qu’il fait en employant sa technique.
(…) Et il est remarquable qu’un expert de l’ONU formé aux USA, un fonctionnaire soviétique du Gosplan et un technicien appointé par une société privée d’études européenne, aient des méthodes de travail tout à fait comparables. »
p. 114 ; « Le rôle décisif qu’a le système des échanges internationaux dans le processus de sous-développement, est ignoré par ceux auxquels l’échange profite.
La méthodologie de l’expert n’est pas politiquement neutre : elle est le produit de l’idéologie dominante des Etats centraux . »
p. 115-116 ; « la route est une condition nécessaire et non pas suffisante du développement. Son utilité économique sera nulle, aussi longtemps que le contexte interdira le retour du paysannat dans la vie économique du pays. Il est déplorable qu’un village ne puisse plus recevoir de sel, parce que la route s’est effondrée. Mais il est absurde de construire une route pour apporter un kilo de sel à des villageois et drainer, en retour, un sac de riz ou de manioc.
A force de n’envisager « l’exploitation » que sous l’angle du Capital, on en arrive assez vite à faire disparaître de l’économie le concept pourtant essentiel d’activité . N’est-ce pas d’ailleurs la raison qui permet à certains économistes de porter toute leur attention sur les flux financiers (en matière d’aide, de volume d’investissements, de fuite de capitaux, etc.), de telle sorte que développement et sous-développement ne paraissent être que des problèmes de ressources ? »
p. 121 , « Dans le choix des objectifs à atteindre, comme dans celui des moyens, le planificateur raisonne en termes de comparaison. Il ne voit pas le pays dont il va programmer l’avenir. Il le compare . »
p. 125 ; « L’erreur du planificateur est d’imaginer l’avenir à partir de ce qui existe, au lieu de le faire en fonction du but poursuivi .
(…) Le Congo est un pays riche. Il est, au total, plus riche en ressources naturelles que la Norvège, le Danemark ou l’Italie. Divisées par le chiffre de sa population (environ 1 million d’habitants), ces richesses le placeraient très loin devant le Japon. Sur ses terres cultivables, dont une infime partie est cultivée, ainsi que sur ses ressources exploitées ou potentielles, il pourrait, en théorie, faire vivre une population infiniment plus nombreuse. »
p. 128 , « Quelle est donc la dimension minimale que doit avoir une unité économique, pour pouvoir renoncer à servir l’économie mondiale, pour être autorisée à se construire elle-même ? »
p. 129 ; « Une micro-économie peut se développer sans élargissement du groupe social, dès lors que ce dernier consacre une partie de son travail à construire l’avenir, qu’il améliore son aptitude à dominer et à utiliser le milieu, présupposé utilisable dans des limites qu’il est bien aventureux de fixer a priori. Enfin, un million d’habitants suffirait à assurer le démarrage d’une économie intravertie, s’il s’agissait d’un million de producteurs-consommateurs, si ceux-ci étaient introduits dans des appareils de production perfectibles, dont le niveau technologique de départ et la productivité initiale importent peu, le seul probglème immédiat étant de recréer les conditions permettant des échanges internes. »
p. 132 ; « Enfin, la classe actuellement consommatrice est en elle-même trop étroite pour assurer un débouché à toutes les activités de production qui seraient en théorie, indispensables dans un pays replié sur lui-même.
Il faut donc recenser les besoins de l’énorme masse des consommateurs vivant jusqu’ici en dehors du marché. Etant entendu que le problème demeurera de rendre économiquement possible la satisfaction de besoins potentiels (en changeant le système de prix et de salaire, c’est-à-dire les conditions de l’échange) et aussi de laisser à la masse une certaine latitude pour définir elle-même ses besoins. »
p. 133 ; « Il est cependant bien évident que pour un pays qui a été dominé pendant des siècles, le problème n’est pas de retrouver son type original de consommation, mais bien de le réinventer . »
p. 134 ; « De l’inventaire des besoins, découle celui des activités à promouvoir, à développer ou à réorienter.
(…) Cependant, certaines activités ne peuvent ni s’interrompre ni être conçues autrement qu’elles ne le sont à l’heure actuelle, que ce soit techniquement ou économiquement : télécommunications, extraction et raffinage du pétrole, etc. »
p. 136 , « Si, par exemple, les Congolais retrouvaient un type de consommation conforme à leurs possibilités immédiates de production, ils ne construiraient plus d’immeubles en béton armé ou recouverts de tôles ondulées, n’utiliseraient plus de tissus synthétiques et ne mangeraient plus de beurre. Cela ne signifie pas qu’ils seraient plus mal logés, habillés et nourris que leurs voisins et que les peuples riches.
L’usage de la tôle ondulée est l’exemple même de l’absurde déplacement du « besoin » vers le produit importé. La tôle, outre sa laideur, ne convient pas au climat africain. Elle pourrait être avantageusement remplacée par des produits locaux (bois traité, bagasse agglomérée, tuiles, briques creuses, etc.), dont la production ne peut être techniquement et économiquement envisagée que si elle est massive. Le comble de l’absurde est évidemment d’en arriver à onduler localement la tôle (Haute-Volta), dans le cadre d’une industrie miniaturisée, qui coûte plus cher en dégrèvements fiscaux qu’elle ne rapporte de salaires, étant entendu qu’on ne peut même pas espérer une réduction des frais de transport sur l’importation de la tôle à plat ! Mais l’immeuble en béton, le plus souvent à usage de bureaux (ou pour loger les assistants techniques) n’est pas moins inadapté au climat. Source de sujétions techniques et commerciales (climatisation, ascenseurs, etc.) il est inutile dans un pays où la faible concentration urbaine ne justifie pas les constructions en hauteur. »
p. 137 ; « Il est cependant certain qu’au départ d’un remodelage économique, les coûts de production seront souvent supérieurs à ceux des Etats centraux. »
p. 138 , « La rentabilité, notion économique et sociale, au moins autant que financière, devrait être appréciée à l’échelle d’un groupe aussi large que possible d’opérations. Ainsi éviterait-on certaines impossibilités « techniques » qui ne sont généralement que financières. Par exemple, une ou plusieurs activités industrielles peuvent être déficitaires, tout en étant indispensables au développement d’autres activités, elles-mêmes rentables.
Il n’empêche que la reconstruction d’une économie décrochée de son contexte géographique n’est concevable, que si le milieu socio-politique est parfaitement homogène, totalement imperméable aux influences ou tentations extérieures. L’autarcie économique est difficile à mettre en oeuvre, non seulement parce qu’elle implique une autodiscipline de la population. Il ne peut être question de préserver les cohérences économiques internes par la contrainte.
(…) Un tel espoir serait passablement utopique dans une société de type occidental, où la réussite est individuelle et s’obtient malgré ou contre le milieu. Il l’est beaucoup moins dans une société dite primitive, d’ores et déjà divisée en micro-économies de subsitances autarciques, en groupes habitués à une autodiscipline pour survivre en dehors du système économique dominant. »
p. 140 ; « Le progrès technologique d’un pays est celui qu’il réalise lui-même. S’il est amené à l’importer, il doit le « voler ». Il doit être capable de l’adapter à son contexte propre, à ses besoins spécifiques, à ses propres impératifs économiques et sociaux. Le progrès technologique importé constitue une charge indéfinie, s’il ne peut être « intellectuellement » intégré, stade préalable à l’intégration économique. C’est pourquoi, au démarrage d’une reconstruction économique nationale, le niveau technologique des appareils de production devrait être aussi proche que possible du niveau de formation des travailleurs et des techniciens, quitte à amortir ces instruments pendant la durée de formation théorique et pratique de l’ensemble de la population.
(…) Un faible niveau technologique allègerait les dépenses d’investissement et accroîtrait le nombre des emplois. Mais il faciliterait surtout une intégration immédiate des instruments de production. Ceux-ci contiendraient, par exemple, plus de fonte et de tôles que d’aciers spéciaux. Or, si la création d’une aciérie est difficilement envisageable dans un petit pays au démarrage de sa reconstruction économique, celle de fonderies est toujours possible. »
p. 142 ; « Dans les pays où 80 à 95% de la population n’entrevoient du progrès technologique que la tôle ondulée, le bidon de récupération ou la bassine en plastique, les conséquences d’une régression technologique ne peuvent être dramatiques.
(…) Ce qui signifie que le problème du développement ne peut être posé en termes de compétition comme on le fait d’ordinaire. Tout au contraire, il ne pourra être résolu que par le refus de la compétition. »
p. 143 ; « En réalité, la politique des pôles n’est que la transposition, à l’échelle d’un pays, de l’organisation du système d’exploitation international et de sa dynamique : tous les efforts sont concentrés sur les pôles, qui drainent les ressources des régions les moins favorables aux investissements, de telle sorte que l’écart entre les régions s’aggrave. Quant à affirmer que les bénéfices de la croissance des pôles permettront de financer ultérieurement les régions déshéritées, c’est, d’une part, prévoir qu’on le fera dans de plus mauvaises conditions qu’au départ (ces régions s’étant « sous-développées » par rapport aux pôles) et c’est, d’autre part, reconnaître qu’il faudra bien un jour renoncer à la politique des pôles.
(…) Il faut « déraciner » le développement. »
p. 145 , « Le problème étant d’amener les producteurs à apprécier leurs intérêts à une échelle autre que territoriale (et qui ne devrait même plus être un jour celle du pays), ils ne doivent pas s’organiser en fonction du lieu de production, mais plutôt en fonction d’un produit ou d’un groupe de produits . »
p. 149 ; « Le technicien, surtout s’il a une quelconque teinture « socialiste », se place toujours dans l’optique d’une étatisation de l’économie, parce qu’il veut intervenir, qu’il ne peut le faire que sous le couvert de l’Etat, qu’enfin sa compétence ou celle de sa classe justifie la mise en tutelle du peuple. »
p. 150 ; « Parfois, dans le « secteur moderne », les travailleurs sont autorisés à s’organiser, mais sous la tutelle directe ou indirecte de la bureaucratie (et on aimerait que l’Organisation internationale du travail ait le courage de dénoncer le scandale que constitue le syndicalisme dans le tiers monde!). Il en va de même dans le domaine agricole, où la bureaucratie conserve le contrôle du paysannat, soit en encadrant des actions de développement, soit en monopolisant la collecte des produits (coopératives administratives de type tanzanien, sociétés d’Etat de type malgache ou algérien, etc.), de telle sorte que l’éventuelle organisation démocratique de la base n’est que de pure forme.
Dans tous les pays, le « peuple souverain » n’est ainsi autorisé à avoir, dans le domaine économique, qu’un rôle d’instrument. »
p. 151 ; « On ne parlera pas de l’autogestion en Algérie, qui n’a duré que le temps d’un feu de paille, la bureaucratie ayant rapidement pris le contrôle des entreprises, transformant quelques insuffisances techniques de gestion en scandales socio-politiques et, souvent, en faillites économiques (en particulier dans le domaine agricole). Ce n’est guère qu’en Yougoslavie que l’autogestion a été appliquée à l’échelle d’un pays. Mais les responsables politiques yougoslaves n’ont pas tiré toutes les conséquences de ce choix, en modifiant les structures de l’Etat et le rôle de l’administration. Sans doute parce que la Yougoslavie est profondément divisée et ne survit, en tant qu’Etat, que grâce à un pouvoir centralisé et fort. »
p. 168 ; « Améliorer l’habitat en région tropicale ne consiste pas à y introduire le ciment. Or, il n’existe pas d’industrie pour rendre plus confortable la maison en matériaux légers, la cuisine en plein air ou la douche alimentée en eau de pluie…
(…) Il est enfin à noter que la quasi-totalité des shémas de développement agricole prévoient que ce dernier résultera d’une addition de progrès individuels : quelques paysans modèles entraîneront les autres. C’est tabler sur une société individualiste et compétitive qui est à l’opposé de la société dite primitive. »
p. 169 ; « A l’heure actuelle, le paysan est victime de la dégradation des termes de l’échange en tant que consommateur. Le prix de ce qu’il produit n’augmente pas et parfois baisse, tandis qu’augmente régulièrement celui des rares produits industriels dont il a besoin : huile, tissus, ustensiles ménagers… »
p. 173 ; « Qu’il soit bien entendu que le but à atteindre n’est pas seulement d’accroître la production agricole, mais bien de permettre une amélioration du niveau de vie des paysans . »
p. 174 ; « Le développement de l’agriculture et le relèvement du niveau de vie des paysans impliquent que le volume de produits par paysan augmente, et qu’augmente aussi la superficie cultivée par chacun d’eux. Il faut alors faire exploser la trop petite propriété individuelle ou familiale -lorsqu’elle existe- et prévoir la mécanisation des cultures.
L’extension des terres cultivées, les changements dans les méthodes culturales et la nouvelle répartition des tâches interdiront plus que probablement la culture des terres familiales dans un cadres strictement familial. »
p. 187 ; « La conception qu’on a de l’administration publique est fonction de celle qu’on a de l’Etat, puisque l’administration n’est que la courroie de transmission entre l’Etat, pouvoir politique, et le peuple « souverain ». Selon les orientations du pouvoir politique, selon le rôle qui est reconnu au peuple dans la gestion des affaires publiques et dans celle de l’économie, l’administration devrait elle-même avoir un rôle et un visage différents. Or, il n’en est rien. De même qu’on essaye en vain de démocratiser l’enseignement sans toucher à l’école, on pense pouvoir instaurer la démocratie sans toucher aux organes qui permettent à l’Etat d’intervenir dans l’économie et dans la société : on repense plus volontiers la doctrine que l’organisation pratique, la philosophie que l’institution. »
p. 191 ; « L’Europe a introduit, au cours des siècles, dans le monde qu’elle envahissait puis soumettait à son contrôle, ses « valeurs », sa religion, ses institutions et, parmi elles, son école. Son système d’enseignement pouvait paraître satisfaisant dans les pays qui n’en dépossédaient pas (ce qui est probablement très rare), tout comme la démocratie déléguée de type occidental peut passer pour idéale là où règne l’arbitraire. Mais il n’a jamais été jusqu’ici sérieusement discuté, même dans les pays où existait un autre système d’enseignement aisément perfectible, comme par exemple dans les pays musulmans, c’est qu’il était imposé par les plus forts, qu’il semblait être une des causes de leur force, un des facteurs de leur développement économique et technique. »
p. 192 ; « En république populaire du Congo, l’école française, avec des programmes français, des critères de sélection français, s’emploie à former des petits bourgeois français.
(…) Car l’école n’a nullement pour fonction de former « le peuple », mais bien de dégager des « élites ».
p. 194 ; « Selon les pays du tiers monde, l’Etat consacre entre 20 et 35 % de son budget à l’enseignement, sans parvenir à donner un minimum d’instruction à plus de 50 % en moyenne des enfants en âge d’être scolarisés. »
p. 195 ; « L’école a enfin dénaturé jusqu’au sens que doit avoir l’enseignement. L’acquisition de la connaissance n’est plus un but en soi, mais le moyen de la « réussite ». On apprend, non pour savoir, mais pour posséder : posséder le diplôme, posséder les avantages liés au diplôme…
C’est donc la signification de l’enseignement qu’il faut d’abord redéfinir, avant d’adopter le système qui l’assure à la société qu’on veut favoriser. »
p. 197 ; « Le droit à la connaissance est un des droits élémentaires les plus importants et les moins reconnus.
(…) Le droit à la connaisssance doit être reconnu à tous et tout le long de la vie. »
p. 202 ; « Il s’agirait de rendre fluides les rapports sociaux, acquisition et diffusion de la connaissance devenant une activité essentielle du groupe social. »
p. 203 ; « La radio, la télévision et le cinéma apporteraient enfin leurs concours à ce système d’enseignement libre, ouvert, démocratique, non rémunéré et collectif. »
p. 204 ; « Dans une société qui aurait socialisé son système d’enseignement, il appartiendrait à la collectivité de répartir les tâches en fonction des connaissances acquises, ou plutôt d’une compétence que jamais le diplôme ne prouve mais que la pratique démontre.
(…) La valeur d’un médecin est beaucoup plus sûrement évaluée par ses patients que par le ministre qui le nomme à son poste… »
p. 208 ; « Les socialistes des pays industrialisés doivent impérativement reconsidérer leur tactique politique et leur stratégie à moyen terme, s’ils veulent, d’une part, éliminer le risque d’une aberrante alliance de classes antagonistes contre un tiers monde en révolte, d’autre part éviter qu’à l’avenir l’idéal socialiste ne soit, une fois de plus, défiguré par ceux qui le mettront en oeuvre. »
p. 213 ; « Désormais, un pays idéalement équipé pour se défendre contre une attaque extérieure ne peut se protéger en employant les armes dont il dispose, sauf à courir le risque d’un anéantissement total, définitif. En ce cas, que prétend-il défendre ? »
p. 215 ; « Là, survivent des civilisaions qui n’ont certes pas que des vertus et des valeurs « universalisables ». Elles sont souvent affublées de structures malsaines et entachées d’injustice graves. Mais bien au-delà de ce qui serait à réformer ou à sublimer, elles ont en commun un fondement idéologique qui explique peut-être leur défaite historique, sûrement aussi leur opiniâtre survie. Un ressort idéologique que l’homme a intériorisé jusque dans son être physique, et qui se révèle dans son expression corporelle, dans son rire, dans la danse… La base d’une autre idéologie, le ressort d’un autre avenir. Car ces civilisations, comme le dit Balandier, accordaient plus d’importance à l’être qu’à l’avoir . Et c’est bien en effet cette hiérarchie des valeurs, ce renversement des priorités, qui permettraient que soit redonnée une dimension sociale à l’économie comme aux techniques, que soit rendue à l’homme la place qu’il devrait avoir dans sa propre création. »