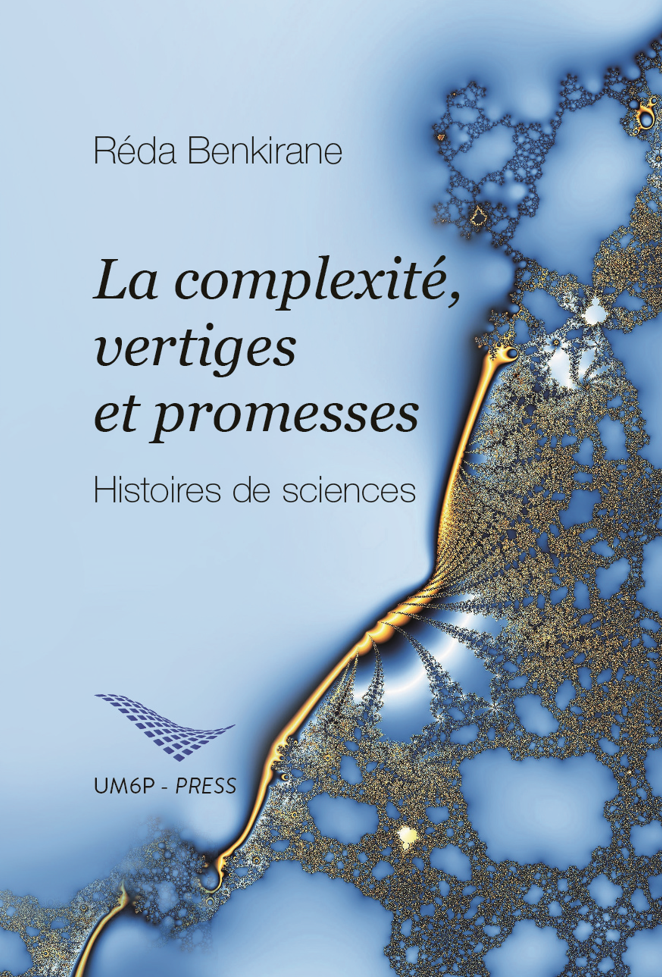Bruno Pinchard, Philosophie à outrance. Cinq essais de métaphysique contemporaine, E.M.E., 2010.
Bruno Pinchard, Philosophie à outrance. Cinq essais de métaphysique contemporaine, E.M.E., 2010.
Dans cet ouvrage, Bruno Pinchard s’attelle à une « théorie des complexités » et poursuit son parti pris d’une invention métaphysique contemporaine.
Prenant acte de la disparition d’une philosophie de l’esprit qui se définisse par rapport à l’Absolu et ne trouvant aucune raison de borner les jeux de l’intelligence au seul art commun de faire des phrases, il cherche dans des mots-concrétions : nom, masque, tarot, occultation, polyphonie, les résonances et les analogies d’une parole antérieure au discours. Il montre comment de telles rencontres tiennent curieusement tête au chaos et participent à l’édification d’un Mémorial de la splendeur.
La poursuite d’un dessein métaphysique contemporain ne va pas sans de telles outrances. Après Malebranche et sa critique de la représentation, la mémoire du Pantagruélisme selon Rabelais, le Mémorial de Pascal et une certaine Mythodicée issue de Leibniz sont entraînés dans une véritable reconfiguration du paysage spéculatif, en hauteur et en profondeur. Mais cette façon de perpétuer à tout prix un regard métaphysique aurait cette conséquence imprévue : la partie contre l’absurde n’est pas toujours perdue, pourvu qu’on cesse de penser avec des idées (et les techniques auxquelles elles s’asservissent), pour se souvenir de l’excellence des noms, des rites et des dieux.
Bruno Pinchard est professeur de philosophie à l’Université de Lyon et directeur de l’Ecole doctorale Rhône-Alpes. Il est l’auteur entre autres de Méditations mythologiques (Le Seuil/Les Empêcheurs de penser en rond 2002), Heidegger et la question de l’humanisme (dir., PUF 2005) et Recherches métaphysiques, Philosophie française contemporaine (Tokyo, 2009, Nihon University Press).
Extrait de Bruno Pinchard, Philosophie à outrance. Cinq essais de métaphysique contemporaine, E.M.E., 2010.
Polyphonie du désordre
par Bruno Pinchard
- DE LA NECESSITE DU DESORDRE
Il est bien des façons de lire et de relire la Théodicée de Leibniz sur la bonté de Dieu, la liberté de l’homme et l’origine du mal, pour reprendre son titre complet. Mais la plus aveugle consisterait, dans l’urgence des drames contemporains, à s’emparer des solutions proposées par l’auteur, en cédant à la tentation de simplifier une œuvre parmi les plus touffues et les plus rhapsodiques de Leibniz et de la tradition métaphysique tout entière.
Essayons de réfléchir un instant à la façon dont le livre se donne à nous : loin de s’en tenir à une épure et à la structure d’un traité systématique, il se présente comme un collage aberrant de thèmes, de diversions, de remarques latérales et de démonstrations d’érudition superfétatoire qui découragera toujours l’homme pressé d’en finir avec la question du mal. Leibniz a été tout de suite conscient du défaut de composition de son livre et s’en excuse mollement : « Mais enfin j’ai été obligé de ramasser mes pensées sur tous ces sujets liés ensemble, et d’en faire part au public[1]. » Dans un lettre à Burnett, il se fait plus direct encore : « La plus grande partie de cet ouvrage avait été faite par lambeaux[2]», et il rappelait alors le lien de ces spéculations avec les débats développés à la cour de la Reine de Prusse.
Ces thèmes du lambeau et du rassemblement ne peuvent être pris à la légère, d’autant plus que la Préface de l’œuvre donne lieu à l’esquisse d’un projet dont le livre semble marquer l’échec radical plus qu’une esquisse convaincante :
« J’avais tâché de bâtir sur de tels fondements, établis d’une manière démonstrative, un corps entier des connaissances principales que la Raison toute pure nous peut apprendre, un corps, dis-je, dont toutes les parties fussent bien liés, et qui pût satisfaire aux difficultés les plus considérables des anciens et des modernes[3]. »
Mais, à quoi bon, puisque je ne faisais tant d’effort que pour Pierre Bayle et qu’il vient de mourir ! Soumis aux réciprocités du système monadique, Leibniz n’arrive jamais à commencer l’oeuvre grandiose faute de vis-à-vis approprié. Sa vie se passe alors en dispersions accablantes. Il l’avoue humblement à son correspondant Burnett : « Si j’étais débarrassé de mes travaux historiques, je voudrais me mettre à établir ces Éléments de la Philosophie générale et de la Théologie naturelle, qui comprend ce qu’il y a de plus important dans cette Philosophie pour la Théorie et pour la Pratique. » Il se console cependant en avançant que « ce présent ouvrage peut servir d’avant-coureur, comme aussi les pièces détachées que j’ai données dans les journaux d’Allemagne, de France et de Hollande[4]. »
Il faut dont s’y faire, les matériaux de la Théodicée sont certes liés ensemble, mais ils ne sont pas bien liés, en un corps démonstratif, comme le regrettera toujours en vain son auteur. Certes, la Monadologie, avec ses références infra-paginales insistantes à la Théodicée, constitue comme la trame systématique de l’œuvre. Mais pour abondantes qu’elles soient, ces notes sont aussi évasives et incomplètes que les entrées de la Table des matières que Leibniz a cru devoir ajouter à son grand œuvre pour en faciliter l’usage. Nous sommes loin du rêve d’un corps de doctrine dans sa forme systématique et exhaustive. Il faut s’y faire, on ne peut traiter du mal que par fragments. C’est le premier signe de finitude qui s’impose au livre labyrinthique. Il mérite qu’on s’y attarde.
Mais que le propos garde la forme des conversations de cour dont il est issu, passe encore, mais que la gravité du problème suprême du mal devienne l’occasion pour présenter l’état passé et actuel des travaux de l’auteur, qu’il donne lieu à des digressions sur l’histoire supposée d’un Hermès mondial, qu’il donne lieu à des débats sans fin avec un mécréant comme Bayle et laisse si peu de place aux autorités scripturaires ou à un débat en forme avec les philosophes contemporains ou du passé, voilà qui pourrait passer pour de la pure et simple mondanité, pour une complaisance d’auteur, pour une confusion regrettable des genres.
Que faire en effet de phrases de ce genre : « J’avais publié un système nouveau […] : il fut assez applaudi » ; « Ayant fait de nouvelles découvertes sur la nature de la force Active, sur les lois du mouvement[…] ». Ou encore : « J’ai même démontré que s’il n’y avait rien que de passif dans les corps, leurs différents états seraient indiscernables […]» ? Cette fois, on a l’impression de dépasser les bornes du sérieux, d’autant plus que pour faire mieux comprendre en passant comment l’homme s’aide du secours de la grâce dans la conversion, il faut entendre qu’il n’y a point de coopération dans la glace, lorsqu’elle est rompue[5]… Ce passage de la grâce à la glace laisse rêveur. Il fait penser à ceux qui ont failli perdre la vie en se laissant aller à confondre l’âme et l’âne[6].
Mais Leibniz se veut rassurant : « Enfin j’ai tâché de tout rapporter à l’édification ; et si j’ai donné quelque chose à la curiosité, c’est que j’ai cru qu’il fallait égayer une matière dont le sérieux peut rebuter[7]. » Et de fait, les remarques de linguistique indo-européenne qui suivent ne laissent pas d’étonner au milieu des spéculations techniques de théologie. Mais Leibniz se veut rassurant : « Ces remarques ne déplairont peut-être pas aux curieux ». Il est vrai que les curieux ont matière à satisfaire leur passion dans ces pages étranges. Mais peut-être aussi bien seront-ils déçus par un auteur qui reconnaît qu’il a été particulièrement précipité et « distrait[8] » en rédigeant cet ouvrage.
Parvenu à ce point de notre lecture, est-il besoin d’aller plus loin et de prêter une attention démesurée à un livre de cette forme ? Quel pourrait en être le centre de gravité ? L’œuvre n’est-elle pas manquée et ne faudrait-il pas directement passer à l’étude de Kant si nous voulions nous faire une idée sur l’origine radicale du mal et sur les impossibilités de toute théodicée ?
Avant d’en finir aussi vite, il convient cependant de peser notre jugement. Et si notre déception n’était que le fait d’une superficialité navrante ? Et si le mal ne se livrait pas de face, mais toujours de biais, selon quelque anamorphose ? Ce modèle n’est pas étranger à Leibniz, il l’emploie précisément pour nous donner à entendre comment le bien surpasse le mal dans ce monde chaotique en apparence :
« C’est comme dans ces inventions de perspective, où certains beaux dessins ne paraissent que confusion, jusqu’à ce qu’on les rapporte à leur vrai point de vue, ou qu’on les regarde par le moyen d’un certain verre ou miroir. C’est en les plaçant et s’en servant comme il faut, qu’on les fait devenir l’ornement d’un cabinet[9]. »
L’anamorphose est la pudeur de toute pensée du mal, la trace de l’onde de choc qu’elle crée. Le mal indicible a paru, a jeté son désordre dans la représentation, a scellé sa présence en se rendant à jamais invisible de face. Restent les points de vues latéraux. Mais qui saura déterminer le vrai point de vue pour entendre une telle Théodicée de la pudeur selon sa juste perspective ? Qui nous donnera le vrai point de vue sur les « déformités apparentes de nos petits mondes » afin qu’elles se réunissent « en beautés dans le grand » ? Elles n’auraient plus rien alors « qui s’oppose à l’unité d’un principe universel infiniment parfait[10]. » Mais qui peut surmonter les aveuglements de notre finitude, qui sont autant de marques de nos épreuves ? Dans ses déformations irréductibles, le livre de Leibniz donne à lire la résistance de notre souffrance à la certitude de sa fin universelle.
Ainsi faut-il suivre jusqu’au bout la série des analogies dans lesquelles nous sommes entraînés : voici un livre confus qui nous donne à entendre comment s’ordonne la confusion apparente de la condition humaine et qui le fait en montrant comment nos vies, comme nos livres, sont choisies et rangées « non pas tant suivant leur excellence, que suivant la convenance » qu’elles ont avec le plan de Dieu[11], c’est à dire avec le grand monde. Un livre ordonné, un discours maîtrisé ne procéderait-il pas à l’inverse de ce qu’il chercherait à démontrer ? C’est le désordre qui porte ici tout l’effort de la démonstration. L’homme, nous le devinions déjà à l’occasion du jeu sur la grâce et sur la glace, n’est pas appelé à coopérer à l’œuvre divine. Coopérer ici serait simplement résister. Il suffit de convenir qu’il y a des degrés dans la résistance, et c’est ce qui fait la différence entre les hommes. Les circonstances contribuent à notre attention à ce qui nous est donné, ainsi qu’aux mouvements de notre âme. C’est le concours de tous ces facteurs qui décide des effets de la grâce sans les rendre jamais seulement nécessaires[12]. Comment s’étonner dès lors que le livre qui transmet de telles vérités ait été composé au gré des circonstances ?
Il y a donc lieu de prêter d’abord attention à la symphonie de l’argumentation leibnizienne et de ne pas se laisser prendre au thème simple du « procès de Dieu » ou de la « cause de Dieu ». On peut, en effet, abréger la controverse, et la réduire à des arguments en forme, et Leibniz joint à la fin de son livre un essai significatif de cet ordre. Mais ce jeu logique est pauvre. Surtout il n’est pas à la mesure des mouvements nécessaires pour poursuivre jusque dans ses conséquences les plus extrêmes la nécessaire analogie entre l’homme, le livre et Dieu, entre le petit monde, les représentations livresques qu’il se donne sur le tout, et la façon dont il parvient, par expressions successives, à se donner la représentation la moins limitative possible de la cité sainte ou république des esprits, celle qu’il est amené à contempler depuis sa naissance ou son émergence comme monade rationnelle.
Il nous appartiendrait donc de recueillir de la façon la plus attentive les volutes de la Théodicée si nous voulions nous pénétrer de sa doctrine la plus féconde et de ses stratégies d’enveloppement de la question du mal. Rien dans le fond n’est étranger au problème du mal. Tout savoir, toute expérience, toute érudition, toute modélisation y sont convoqués. On ne traite pas séparément du problème du mal et du problème de la connaissance. C’est précisément la supériorité de Leibniz sur Kant que d’avoir impliqué sa Théodicée dans son ontologie, son ontologie dans sa théorie de la connaissance, et sa théorie de la connaissance dans son explication de la beauté de l’univers. C’est en tous les cas une autre façon de se mettre à la hauteur du problème et de sa propension à se répandre sur tous les versants de la manifestation. Le mal se propage, le livre doit aussi se propager. C’est le résultat d’un monde dans lequel le mal est consubstantiel à toute réalité en tant qu’elle est seulement possible.
C’est ce que Leibniz enseigne en une phrase : « Il y a une imperfection originale de la créature avant le péché, parce que la créature est limitée essentiellement[13]. » Le livre qui dit cette imperfection doit épouser son objet. Se libérant du traitement global du problème que la théologie propose pour répondre au plus vite à l’inquiétude humaine, il répond à un autre désir, celui de trouver une forme d’ordre en mouvement qui prenne en compte les résistances, et comme l’inertie des créatures. Il ne sera pas désordonné pour autant, il se contentera de prendre en compte le rythme de la question, c’est-à-dire la façon dont le bateau de l’auteur est lui-même chargé sur le fleuve des doutes et des circonstances qu’il doit, comme tout être vivant, descendre en se fiant au courant universel. Seulement il n’y a pas de cheminement unique, ni exemplaire. Chaque péniche a son gabarit et son chargement influe sur la vitesse avec laquelle elle descend le fleuve :
« La matière est portée originairement à la tardivité, ou à la privation de vitesse ; non pas pour la diminuer par soi-même, quand elle a déjà reçu cette vitesse, car ce serait agir, mais pour modérer par sa réceptivité l’effet de l’impression, quand elle le doit recevoir[14]. »
Ainsi Leibniz lui-même n’agit-il pas lui-même quand il consent au désordre de son œuvre, il ne fait qu’exprimer les modalités propres de sa réceptivité originaire. Il y a une inertie de l’écriture comme il y a une inertie de la volonté. Mais l’un et l’autre naviguent sur le même courant universel. Tout vivant est pris dans ce courant cosmique et sa fragilité croît à mesure qu’il s’y expose davantage. Plus son âme est chargée d’événements et de savoirs, plus elle est sensible à sa propre passivité. Une philosophie conséquente n’échappe pas à cette marque de la condition humaine.
Et continuant la métaphore du fleuve, il ajoute encore : « Dieu est aussi peu la cause du péché, que le courant de la rivière est la cause du retardement du bateau[15]. » C’est pourquoi le livre de Dieu ne ressemblera jamais au livre d’un philosophe. Leibniz a soin de libérer l’exposition de la philosophie de toute procession définitive du Logos qui prétendrait aller à tout ce qui est possible[16]. Au contraire, l’imperfection sera la marque d’une singularité vivante et l’attestation que ce livre, qui passe pour présenter de grands arguments pour vaincre l’insatisfaction qu’on éprouve à l’égard du tout, en réalité se raconte à lui-même, et à sa propre limitation, le parcours qu’il lui faut encore effectuer pour considérer sa place dans l’ordre de la manifestation universelle.
- LE DETAIL DE L’ORDRE
Au cœur de sa libre revue des thèmes principaux du leibnizianisme, la Préface de l’œuvre, déjà bien sollicitée par notre première approche, livre comme en passant un principe de grand poids pour l’intelligence de cette étonnante liberté de la philosophie de l’harmonie à l’égard d’un irréductible désordre : « Il n’y a point de chaos dans l’intérieur des choses[17] ». Dans ce passage, il s’agit de la préformation du vivant. Leibniz dans les lignes précédentes rappelait les motifs classiques d’un auteur des choses, qui fait tout avec ordre. Cependant cet ordre n’est pas seulement l’ordre du présent, c’est un ordre préétabli programmant tout « artifice futur ». Soudain le texte prolifère et voici qu’il devient nécessaire de considérer qu’une pensée du mal, pour peu qu’elle veuille maintenir un lien avec la vie, doit reconnaître pour commencer que l’organisation est partout, jusque dans la matière.
Leibniz n’en est pas moins étranger au partage qui voudrait reconnaître d’un côté l’angoisse invincible du mal et poser de l’autre l’affirmation optimiste que tout est vivant. En réalité, ces deux affirmations sont les deux faces de la même pacification de notre regard sur le tout. Nous sommes face à un véritable déplacement. Nous pensions avoir affaire à un procès en bonne et due forme, fût-il celui de Dieu. En réalité, le théâtre de l’action a changé insensiblement. Nous attendions la méditation d’un mystère, nous voici face à une ontologie. Il se pourrait que le procès de Dieu ne soit qu’une occasion :
« Comme la matière est sur le tapis, que d’habiles gens y travaillent encore, et que le public y est attentif, j’ai cru qu’il fallait se servir de l’occasion pour faire paraître un Echantillon de mes pensées[18]. »
L’ampleur de la polémique n’est donc ressaisie, de fond en comble, que pour que paraissent les automates systémiques leibniziens, ces fragments axiomatisés que suscite la grande Architectonique harmonique. La joie de la liaison universelle à laquelle ils contribuent l’emporte sur l’angoisse du mal et il n’y a de délivrance que par la multiplication de ces tentatives d’intelligibilité qui nous donnent un aperçu sur l’infinité de l’univers : à nous de continuer à diviser les phénomènes, comme la nature l’a fait elle-même[19]. Là est la puissance de l’esprit, là est la source de toute joie, qui s’identifie avec la découverte du principe de plénitude de l’univers.
La scène du débat a donc changé : elle fut d’abord dans l’arène des théologiens et le « Discours de la Conformité de la foi et de la raison » nous entraîne de Sorbonne en consistoires, au travers de toutes les religions, de tous les partis pris, de toutes les sectes, de toutes les hérésies et les polémiques. Mais c’est pour nous emmener bientôt dans un détail de l’univers qui nous fait mesurer l’ordre, non plus dans les formes globales manifestées par le monde phénoménal, mais dans la combinatoire infinitésimale des opérations intérieures du plan substantiel : « il y a de l’organisme partout, quoique toutes les masses ne composent point des corps organiques[20]. » Nous sommes ainsi invités à nous délivrer des « masses » pour entrer dans l’intérieur des choses, et c’est sur ce plan seul que la solidarité du bien et du mal peut être appréciée, hors de la portée de toute tentation manichéenne.
Finie la déification des formes apparentes. Il est autrement décisif de laisser aux phénomènes leurs apparences, de quitter le plan des agrégats visibles pour parvenir aux vraies sources de l’intelligibilité, au plan des actions monadiques, qui, dans le détail des transformations, constituent le vrai plan où bien et mal échangent leurs fécondités, sans que la précipitation d’un regard anthropocentrique vienne faire obstacle aux compensations inévitables de l’action et de la passion. Les plus grands maux soufferts par les hommes sur la terre deviennent alors des projections macroscopiques de variations infinitésimales dans l’ontologie sous-jacente : « il fallait qu’il y eût des différents degrés dans la perfection des choses, et qu’il y eût aussi des limitations de toute sorte[21] ».
Prenons y garde, une grande philosophie est en train, non pas de résoudre le problème du mal, mais de s’en débarrasser. A la place du pathos de la souffrance et de la faute, voici un univers de spontanéité, dont la faute n’est qu’une privation qui remonte aux sources de l’univers et à laquelle la volonté et la puissance de Dieu créant le monde, ne saurait rien changer. Les fautes qui apparemment défiguraient la création n’étaient que des fautes macroscopiques, mais au plan des énergies fondamentales, tout était conforme à l’ordre, dès lors qu’on reconnaissait que l’univers vivant ne pouvait, à lui tout seul, être un autre Dieu. Le monde est un tout continu, il n’y a pas place pour deux causes ordonnatrices et il suffit que la puissance du Dieu unique confère l’existence à la pondération particulière de plénitude et de privation qui a constitué l’idée de ce monde, pourvu qu’il ait été reconnu comme le Meilleur des mondes qui devait exister et qui, de fait, existe.
Leibniz aimait correspondre avec Bayle dont il ne cesse de faire l’éloge : « on a trouvé un beau champ pour s’exercer en entrant avec lui dans le détail[22]. Cette émergence du détail laisse entendre mieux que toute explication logique quelle est la nouvelle forme d’unité d’un monde qui a renoncé à une systématique superficielle. Cette unité n’a rien à faire avec les agrégats extérieurs : la seule énergie porteuse d’ordre se trouve au niveau des singularités. L’ordre total est une consonance, mais ne constitue pas un organisme contraignant ou englobant. Dieu fonde le monde, il ne le réduit pas à ne constituer qu’un accident de ses attributs principaux.
Plus encore, l’accident, loin d’être un moment instable de la substance et de se résoudre dans une unité supérieure, est le point d’articulation du réel et la seule attestation de la vérité de la substance, qui ne serait rien si elle ne constituait pas le lien entre les accidents. L’accident est signe de substantialité et c’est depuis l’accident, l’événement, le fortuit, le passager ou l’incongru que la ligne de la substance révèle sa complexité et donc sa richesse ontologique : « Ainsi le tout revient souvent aux Circonstances, qui font une partie de l’enchaînement des choses[23]».
L’ordre leibnizien n’est pas un ordre géométrique, c’est un ordre moral. Ce n’est pas une mise en forme d’un divers récalcitrant, c’est un monde. Le mal appartient au mystère du monde, seul un monde peut lui répondre, avec tous ses accidents « représentés déjà parfaitement dans l’idée de ce monde possible[24]. » Mais qu’est-ce qu’un monde ?
- DIALOGUE DE MONDES
« J’appelle Monde toute la suite et toute la collection de toutes les choses existantes, afin qu’on ne dise point que plusieurs mondes pouvaient exister en différents temps et différents lieux. Car il faudrait les compter tous ensemble pour un monde, ou si vous voulez un Univers. Et quand on remplirait tous les temps et tous les lieux, il demeure toujours vrai qu’on les aurait pu remplir d’une infinité de manières, et qu’il y a une infinité de Mondes possibles, dont il faut que Dieu ait choisi le meilleur, puisqu’il ne fait rien sans agir suivant la suprême raison[25]. »
En entrant dans la question du monde, chacun sent bien que la question prend une autre ampleur, car elle ouvre vers des questions qui nous sont contemporaines. Heidegger a fondé sa volonté de destruction de la métaphysique traditionnelle sur l’argument qu’il était le premier à poser la question du monde pour un être fini. Nous le voyons pourtant, la question du monde est au centre de la logique et de la théodicée leibnizienne. Est-ce à dire que Heidegger reprocherait à Leibniz de s’en être tenu à des mondes «possibles » et fuirait dans l’entendement divin le sérieux de l’existant? L’objection n’est guère pertinente car il est assez clair que le monde dans lequel nous sommes est pour Leibniz la collection des choses « existantes ». Quant à Heidegger, loin de s’en tenir au cosmos clos des anciens, il fait de la tournure du monde l’émergence d’un sens possible, un projet dans la possibilité que l’Etre ouvre à chaque instant au Dasein. La possibilité leibnizienne est bien cet horizon de l’existant qui cerne chacun des états du monde présent et ouvre, à chaque bifurcation, aux chemins nouveaux qu’exige le maximum pour se réaliser.
Cette maximalisation est remplacée par l’authenticité de la résolution chez Heidegger. Là encore, un dialogue serait admissible et Heidegger lui-même a reconnu ce que le Dasein devait à la monade. Il est pourtant un point où le monde selon Leibniz se distingue du monde heideggerien, c’est celui du continu et des liens qu’il exige. Leibniz précise sa pensée en ces termes sans ambiguïté :
« Car il faut savoir que tout est lié dans chacun des Mondes possibles : l’Univers, quel qu’il puisse être, est tout d’une pièce, comme un Océan […] et chaque chose a contribué idéalement avant son existence à la résolution qui a été prise sur l’existence de toutes les choses[26] . »
Il est important de citer en entier ce texte capital car nous y retrouvons une « résolution », mais cette fois suspendue à l’idéalité solidaire de chaque élément qui compose le monde. Cette précédence du possible sur le réel passe peut-être pour le comble de la métaphysique, mais même chez Heidegger, il faut bien que mes actes soient possibles pour qu’ils deviennent proprement les miens. En revanche, ce qui est inconcevable pour le Dasein, c’est que les possibles soient liés entre eux et que leur puissance de monde repose sur cette continuité idéale. Le parti pris du lien, on le sait, est le propre des « Visions du monde » dans l’analytique existentiale[27]. Il semblerait qu’il faille choisir entre lier et questionner. Penser, c’est toujours délier pour Heidegger et c’est ce qui le sépare le plus fondamentalement de cette monadologie dont il parle pourtant avec faveur. Mais il a cru qu’il n’y avait d’urgence du lien que pour une pensée soumise au principe de raison, alors que sans doute il aurait fallu raisonner à l’envers : c’est la nécessité du lien qui commande l’universalité du principe de raison, car seule l’unité permet d’interroger le sens de l’être. Chez Heidegger au contraire, le décèlement de la vérité est suspendu à un temps discontinu et c’est sur ce culte de la différence que se fondent les apories de l’héroïsme ontologisant qui en découle.
S’il faut résumer la fonction du « monde » leibnizien dans l’approche du mal, c’est bien dans la constitution idéale des liens qu’il suppose. Mais s’il y a lien, que devient le partage du bien et du mal ? Être leibnizien, est-ce donc cela, lier le bien et le mal ? Et en finir avec le procès de Dieu, n’est-ce pas supposer que l’antique conflit du bien et du mal doit se résoudre dans le tissage de leurs rapports à l’intérieur du monde le plus riche possible ? On le voit, en refusant les liens, Heidegger est plus proche des religieux que le philosophe Leibniz. Le luthérianisme va mieux au catholique Heidegger qu’au protestant Leibniz.
Tandis, en effet, que le théologien délie au nom de la transcendance, principe de déliaison, le philosophe lie au nom de la raison conçue comme l’ « enchaînement des Vérités[28]» :
« Les Mystères surpassent notre raison, car ils contiennent des vérités qui ne sont pas comprises dans cet enchaînement ; mais il ne sont point contraires à notre raison, et ne contredisent à aucune des vérités où cet enchaînement nous peut mener[29]. »
C’est pourquoi le modèle suprême de l’intelligibilité leibnizienne sera toujours l’harmonie. C’est elle qui fait toujours « la liaison, tant de l’avenir avec le passé, que du présent avec ce qui est absent[30]. » Il faut entrer dans les matières religieuses avec un tel dessein de liaison, de commerce, de sérialité, qui doit nous apprendre à reconnaître la continuité du temps comme de l’espace. C’est encore l’harmonie qui va unir l’élément diabolique, qui introduit en toute chose la déliaison, avec l’idéalité du bien. Le théologien voudrait délier le monde face à l’horreur du mal, le philosophe propose d’introduire le mal jusque dans l’entendement divin et de fonder l’idéalité du mal qui lui assure une combinaison avec les principes du bien, même si son action ne sera une action que par déficience ou privation :
« C’est la Region des verités éternelles, qu’il faut mettre à la place de la matière, quand il s’agit de chercher la source des choses. Cette Région est la cause idéale du mal (pour ainsi dire) aussi bien que du bien [31]. »
Notre auteur, on le voit, mesure l’énormité du propos, mais il le maintient. Introducteur d’un nouveau concept de monde dans la philosophie, qui repose sur la primauté du lien sur l’être, Leibniz évite tous les écueils des pensées solitaires et des transcendances unilatérales. Ainsi suivra-t-il, on l’a dit, les lignes du mal jusque dans l’entendement divin. Il ne s’en tient pas à la métaphysique solaire de Platon et accepte une remonté de la privation jusque dans les principes. Fidèle à la tradition de la guerre des dieux dans l’Edda, il introduit le conflit dans les idées divines. Il fait de Dieu un être en proie au mal, au moins par ses idées, un être en lutte avec lui-même par la rivalité entre ses volontés antécédentes et sa volonté conséquente :
« Cette volonté conséquente, finale et décisive, résulte du conflit de toutes les volontés antécédentes, […] et c’est du concours de toutes ces volontés particulières, que vient la volonté totale[32]. »
La volonté, même en Dieu, à ses degrés, et la volonté totale, même en lui, a son histoire. Dieu domine le mal, il ne l’ignore jamais. Cette philosophie du monde repose peut-être sur une théologie spéculative du bien, elle est tout aussi bien une théosophie « faustienne » du mal. Ce n’est pas dire qu’elle se tienne « par-delà » le bien et le mal, mais elle se déploie avec le bien et le mal, et au prix de leur réciprocité. Cette oeuvre est une oeuvre d’alchimiste : si fata volunt, bina venena juvant, si les dieux le veulent, un venin redoublé peut guérir, «comme deux corps froids et ténébreux produisent un grand feu[33]. »
Tel est le prix d’une Théodicée qui ne s’en tient pas au défi des valeurs. Leibniz s’est en effet rapidement dégagé de la discussion en termes éthiques pour se fonder sur le jeu de l’action et de la passion. Les perfections et les imperfections ont pour nature d’être « mêlées et partagées », remarque-t-il : «C’est ce qui nous fait attribuer l’Action à l’un, et la Passion à l’autre[34] . » C’est donc au sein du mélange, et de l’action réciproque, que naissent les nouveaux partages de l’ontologie et rien ne serait plus abstrait que d’introduire ici un discours de la simple séparation. Il faut choisir entre le jugement éthique et l’optimisme ontologique. On ne peut avoir les deux. Leibniz nous importe parce que, dans le fond, malgré bien des retours, il a tranché en faveur du primat de l’ontologie sans céder pour autant à une pensée tragique.
Cette ontologie n’annonce en effet aucune ivresse de la puissance car elle ne cède à aucun principe de nécessité aveugle. Elle ne fait qu’enregistrer un critère de vérité universel qui ne se limite pas aux privilèges du monde humain : première émergence d’une pensée de la vie où les conditions de sa perpétuation l’emportent sur des fixations qui ne respectent pas l’immense mouvement de la métamorphose universelle.
Rien n’est plus clair à cet effet que le paragraphe où Leibniz avance que quand bien même les hommes seraient tous mauvais, on pourrait encore montrer qu’il y a un choix au fondement de l’existence qui répond à des raisons. Car il y a bien des différences entre les manières d’être mauvais [35] ! Le simple critère logique de la différence l’emporte ainsi sur l’objection théologique du mal universel. La variété est sauve, le monde peut être, il a une raison. Par ce rapport fondateur à l’ontologie, nous ne sommes pas loin évidemment de Spinoza, qui y a trouvé aussi des raisons de relativiser l’opposition du bien et du mal. Mais au lieu de fonder le monde sur une substance indifférenciée, Leibniz discerne des différences, opératoires jusque dans l’abîme du mal. En s’éloignant des théologies du mal, il ne délaissait pas les âmes et les corps qui y étaient exposés.
- UNE PENSEE SYMPHONIQUE
« Ces désordres sont allés dans l’ordre[36] ». Tel est le mot de Leibniz dans la Théodicée. La géométrie, avec ses équations capables d’ordonner les courbes les plus aléatoires, l’arithmétique, avec ses lois de variation dans les nombres, y sont plus significatifs en vérité que bien des travaux de logique pour donner un aperçu de la puissance d’ordre qui réside dans le parti pris de l’individuel : « il y a quelques fois des apparences d’irrégularité dans les Mathématiques, qui se terminent enfin dans un grand ordre, quand on a achevé de les approfondir[37]. » Après cet approfondissement, on est confronté à l’évidence que « tous les événements individuels, sans exception, sont des suites des volontés générales. »
Seulement, il reste à souligner que l’extraordinaire marquetterie d’une Théodicée ainsi réécrite selon le point de vue des aléas de l’individuel, ne peut être entendue dans toute sa puissance d’ordre laïque que si nous sommes sensibles à la polyphonie qui la gouverne. Leibniz n’est pas seulement un penseur de l’harmonie, c’est d’abord un polyphoniste. Que faut-il entendre par là ?
La Théodicée ne présente pas seulement des paquets de relation, elle croise de séries, elle superpose des trajectoires, elle marie des discours et rend ainsi les temps et les espaces tous simultanés dans une structure unifiée. Pour comprendre jusqu’au bout la Théodicée, et se donner une idée de la musique qu’elle abrite, il faudrait être doué de la faculté d’audition intérieure de Mozart. Mozart disait :
« Je veux dire qu’en imagination, je n’entends nullemment les parties les unes après les autres dans l’ordre où elles devront se suivre, je les entends toutes ensemble à la fois. Instants délicieux ! Découverte et mise en oeuvre, tout se passe en moi comme dans un beau songe, très lucide. Mais le plus beau, c’est d’entendre ainsi tout à la fois[38]. »
Très curieusement, ce texte a retenu l’attention de Heidegger[39]. Il en tire des remarques assez élémentaires sur l’unité du voir et de l’entendre. On n’y voit aucun approfondissement sur l’idée centrale de la polyphonie. La polyphonie, ce n’est pas un ordre cosmique, nous le savons assez puisque les Anciens ont pu célébrer l’ordre musical du cosmos sans pratiquer la polyphonie et en ne connaissant des accords que les notes égrenées des modes. La polyphonie ce n’est pas pour autant un simple agrégat (le « cluster » des compositeurs des années 70 ou paquet de note) car l’agrégat est un chaos sans unité, alors que la polyphonie propose une unité dans l’instant et dans le développement de la durée. Cette unité nouvelle, à la fois instantanée et discursive, est si forte qu’un homme comme Mozart pouvait la saisir en un seul instant, comme une saisie présocratique du monde : ama panta.
Il y a un lien entre la polyphonie musicale selon Mozart et l’idée leibnizienne de monde. Dieu a une vision mozartzienne du meilleur des mondes quand il prononce son fiat. Mais Leibniz ne dit pas si Dieu peut encore connaître l’autre mouvement familier de Mozart : reconstituer une partition en lisant l’une après l’autre chaque partie. C’est pourtant ce qu’a fait le compositeur après avoir entendu un motet à deux chœurs de Bach. Mozart demande à lire la partition :
« Mais on n’avait pas de partitions de ces chants ; il se fit donner les parties manuscrites, et ce fut une joie pour ceux qui l’observaient de voir avec quelle ardeur Mozart parcourut ces papiers qu’il avait autour de lui, dans les deux mains, sur les genoux, sur les chaises à côté de lui, oubliant toute autre chose et ne se levant qu’après avoir parcouru tout ce qu’on avait là de Bach. Il supplia qu’on lui en donne une copie[40] . »
Cette copie après coup figure assez bien le mouvement par lequel l’érudition infinie de Leibniz a pu un jour nous donner à lire la totalité de la Théodicée car c’est dans la suite des savoirs lus et relus, par la combinaison de toutes les disputes théologiques particulières, par le maintien coûte que coûte de l’idée d’Harmonie que finalement Leibniz a pu entendre le chœur du monde et le donner à lire aux autres : « A peine avois-je appris à entendre passablement les livres Latins, que j’eus la commodité de feuilleter dans une Bibliothèque, j’y voltigeais de livre en livre[41] … »
C’est dans cette direction, où l’art de la fugue joue évidemment un rôle déterminant, qu’il faudrait approfondir les développements incongrus de la Théodicée sur Hermann et sur Hermès, quand Leibniz expose que la gnose manichéenne est d’abord née de guerres des temps primitifs et qu’elle ne fait qu’en exprimer la signification politique. Hermann, le guerrier celte, est le symbole de ces temps reculés. A côté de lui, il y a encore place pour une autre lignée, celle de Zoroastre, de Moïse, de Mercure ou d’Odin, qui incarnent tous la sagesse universelle. A côté de la série guerrière, il y a place pour la série issue de la chaîne d’Hermès, comme il y a place encore pour la lignée scientifique et moderne dont la Théodicée elle-même est l’aboutissement. De l’un à l’autre, l’ontologie est toujours la même, celle de la force, mais la conduite est différente, toujours plus accordée aux limitations de l’autre et favorisant la variation plutôt que le heurt des petits mondes monadiques. Ainsi la violence de l’histoire, les traditions sacrées et la raison pure écrivent-elles ensemble la même histoire, sur des plans différents, depuis les basses fondamentales jusqu’aux motifs d’une mélodie continue, et contribuent à écrire, par leurs mouvements consonants qui s’enrichissent mutuellement, l’histoire du monde.
Le Sarastro-Zoroastre de la Flûte enchantée tend ici la main au Gesamtkunswerk wagnérien pour reconstituer l’histoire des origines sans omettre aucun plan, en diversifiant au contraire leurs genèses, dans la certitude d’œuvrer ainsi pour le déploiement d’un style fugato toujours plus complexe et pourtant garant de la mélodie infinie. Leibniz a d’ailleurs précisé lui-même son propre modèle polyphonique. La Théodicée donne le modèle des tuyaux d’orgue, où chaque tuyau, avec sa longueur propre, illustre un plan de la manifestation dans l’instrumentation globale[42]. Il y a aussi le modèle du chantre employé dans un chœur :
« Il suffit qu’on se figure un chantre d’Eglise ou d’opéra gagé pour y faire à certaines heures sa fonction de chanter ; et qu’il trouve à l’Eglise ou à l’opéra un livre de Musique […]. Son âme chante pour ainsi dire par mémoire […] C’est parce que toute la tablature de ce livre ou des livres qu’on suivra successivement en chantant est gravée dans son âme virtuellement dès le commencement de l’existence de l’âme ; […]. Mais l’âme ne sauroit s’en apercevoir, car cela est enveloppé dans les perceptions confuses de l’âme, qui expriment tout le détail de l’univers[43] . »
Nous autres humanistes, nous nous croyons des hommes, alors que nous ne sommes sur la terre que pour être des musiciens. Le chantre, que chacun d’entre nous sommes, est deux fois ignorant, mais c’est sa chance : il ne connaît pas les autres parties que la sienne et quand il chante sa propre existence, il ignore qu’il ne lit pas dans une partition, mais qu’il se souvient. Que fait-il d’autre en effet que lire en lui-même depuis qu’il est né ? Nous sommes, chacun d’entre nous, renfermés sur notre livre de chant et nous manquons à la fois le concert universel et le caractère éternel de la partie réciproque que nous jouons. Nous ne pouvons pas espérer dépasser cette condition oublieuse tant que nous ne disposons pas d’une pensée du tout assez complexe pour y placer notre existence dans toutes ses particularités. Mais si, persécutés par le mal et la souffrance, nous sommes élevés au-delà de nous-même et que nous parvenons à comprendre que chaque plan individuel fait mieux que poursuivre son désordre apparent au gré des circonstances, mais est appelé à une convergence qui n’est pas fusion, alors le désordre va à l’ordre, non qu’il y soit d’abord, mais il s’y meut. Le mal aura eu alors sa tâche, celle d’éveiller à la polyphonie du tout une âme singulière qui était en train de mourir de la chance de son individualité.
- ENVOLS POLYPLANAIRES
Essayons de mesurer les ouvertures qui nous sont offertes par le parti pris du continu. Le continu est le principe d’espérance des philosophes. Le continu est l’œuvre philosophique, comme la prière est l’œuvre religieuse.
Tout d’abord l’ontologie du continu nous a délivré de la tâche impossible du procès de Dieu en montrant tout simplement la vanité des plaignants. On répète trop que Leibniz est un grand juriste. S’il l’est en la circonstance, c’est par sa capacité à nous éviter un procès inutile. En ce sens, la Théodicée s’achève comme le livre de Job, par une théophanie. Comme le répète Leibniz, c’est assez de ne pas être mécontent de l’auteur de ce monde.
Mais ce ne sont pas seulement les plaignants qui sont renvoyés à leurs foyers, mais les défenseurs outrés ou pervers. Augustin, Luther, Calvin, Bossuet n’ont pas commencé à penser parce qu’ils n’ont pas su demander aux possibles la solution de leurs angoisses figées. Au détour d’une analyse du Décret absolu, Leibniz rencontre les « Rigides » et montre que leurs adversaires le sont encore davantage[44]. Mais celui qui, au contraire, place l’intelligence du monde dans les possibles, et y cherche la « source des choses[45] », est à jamais délivré de la mentalité des rigides. Les possibles introduisent à une pensée du ressort des choses, inaccessible aux théologiens dogmatiques. Ils ne manquent peut-être pas de foi, ils manquent de physique et de dynamique, ils ne mesurent pas les œuvres vives de Dieu. Ils viennent de l’ancien monde, ils n’ont pas su prendre en compte le tournant des modernes, de Copernic à Giordano Bruno :
« Les anciens avaient de petites idées des ouvrages de Dieu, et S. Augustin, faute de savoir les découvertes modernes, était bien en peine, quand il s’agissait d’excuser la prévalence du mal[46]. »
Une pensée polyphonique, « polyplanaire » pour reprendre le néologisme du musicien français Georges Migot, se donne d’autres objectifs. Chaque individu développe un mélisme propre et le monde n’est que la somme de ces plans expressifs qui s’enchevêtrent en un feuilletage infini. Rien n’est moins totalitaire que la façon dont Leibniz entreprend d’excuser Dieu : il ne sacrifie jamais la ligne de chaque détail au tout où il prend place car l’infinité des créatures ne constitue jamais à ses yeux un tout substantiel, elle ne saurait jamais se substituer à la réalité des substances particulières. C’est un gain ontologique d’une importance exceptionnelle pour le salut des singularités :
« L’infini, c’est-à-dire l’amas d’un nombre infini de substances, à proprement parler, n’est pas un tout non plus que le nombre infini lui-même, duquel on ne saurait dire s’il est pair ou impair. C’est cela même qui sert à réfuter ceux qui font du monde un Dieu, ou qui conçoivent Dieu comme l’Âme du monde, le monde ou l’Univers ne pouvait pas être considéré comme un animal ou comme une substance[47] . »
La substance individuelle ne saurait être noyée dans le tumulte du tout et la polyphonie est le principe qui fait du monde une convergence ordonnée de singularités, une résultante, jamais une substance propre. Le leibnizianisme est une pensée des points de vie et non pas un organicisme panthéiste. Son principe de vie est celui des protozoaires et procède d’eux et n’impose pas la vie cosmique comme norme d’un holisme autoritaire.
Il faudrait être Victor Hugo pour faire sentir les principes de cette évolution cosmique favorable à chacune des semences de la vie parce qu’elle en procède intégralement. La loi d’équipollence entre la cause pleine et l’effet entier (la loi générale de la composition du mouvement), qui n’admet aucune perte entre les moyens contribuant à une action et son résultat global, joue ici à plein. C’est ce qui permet à Leibniz de soutenir que l’intégralité des volontés « antécédentes » de Dieu, chacune voulant le bien des créatures, se retrouve dans sa volonté totale et entière de créer ce monde-ci, où tant de créatures sont sacrifiées :
« C’est du concours de toutes ces volontés particulières, que vient la volonté totale […]. C’est encore en ce sens qu’on peut dire que la volonté antécédente est efficace en quelque façon, et même effective avec succès[48]. »
On peut encore rattacher ces considérations à la doctrine si discutée chez Leibniz du Vinculum substantiale, cette forme qui donne l’être aux monades qu’elle rassemble. Ce nouveau lien annonce-t-il une régression totalitaire du système ? Mais il ne faut pas confondre la façon dont une monade dominante ordonne sous sa puissance d’expression des monades plus confuses et ce vinculum contractuel qui confère une actualité spécifique aux monades sans épuiser leur dynamique propre. Dans la mesure où la puissance ontologique d’un tel vinculum repose sur sa capacité, tel un miroir concave, à exprimer les monades qu’il rassemble, il est dépendant de ces êtres dont il n’épuisera jamais pour ses fins propres toute la puissance. Ainsi le vinculum susbtantiale, fût-il le corps du Christ dans l’Eucharistie, n’est que la forme mouvante qui fait travailler les monades à un même but sans se substituer jamais à leur orientation spécifique. Ce surcroît de dynamique laisse chaque monade libre de reprendre sa vie propre après l’oeuvre commune et confère une autonomie de trajectoire à chaque force au sein même de sa coopération dans l’essaim global. Le vinculum substantialen’est pas destiné à fixer la course des monades, mais à faire entrer leur puissance dans une histoire, elle-même variable, et soumise à la concurrence d’autres liens de même généralité. Car s’il y a des monades, il y a encore des vinculum, qui leur proposent d’entrer dans telle ou telle société et il appartient aux monades de suivre celui qui respecte le mieux leur puissance et deviendra proprement pour elles substantiel[49] .
Eh quoi, n’y aura-t-il plus de damnés qui auraient manqué aux lois de ces vinculum ? Même si le nombre des damnés l’emportait finalement sur le nombre des élus, cela ne retire encore rien, selon notre auteur, à la plénitude du monde car notre terre n’est qu’un recoin de l’univers. L’humanité est appelée à émigrer d’étoile en étoile, et qui sait quelles métamorphoses sont encore possibles dans l’ontologie générale de la force. Il est vrai que Leibniz ne va jamais, comme Victor Hugo, jusqu’à entrevoir le pardon de Satan. Il suffit de dire que «peu d’exemples, ou peu d’échantillons suffisent pour l’utilité que le bien retire du mal[50]. » Il suffit peut-être qu’il n’y ait qu’un seul Satan, un ange au demeurant, pour que le reste de l’humanité soit sauvée. Cela signifie-t-il autre chose qu’il suffit qu’il y ait de la privation dans la nature idéale de la créature pour épuiser le problème du mal ? Et puisque cette privation est la condition de l’existence d’un monde créé, ne suffit-il pas qu’il y ait un monde pour qu’il soit pardonné et pour en finir avec la hantise d’un mal absolu, séparé et finalement abstrait et chimérique? L’histoire de la métamorphose peut alors commencer. Si quelqu’un a fait siens tous ces principes, c’est bien Goethe :
« Chaque soleil, chaque planète porte en soi une intention plus haute, une plus haute destinée en vertu de laquelle ses développements doivent s’accomplir avec autant d’ordre et de succesion que les développements d’un rosier par la feuille, la tige, la corolle[51] . »
Le poète est prêt à nommer cette « intention » une monade, et même une « entelechische Monade », la «regierende Hautpmonas », celle qui se soumet les monades confuses et les entraîne dans son dessein de transformation. Elle est le principe de tout développement. Peu importe alors le mal, l’essentiel est seulement de ne pas s’arrêter à la larve, de ne pas hypostasier les états intermédiaires, mais de dévoiler le plan d’ensemble. Dante ne disait pas autre chose, lui qui était venu de l’enfer et conduisait l’humanité à la fleur céleste :
Non v’accorgete voi che noi siam vermi
nati a formar l’angelica farfalla
che vola alla giustizia sanza schermi ?
Di che l’animo vostro in alto galla,
poi siete quasi entomata in difetto,
sì come vermo in cui formazion falla[52]? (Purg., X, 124-129)
Goethe observe que le plus grand péril des monades, dès lors qu’elles sont déliées de la monade dominante, par exemple par la mort, est de se voir saisies au passage par une force brutale et dévoratrice :
« A une destruction complète, il n’y faut pas penser. Cependant il peut bien se faire qu’on coure le risque d’être pris au passage par quelque monade puissante et grossière en même temps, qui vous subordonne à elle. Le danger a au fond quelque chose de sérieux, et, pour ma part toutes les fois, que je me trouve sur la voie de la simple contemplation de la nature, je ne puis me défendre d’une certaine épouvante qu’il me cause. »
Dans cette angoisse de la capture, qui retrouve quelque chose de la profonde allégorie du « Roi des Aulnes » où l’enfant ne peut résister à l’appel de la mort, on retrouvera les thèmes scripturaires de la tentation mêlés à quelques rémanences de sorcellerie. Mais, délaissant ces magies où le démonisme de Goethe s’exprime à plein, entendons plutôt l’appel à la délivrance du cosmos entier lancé par Hugo, son refus de l’enfer éternel alors même qu’il invite à se pencher sur « l’égout du mal universel ». Nous ne serons pas la victime de quelque monade errante si l’univers « hagard » entre tout entier en métamorphose. Mais cette vision n’appartient plus à la Théologie, même astronomique[53], de Leibniz, elle est le fait d’un poète et suppose les épreuves du prophète pour être articulées :
Déjà, dans l’océan d’ombre que Dieu domine,
L’archipel ténébreux des bagnes s’illumine ;
Dieu, c’est le grand aimant ;
Et les globes, ouvrant leur sinistre prunelle,
Vers les immensités de l’aurore éternelle,
Se tournent lentement.
Oh ! comme vont chanter toutes les harmonies…[54]
Face à ce songe illuminé, les vérités leibniziennes sont et restent des propositions de relation, elles ne sont d’aucune manière des certitudes. S’il faut retenir quelque principe de la façon dont Leibniz concilie la raison et la foi, c’est bien dans cette découverte de la polymorphie des dogmes qui ne peuvent être réduits à l’interprétation qu’en donnent, ou en ont donnés les hommes. Nous touchons là au point de le plus fécond de la Réforme. Si la référence à l’Ecriture comme à un principe transcendant signifie qu’on peut reformuler toujours la lecture d’un texte sacré et qu’on tient dans cette audace la véritable fécondité de la révélation, alors il était nécessaire qu’une telle Réforme se produise pour que la philosophie entre en dialogue avec la foi. L’heure était venue pour qu’elle se constitue en organon de la révélation et la monadologie proposa le système des vérités sous-jacentes, fondées sur la relation, qui permettent de reconduire à des sens toujours renouvelés les structures apparentes des phénomènes naturels ou révélés.
Leibniz incarne cette loi qui veut que plus l’ontologie de départ est rigoureuse, plus sa mise en oeuvre peut être souple. Que peut-on faire de plus rigide, de plus défini, de plus fixé qu’une monade, sans porte ni fenêtre, programmée à l’infini et fermée sur ses séries ? Mais que peut-on faire de plus souple que le ballet des monades dans le monde donnant tour à tour forme aux manifestations les plus complexes de la vie et aux plus grandes réalisations des civilisations ? Il faudrait en somme concevoir l’ontologie comme un solfège et le travail du philosophe comme une libre composition symphonique. Mais cette symphonie n’appartient plus au règne de la nature. Par la rigueur de ses principes, elle appartient à l’intangible, elle est de part en part métaphysique.
En philosophie, cette dimension métaphysique n’est pas gratuite, elle est la seule à pouvoir préserver de toute déformation la spontanéité de notre « je » et sa capacité à se représenter librement ce qui l’entoure. Ainsi n’y a-t-il de définition d’un être que métaphysique. Ce n’est pas la définition d’une chose, c’est la définition d’un a priori. Ce n’est pas la définition d’un état, c’est la définition d’une force. Ce n’est pas la définition d’une conviction, c’est la définition d’une possibilité. La fréquentation de Leibniz ne peut que conduire, contre tout parti pris trop voyant en faveur du réalisme, à un éloge de l’a priori, à un éloge du pouvoir de création de la raison et de son oeuvre la plus propre, qui est de produire de l’enchaînement entre les choses. La vie livre des états, l’a priori est la somme des relations que la raison y discerne et si cette richesse d’initiative peut être quelque fois négligée dans la manipulation des faits quantitatifs, il n’y a rien de plus tragique que d’en oublier le bénéfice humain quand il s’agit de trouver les liens entre le bonheur et la souffrance, ou entre les promesses des livres saints et l’exigence des individus.
[1] Leibniz, Théodicée, éd. Gérardt, vol. VI (T), p. 29.
[2] Lettre à Burnett, du 30 octobre 1710, éd. cit., p. 9.
[3] T, p. 44.
[4] Ed. cit., p. 10-11.
[5] T, p. 45.
[6] François Rabelais, Quart livre, A mon seigneur Odet, cardinal de Chastillon : « Et avoit eu en horreur quelque mangeur de serpens, qui fondoit mortelle haeresie sus un N. mis pour un M. par la faulte et negligence des imprimeurs. », éd. Huchon « Pléiade », p. 520.
[7] T, p. 47.
[8] T, p. 48.
[9] T, § 147.
[10] Ibid.
[11] T., § 105.
[12] Cf. T, p. 45-46.
[13] T, § 20.
[14] T, § 30.
[15] Ibid.
[16] T. § 7.
[17] T, P. 40.
[18] T, p. 45.
[19] T, p. 40.
[20] T, p. 41.
[21] T., § 31.
[22] T, p. 38.
[23] T, § 100.
[24] T, § 52.
[25] T, § 8.
[26] T, § 9.
[27] « D’après cette conception, la philosopihe ne doit pas être simplement et au premier chef une science théorique, mais elle doit, dans une perspective pratique, diriger l’interprétation des choses et de leur connexion <Zusammenhang> ainsi que les prises de position <Stellungnahme> à leur égard, elle doit régler et guider l’interprétation de l’existence et de son sens. La philosophie est sagesse pour le monde et pour la vie ou encore, selon une expression aujourd’hui courante, la philosophie doit surtout fournier une ‘vision du monde’. », Les problèmes fondamentaux de la phénoménologie, trad. fr., p. 20. On notera cette opposition fondamentalement anti-platonicienne entre la théoria et les traditions sapientiales.
[28] T, D1
[29] T, D, 63.
[30] T, p. 44. Par ce lien établi entre la présence et l’absence, le leibnizianisme ne peut que déborder le culte psychanalytique du manque.
[31] T, § 20.
[32] T, § 22.
[33] T, § 10.
[34] T, § 66.
[35] T, § 105.
[36] T, § 245.
[37] T, § 241.
[38] Cité, in Philippe Sollers, Mystérieux Mozart, Paris, 2001, 2003, Folio, p. 63.
[39] Martin Heidegger, Le principe de raison, chapitre IX.
[40] Cité in op. cit., p. 251.
[41] T, p. 43.
[42] T, § 246.
[43] Réponse à Bayle, G. IV, p. 549-550 ; cf. p. 564.
[44] T, Réflexions sur l’ouvrage que M. Hobbes a publié en Anglais, § 7.
[45] T, § 417.
[46] T, § 19.
[47] T, § 196.
[48] T, § 22.
[49] Si l’on admet l’équivalence que j’ai proposée ailleurs entre mythe et vinculum substantiale, on peut suggérer qu’à côté de la Théodicée, il y a encore place pour une Mythodicée, ou théorie du meilleur des mythes possibles. Une telle Mythodicée donnerait accès à une nouvelle évaluation des rapports humains dans une société libre. Si les sociétés se sont constituées à partir de liens naturels, dont la première description rigoureuse est celle d’Aristote dans ses Politiques (avec la légitimation de l’esclavage qui lui est associée), pour la Mythodicée l’individu n’est plus défini par un enracinement humain fixé selon des lois de nature, mais est appelé à entrer dans des agrégats successifs, toujours en variation selon des règles d’expression formalisées (les signes transmis, les rites appris, les institutions valorisées), participant cependant, quoique d’une façon singulière, à la République universelle des esprits. Une Mythodicée ainsi socialisée
1) préserve l’absolue singularité de chaque monde individuel
2) garantit pour ces singularités une ouverture illimitée à tout mode de composition sous des ensembles munis de lois
3) révèle que la rupture des modèles aristotéliciens ne conduit pas au pur et simple chaos, mais à un ensemble de convivialités évolutives qui transforment en variations de limitations le conflit des forces
4) devient ainsi l’horizon des pratiques démocratiques et de leur déploiement politique et technique
5) propose enfin, au-delà de l’impossibilité proclamée du rapport réciproque avec autrui, l’hypothèse d’une relation interhumaine généralisée constituée comme bruit de fond depuis lequel se redéfinit tout affrontement duel entre des symptômes singuliers.
[50] T, § 19.
[51] Goethe, Lettre à Zelter, de 1827, in Briefwechsel, T. IV, S. 278.
[52] <Ne vous apercevez vous pas que nous sommes des larves/ nées pour former le papillon angélique/qui vole à la justice sans masques ?/ Qu’est-ce qui fait que votre esprit se gonfle et se pousse / Et que vous soyez ensuite quasiment des insectes manqués, comme des larves dont la métamorphose avorte ?>
[53] T, § 18.
[54] Victor Hugo, Les Contemplations, « Ce que dit la bouche d’ombre », in fine.
Extrait de Bruno Pinchard, Philosophie à outrance. Cinq essais de métaphysique contemporaine, E.M.E., 2010.