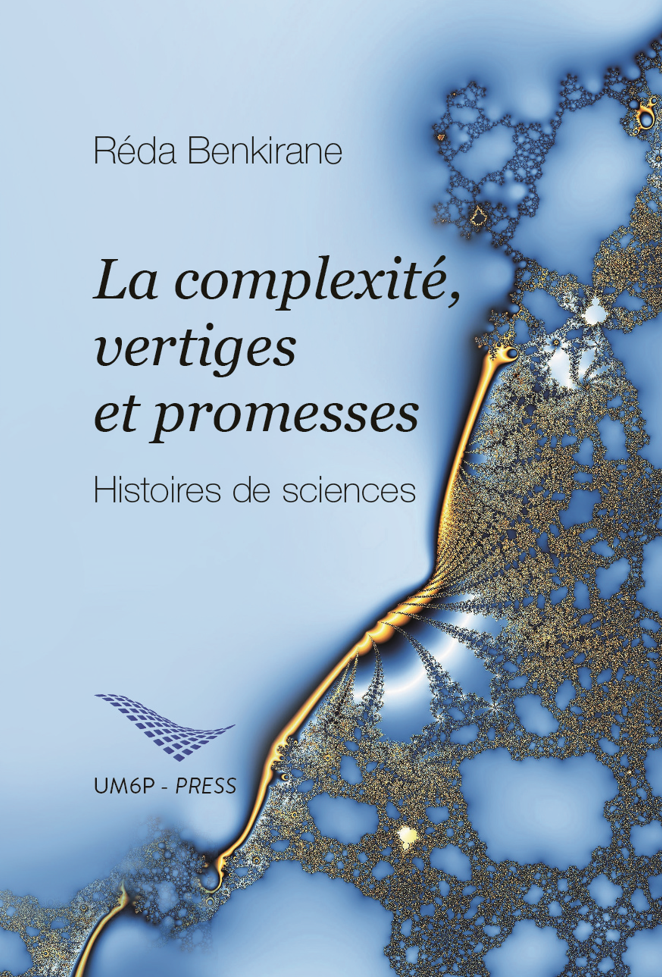SCIENCE
Individuellement, les insectes sont bêtes
collectivement, ils sont intelligents…
par Jean-Louis Deneubourg
Jean-Louis Deneubourg, chimiste et biologiste, professeur à l’Université Libre de Bruxelles, dirige une équipe de recherche sur les phénomènes collectifs des sociétés animales et des systèmes artificiels. Auteur de très nombreux articles scientifiques, il a édité également, avec Jacques Pasteels, From individual to collective behaviour (Bâle, Birkhauser, 1987).
 Les fourmis et autres insectes sociaux occupent une place de choix dans notre imaginaire. La complexité de leurs comportements et de leurs réalisations nous fascinent. Et l’analogie que nous croyons relever entre leurs activités et les nôtres (ces insectes chassent « comme nous », se défendent « comme nous », élèvent d’autres espèces animales « comme nous ») nous fait interpréter de manière anthropomorphique le fonctionnement de leurs sociétés, et parfois même attribuer une valeur morale à leurs comportements.
Les fourmis et autres insectes sociaux occupent une place de choix dans notre imaginaire. La complexité de leurs comportements et de leurs réalisations nous fascinent. Et l’analogie que nous croyons relever entre leurs activités et les nôtres (ces insectes chassent « comme nous », se défendent « comme nous », élèvent d’autres espèces animales « comme nous ») nous fait interpréter de manière anthropomorphique le fonctionnement de leurs sociétés, et parfois même attribuer une valeur morale à leurs comportements.
C’est ainsi que nous parlons de la société des fourmis comme s’il s’agissait d’une société humaine hiérarchisée, où un individu, qui aurait accès à un maximum d’informations, distribuerait ses ordres à ses congénères. Cette analogie exprime l’idée répandue, mais fausse, que la complexité des réalisations d’une société ne peut trouver son origine que dans la complexité des individus qui la composent.
La réalité est tout autre. Prenons l’exemple des structures (nids, pièges, réseaux de communication) produites par différentes espèces animales. Elles prouveraient, dit-on, l’existence d’une « intelligence animale ». Or, la recherche montre qu’il n’y a pas de corrélation entre la complexité des structures produites et les capacités cérébrales de l’espèce considérée. C’est ainsi qu’à une exception près, les primates, comme beaucoup d’autres mammifères, sont de piètres constructeurs. Alors que les arthropodes (crustacés, insectes, arachnides), animaux aux capacités psychiques pourtant limitées, produisent des structures extrêmement impressionnantes par leur taille, leur diversité, leur régularité ou encore leur autonomie. Le summum étant atteint par les structures construites par les insectes sociaux: abeilles, fourmis, guêpes, termites et autres araignées sociales.
Les structures collectives les plus spectaculaires sont sans doute celles construites par les supercolonies de fourmis des bois, longuement étudiées par Daniel Cherix: les structures que l’on trouve dans le Jura suisse atteignent parfois des dimensions impressionnantes, 100 km de pistes et 1200 nids sur une surface de 70 hectares par exemple.
Par ailleurs, les sociétés d’insectes nous proposent un modèle de fonctionnement bien différent du modèle humain: un modèle décentralisé, fondé sur la coopération d’unités autonomes au comportement relativement simple et probabiliste, qui sont distribuées dans l’environnement et ne disposent que d’informations locales (je veux dire par là qu’elles ne disposent d’aucune représentation ou connaissance explicite de la structure globale qu’elles ont à produire ou dans laquelle elles évoluent, bref, qu’elles n’ont pas de plan).
Les insectes possèdent un équipement sensoriel qui leur permet de répondre aux stimulations: celles qui sont émises par leurs congénères et celles qui proviennent de leur environnement. Ces stimulations n’équivalent évidemment pas à des mots ou à des signes ayant valeur symbolique. Leur signification dépend de leur intensité et du contexte dans lequel elles sont émises; elles sont simplement attractives ou répulsives, inhibitrices ou activatrices.
Dans les sociétés d’insectes, le « projet » global n’est donc pas programmé explicitement chez les individus, mais émerge de l’enchaînement d’un grand nombre d’interactions élémentaires entre individus, ou entre individus et environnement. Il y a en fait intelligence collective construite à partir de nombreuses simplicités individuelles. Quelques exemples permettront de mieux comprendre cette impressionnante différence entre la simplicité des règles individuelles et la complexité des réponses collectives.
Dans les sociétés d’insectes, mais pas seulement chez elles, les communications entre individus ont souvent un caractère amplifiant: lorsqu’un individu est actif en un endroit, il stimule ses congénères à se comporter de la même manière que lui. Ce type de communication, qui conduit la colonie d’insectes à focaliser l’activité de ses membres et à donc à réaliser une tâche rapidement, est un élément clef dans la prise de décisions collectives.
Le recrutement alimentaire, que j’ai longuement étudié avec Jacques Pasteels, donne un exemple simple de ce processus. Chez les abeilles, il se pratique par l’intermédiaire des fameuses danses décrites par Karl von Frisch, il y a trois quarts de siècle. Chez la plupart des espèces de fourmis, il se pratique par l’intermédiaire d’une piste chimique. Cela se passe, schématiquement, de la manière suivante: un « éclaireur », qui découvre par hasard une source de nourriture, rentre au nid en traçant une piste chimique. Cette piste stimule les ouvrières à sortir du nid et les guide jusqu’à la source de nourriture. Après s’y être alimentées, les fourmis ainsi recrutées rentrent au nid en renforçant à leur tour la piste chimique. Cette communication attire vers la source de nourriture une population de plus en plus nombreuse. Un individu qui découvre une source de nourriture y « attire » en quelques minutes n congénères (par exemple 5); chacun de ceux-ci y attirent à leur tour n congénères (25), et ainsi de suite. La population à la source ne grandira pas indéfiniment, mais se stabilisera autour d’une valeur déterminée par le nombre d’individus disponibles dans la colonie, par le temps qu’ils passent à la source, etc.
Que se passe-t-il, cependant, si la société de fourmis est confrontée à un choix, comme la découverte simultanée de deux sources de nourriture?
Considérons le cas où les deux sources sont de richesse différente. La situation est facile à produire en laboratoire; il suffit de disposer sur le territoire de la colonie deux sources d’eau sucrée, de même dimension, mais de concentrations en sucre différentes. Au début, les deux sources seront exploitées de manière plus ou moins égale. Mais, assez rapidement, l’énorme majorité des fourmis se retrouveront sur la piste conduisant à la source la plus riche.
Comment la colonie a-t-elle réalisé ce choix collectif? Certains de ses membres auraient-ils acquis une connaissance globale du problème d’approvisionnement de la colonie et donc la capacité de diriger leurs congénères vers le site le plus rémunérateur? Il n’en est rien. Aucune fourmi n’est informée des choix existants, aucune fourmi-chef ne dirige les opérations. Le choix résulte simplement de la compétition de deux informations, à savoir les deux pistes qui mènent aux sources de nourriture.
Ces pistes sont en compétition dans la mesure où elles puisent au même stock: les fourmis qui sortent du nid. Toute fourmi attirée par une piste renforce cette piste, et renforce par conséquent son attrait. Le choix systématique de la source la plus riche s’explique aisément par le fait, démontré, que les fourmis marquent plus la piste lorsqu’elles se sont approvisionnées à une source plus riche en nutriment. La piste qui conduit à la source la plus riche se renforce plus rapidement et devient donc plus attrayante. Au niveau de la société des fourmis, il y a donc bien un choix collectif, construit avec des individus ne disposant que d’informations locales, mais interagissant fortement les uns avec les autres.
Cette capacité collective peut cependant se faire piéger et conduire la société à des choix qui, en termes énergétiques, ne sont pas les meilleurs. Ainsi par exemple, lorsqu’une colonie de fourmis découvre une source de nourriture et se met à l’exploiter, son inertie fera qu’en cas de découverte ultérieure d’une source plus intéressante, elle restera prisonnière de son premier choix, incapable de redéployer son activité.
Scott Camazine, de l’Université de Cornell, et ses collaborateurs, ont mis en évidence des phénomènes similaires de choix collectifs chez les abeilles. A cette différence près que les abeilles sont toujours capables de sélectionner la source la plus riche, quelle que soit la séquence de leurs découvertes. On ne peut pour autant conclure que les abeilles sont plus performantes que les fourmis. En effet, l’analyse « coût-bénéfice » de tels phénomènes ne doit pas seulement prendre en compte le bénéfice énergétique immédiat, mais plusieurs autres paramètres, les besoins de défense de la colonie par exemple [à propos de l’analyse coût-bénéfice réalisée par les insectes, on lira, dans « Le Temps stratégique » No 53, de septembre 1993, « Financiers de haut vol, bourdons domestiques, mêmes réflexes! », par Leslie A. Real].
Des logiques comparables jouent dans plusieurs autres situations. Pour rester dans le cadre du recrutement alimentaire, je citerai la capacité qu’ont les fourmis de sélectionner le chemin le plus court entre une source de nourriture et leur nid. Le jeu entre les caractéristiques de dépôt de signaux, la distance à parcourir et le rôle d’une mémoire directionnelle, permet à la colonie de sélectionner le chemin le plus direct, sans avoir à faire appel à une représentation globale du milieu dans lequel les membres individuels de la colonie évoluent.
Un dernier point mérite discussion: lorsqu’un insecte a fait une découverte, comment peut-il moduler sa communication de manière que le comportement collectif de la colonie soit efficace? L’éclaireur doit-il être capable de « mesurer » précisément les caractéristiques de sa découverte ou peut-il se fonder sur quelques paramètres qui résument à eux seuls toutes les qualités de cette découverte? Si l’insecte a découvert une source de nourriture sucrée, la réponse est relativement simple: il suffit qu’il soit capable de mesurer les concentrations en sucre. Mais dans bon nombre de situations, la réponse à la question « que mesurer? » est loin d’être aussi simple. Ce qu’illustre bien le problème du transport coopératif.
Une fourmi est parfaitement capable de transporter seule une petite proie. Mais certaines proies, pas nécessairement de grande taille, résistent au transport individuel, qu’elles se débattent activement ou soient bloquées par des obstacles physiques. Comment la colonie va-t-elle résoudre ce problème?
Une expérimentation, menée notamment par Claire Detrain, a montré que la fourmi ne mesure pas la taille ou le poids de sa proie, mais se fonde simplement sur la résistance de celle-ci à la traction. Une proie qui résiste (activement ou passivement) stimule la fourmi à recruter un certain nombre de ses congénères. A quoi s’ajoute, semble-t-il, une tendance de la fourmi à répéter celui de ses mouvement qui a été couronné de succès: si elle réussit à déplacer sa proie dans une direction, elle poursuit dans la même direction; si elle échoue dans une direction, elle essaie dans une autre direction; il peut même arriver qu’en dernier ressort elle abandonne momentanément sa proie pour recruter des congénères.
L’enchaînement de ces mécanismes suffit à expliquer les réactions de la colonie face à des proies de tailles différentes. Une petite proie détermine un transport individuel. Une proie intransportable par un individu seul détermine un recrutement, qui cesse lorsque le groupe recruté est suffisamment nombreux pour le transport. Ces mécanismes assurent que le nombre d’individus recrutés est égal au nombre minimum d’individus nécessaires à la mission.
Ces deux exemples – le recrutement alimentaire et le recrutement pour transport collectif – mettent en évidence la manière dont une colonie d’insectes est capable, grâce à des communications amplifiantes mais modulées, de réagir avec une efficacité qui dépasse de loin l’échelle et les capacités des individus qui la constituent. Les décisions collectives qui émergent sont le résultat de découvertes individuelles aléatoires et d’une compétition entre informations plus ou moins précises. La robustesse et la simplicité d’une telle procédure justifie sans doute la fréquence de son utilisation par le monde animal.
Les insectes ne font pas une analyse préalable de la situation, suivie d’un échange d’informations destiné à résoudre le problème. L’existence de quelques règles comportementales « entraînent » simplement la solution, sans qu’il y ait élaboration de stratégie. Chez les insectes, la décision n’est pas séparée de l’action.
Les exemples que j’ai mentionnés concernaient l’approvisionnement du nid. D’autres tâches collectives obéissent cependant à la même logique: la construction du nid, la distribution, au sein de la société, du couvain [les amas d’œufs] et des réserves, etc. J’ai parlé essentiellement des fourmis, un peu des abeilles, mais j’aurais pu évoquer aussi les termites et leurs capacités remarquables de construction et d’organisation de la récolte, mises en évidences par Reinhard Leuthold.
Je ne veux pas suggérer par là que le registre comportemental des insectes sociaux est simple, voire simpliste. Ce que j’essaie de mettre en évidence est que l’obtention de comportements collectifs très variés et très élaborés n’exige pas toujours de faire appel à des comportements individuels très variés ou très élaborés. Le hasard, plus des individus et des événements nombreux obéissant à quelques règles simples de caractère autocatalytique, suffisent souvent à organiser les sociétés d’insectes.
Les exemples que j’ai discutés ici font peu appel aux capacités individuelles de mémoire et d’orientation, remarquables chez certaines espèces, comme l’a montré Rüdiger Wehner, de l’Université de Zurich. Wehner a également montré comment une colonie pouvait s’organiser efficacement par le jeu de la mémoire et de l’oubli. Mais quelle que soit la complexité individuelle, on retrouve toujours la dualité entre les niveaux individuel et collectif, et l’émergence « anonyme » d’une organisation collective.
Les problèmes qu’ont à résoudre les société d’insectes ressemblent beaucoup aux problèmes d’organisation d’une usine, d’un réseau de communication ou d’un chantier. Mais si les questions posées se ressemblent, les réponses diffèrent. L’ingénieur privilégie toujours le recours à une unité centrale omnisciente chargée de prendre toutes les décisions. Considérez une flotte de véhicules transporteurs, robotisés ou non. Le plus souvent ils obéissent totalement à un petit dieu qui attribue les chargements, définit leur destination, prescrit les chemins à emprunter, bref, qui sait tout et décide de tout.
On s’est évidemment demandé s’il était possible de transférer le modèle « fourmi » d’intelligence collective à des systèmes technologiques, et à quoi cela ressemblerait.
Je me limiterai à évoquer ici un système technologique robotisé composé d’un nombre plus ou moins important d’unités, qui n’ont accès, individuellement, qu’à de l’information locale. Chaque robot dispose d’un équipement sensoriel et de communications relativement simple lui permettant de réagir aux signaux émis par ses congénères et aux signaux provenant du reste de son environnement. Les signaux ne sont pas codés. Seule leur intensité est exploitée pour provoquer des réactions. Si, chez les fourmis, les signaux sont essentiellement chimiques, chez les automates, il sont sonores et infra-rouges.
La solution globale du problème posé à ces robots n’est pas programmée explicitement. Elle émergera donc, comme chez les fourmis, d’un grand nombre d’interactions. En pratique, dans les expériences conduites avec les robots, on considère qu’ils ont trouvé la solution recherchée lorsqu’ils réussissent à se regrouper, se réorganiser spatialement, d’une certaine manière.
On constate, il est vrai, que les solutions de réorganisation spatiale émergeant de l’intelligence collective des robots sont moins efficaces que ne l’eussent été des solutions explicites générées dans une situation d’information parfaite — on ne peut faire mieux que Dieu… mais encore faut-il être Dieu. Elles exigent, en revanche, de la part de chaque robot individuel, des performances moindres. On en peut déduire que l’intelligence collective donne de bons résultats même si l’environnement est très changeant, ou si certains individus commettent de grosses erreurs.
Cette « socialisation » de robots simples et bon marché à travers des communications rudimentaires devrait permettre de développer des outils opérationnels collectifs capables de remplacer avantageusement certains robots complexes et coûteux.
Les robots sociaux pourraient intervenir par exemple là où un ensemble de véhicules se déplaçant dans un milieu hétérogène et imprévisible doivent se coordonner pour collecter de l’information cartographique, scientifique, de sécurité et de surveillance, ou assembler des objets.
On commence par définir le problème qu’ils auront mission de résoudre collectivement, puis l’on fixe la manière dont les robots vont communiquer et les règles de comportement auxquelles ils doivent obéir.
Les véhicules sont alors en mesure de résoudre le problème posé au travers de leurs communications et de leurs interactions avec l’environnement. En pratique, ils vont s’organiser spatialement de manière à explorer efficacement leur milieu. La figure x montre l’organisation en réseau d’un groupe de robots de surveillance, obtenue à partir de règles élémentaires d’attraction et de répulsion entre robots. Personne n’a pour les robots un plan global, et personne n’a donné aux robots des instructions explicites de positionnement.
On a vu plus haut que les sociétés d’insectes consacrent beaucoup d’efforts à assembler et trier des objets sur la base de mécanismes d’amplification: une fourmi dépose un cadavre près d’un autre cadavre, une larve près d’une autre larve, et ainsi de suite. Les robots sociaux peuvent, aujourd’hui déjà, mimer de telles activités. La figure xx montre précisément un groupe de robots occupés à rassembler des objets sur la base de mécanismes amplificateurs: grossièrement parlant, le robot est encouragé à abandonner près d’un tas existant les objets qu’il porte ou qu’il pousse. De telles expériences ont été notamment développées et réalisées par Jean-Daniel Nicoud [dont on lira, dans « Le Temps stratégique » No 52, de juin 1993, « Les ingénieurs se mettent à la logique floue »], Francesco Mondada et Philippe Gaussier, à l’École Polytechnique de Lausanne.
Je n’ai parlé, jusqu’à présent, que de robots mobiles. Mais les robots fixes peuvent également générer de l’intelligence collective. On peut en faire la démonstration dans le domaine particulièrement prometteur de la domotique [du latin domus, ensemble des techniques et études tendant à intégrer à l’habitat tous les automatismes en matière de sécurité, de gestion, d’énergie, de communication, etc.] Il suffit en effet de considérer les régulations thermique, chimique, etc., dont sont capables les insectes sociaux (les termites en particulier), pour conclure qu’ils ont découvert la domotique bien avant nous!
Leurs solutions sont cependant différentes des nôtres. Ils décentralisent en effet beaucoup, ce qui, à ce stade de l’article, ne saurait surprendre le lecteur, et exploitent au maximum les caractères physiques et chimiques des phénomènes, dont les variations sont perçues comme autant de communications.
Les bâtiments modernes construits par l’homme comptent de plus en plus d’unités de mesure (de la température, de l’humidité, de la sécurité, etc.) et d’action (pour la ventilation, le chauffage, etc.). La question de leur gestion et de leur coordination se pose donc de façon désormais aiguë.
L’étude des sociétés d’insectes suggère que si ces unités échangeaient des informations entre elles, elles seraient capables de générer des comportements collectifs intelligents, avec une robustesse et une souplesse d’utilisation inaccessibles aux systèmes de contrôle classiques centralisés. Ces caractéristiques seraient particulièrement intéressantes lorsque l’on équipe de manière temporaire des bâtiments voués à une éventuelle destruction.
J’ignore si les idées exposées dans cet article auront un avenir. Le fait qu’elles correspondent à des solutions proposées par la nature ne saurait garantir leur succès. Malgré les tentatives et les rêves des constructeurs des premières machines volantes, il y a aujourd’hui beaucoup plus d’engins à ailes fixes que d’ornithoptères mimant le vol des oiseaux! Les solutions retenues par un système vivant ne valent en effet que pour un ensemble de contraintes et de paramètres qui ne sont pas forcément universels.
Mais c’est bien parce que notre savoir scientifique et technologique reste limité, que nous devons ne laisser aucune piste inexplorée, et ne négliger aucune source de connaissances ou d’inspiration.
© Le Temps stratégique, No 65, Genève, Septembre 1995.
De deux noms cités
Daniel Cherix (1950)
Biologiste-entomologiste, conservateur du Musée d’histoire naturelle de Lausanne, Daniel Cherix est spécialiste des fourmis et plus particulièrement des fourmis des bois. Il mène notamment des recherches sur une colonie de fourmis des bois du Jura, où 200 à 300 millions d’insectes, réunis en 1200 fourmilières reliées entre elles par un réseau de pistes, ont colonisé 70 hectares de forêt. Daniel Cherix estime probable qu’il y ait des fourmilières organisatrices et des fourmilières « filles ». Il est l’auteur de très nombreuses publications, dontLes fourmis des bois ou fourmis rousses (Lausanne, Payot, 1986).
Karl von Frisch (1886-1982)
Zoologiste allemand, Karl von Frisch est connu pour ses travaux sur les modes de communication des abeilles. Il étudia notamment le rythme et la direction de leur vol qu’il appela « danse des abeilles », et reçut le prix Nobel de médecine en 1973. Karl von Frisch est l’auteur de Vie et Moeurs des Abeilles (1955).
The Ants, par Bert Hölldobler et Edouard Wilson. Berlin, Springer Verlag, 1990.
L’organisation sociale des fourmis, par Luc Passera. Toulouse, Privat, 1984.
From Perception to Action. Par J.D. Nicoud et Ph. Gossier (éds). Los Alamitos, IEEE Computer Society, 1994.
La vie des termites sociaux: abeilles, fourmis, termites, par Daniel Lebrun. Rennes, Ouest-France, 1991.
A citer également l’émission de télévision « Télescope », Robots en quête d’intelligence, réalisée par Ventura Samarra, Sam Jarrel et Jean-Marcel Schorderet, et diffusée par la Télévision suisse romande le 14 septembre 1994.