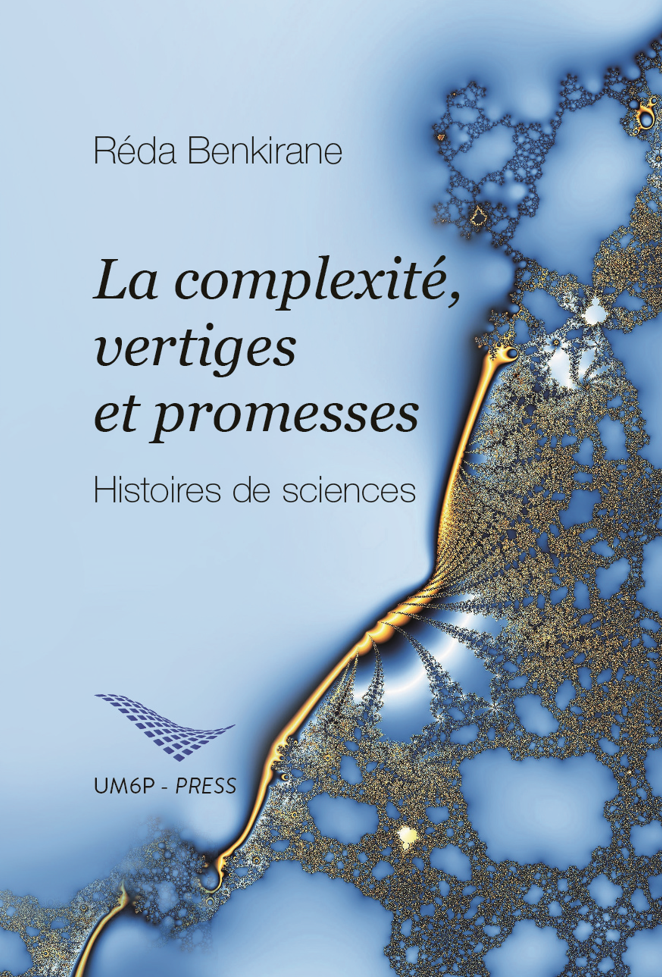PROGRAMMES
Télévision
la fin de la magie
Par Alain Le Diberder
-et modeste peut-être, sait-on jamais
Alain Le Diberder est directeur des nouveaux programmes de Canal +, à Paris.
 L’histoire de la prochaine décennie de télévision pourrait être dominée par un malentendu et aboutir à un divorce. Le malentendu porte sur ce que l’on entend par télévision. Est-ce l’ensemble des programmes regardés sur un téléviseur? Ou bien ce que proposent les chaînes de télévisions? C’est de moins en moins la même chose.
L’histoire de la prochaine décennie de télévision pourrait être dominée par un malentendu et aboutir à un divorce. Le malentendu porte sur ce que l’on entend par télévision. Est-ce l’ensemble des programmes regardés sur un téléviseur? Ou bien ce que proposent les chaînes de télévisions? C’est de moins en moins la même chose.
L’écart a commencé à se creuser avec les magnétoscopes. Les enfants en font un usage considérable, désapprenant ce que leurs parents avaient appris en plus d’une génération, à savoir à attendre patiemment les émissions de leur goût en regardant des « interludes ». Les enfants, bouche bée, peuvent regarder une cassette de Walt Disney vingt fois – autant de pris sur le flux désespérément fugitif que leur proposent les programmateurs de télé. Et ils n’accordent qu’une attention discrète à la liturgie télévisuelle: programmes, horaires, canapé. Dès leur premier babil, ils regardent leur télévision-animal domestique couchés, télécommande en main. A l’avenir, la télévision sera leur; elle devra leur obéir bien plus qu’elle n’obéissait à leurs parents.
Ces derniers, d’ailleurs, ont appris eux aussi à violer leur téléviseur, ce sanctuaire de la parole et de l’image venues de loin. Ils y diffusent désormais de la télévision familiale enregistrée au camescope: mariages, fêtes, voyages lointains, à laquelle la « vraie » télévision rend hommage à travers ses « home video shows » et autres « vidéo-gags ». Ils s’y amusent avec des jeux vidéo, relégués souvent, il est vrai, au deuxième poste trônant dans la chambre des enfants. Ils s’y informent à volonté, grâce au télétexte, cet ancêtre de vingt ans. Sans rien dire du CD-I (compact-disc interactif), console à usage universel qui leur permet de visionner des films, de consulter des encyclopédies ou de jouer à des jeux vidéo, mis à leur disposition depuis deux ans par Philips. Ni du Photo-CD de Kodak, un lecteur de photos numériques qui s’empare, lui aussi, de leur téléviseur.
Ces nouveaux usages ne pèsent pas grand chose pour le moment, quelques pour cents au total, rien de grave face aux trois heures quotidiennes que chacun de nous consacre en moyenne à regarder la télé. Mais les choses importantes ne commencent-elles pas par être des épiphénomènes, avant de renverser l’ordre établi?
Le regard découvre, aujourd’hui encore, une accumulation rassurante de permanences. L’audience de la télévision en Europe, qui avait crû fortement au cours des années quatre-vingt, est en train de se stabiliser. Il y a bien, ici ou là, des fluctuations locales, mais elles ne sont que tempêtes dans un verre d’eau: c’est ainsi, par exemple, que l’arrêt de la 5, en France, a commencé par provoquer une baisse d’audience, qui s’est résorbée cependant une dizaine de mois plus tard; quant aux pays qui se sont ouverts récemment à la concurrence – l’Espagne, la Scandinavie, les pays de l’Est – ils connaissent aujourd’hui un rattrapage. Au total, cependant, la moyenne européenne est plutôt stable.
Cette audience est gouvernée, elle aussi, par des permanences. L’information, la fiction américaine et le football sont, un peu partout, et depuis des décennies, ses programmes-phares. Certes, dans de nombreux pays, lorsqu’une bonne fiction locale est proposée, elle retient davantage l’attention qu’un produit d’Hollywood. Mais la production locale est trop rare et trop chère (malgré des aides publiques) pour constituer une véritable solution de rechange. De temps en temps, une formule de variétés ou un jeu se hisse au sommet des hit-parades, mais en moyenne, le menu préféré du téléspectateur européen de 1995 ressemble fort à celui qu’il plébiscitait en 1985.
Y a-t-il des raisons pour que cela change d’ici 2005? Si ces raisons existent, elles sont difficiles à voir. Aussi les responsables de télévision, attentifs et prudents, ont-ils tendance à prolonger les courbes, à parier sur la stabilité de leur système, à le croire éternel. Ce d’autant qu’aucune des prévisions mirifiques du début des années quatre-vingt – chaînes transeuropéennes, mini-télévisions locales, audiovisuel interactif autogéré, télévidéothèque – ne s’est à ce jour réalisée.
Pourtant, même les Tartares de Buzzati ont fini par surgir du désert. En apparence, rien ne change à l’intérieur de la bulle télévisuelle: programmes inchangés, audiences inchangées. Mais peut-être est-ce la bulle elle-même qui est en train de changer.
Les téléviseurs du début des années quatre-vingt étaient des objets peu différenciés et chers. Alors que ceux de cette fin de siècle sont très hétérogènes. La taille des écrans, comprise jadis entre 36 et 67 cm, se disperse désormais entre 5 cm et 1m20. Le récepteur peut être simple ou à double fréquence d’affichage, comprendre ou non un décodeur télétexte, être au format 4/3 (classique) ou au format 16/9, être mono ou stéréo, recevoir ou non le Ni-cam.
C’est dire que le meuble standard rassemblant autour de lui toutes les couches de la société est mort, remplacé des meubles de « segments », qui vont du petit poste « designé » par Stark pour futur-jeune-cadre-qui-n’aime-pas-la-télé, jusqu’au poste sans marque, quatre fois moins cher, ou au micro-ordinateur équipé d’une carte spéciale permettant de regarder une sitcom américaine entre deux rapports tapés sur traitement de texte.
Le téléviseur est aujourd’hui en fin de cycle de vie du produit, comme disent les spécialistes du marketing. Il faut donc, pour le vendre, recourir massivement au design, à la publicité… et à la délocalisation de la fabrication dans des pays à bas salaires.
Les fabricants espèrent bien inverser cette tendance grâce au « numérique ». Dans un premier temps, la transmission des signaux de télévision sous forme numérique va requérir l’usage d’un boîtier spécial qui transformera les informations binaires en images de télévision compatibles avec les téléviseurs actuels. Rien n’interdira de transmettre aussi, par ce biais, des textes, des photos, des programmes informatiques, qui feront du téléviseur le premier récepteur multimédia domestique. Par la suite, les fabricants entendent bien intégrer le décodeur dans le poste. Si le téléviseur des années cinquante était un poste de radio avec un écran, celui de l’an 2000 sera un micro-ordinateur déguisé en télé, avec lecteurs de disquettes, mémoire de masse, imprimante et liaison au réseau téléphonique.
Mais pendant que les fabricants de téléviseurs vont vers l’informatique, les constructeurs de micro-ordinateurs, eux, découvrent la télévision. Grâce à quoi le micro-ordinateur, qui proposait hier des images sautillantes et décolorées, est capable d’afficher désormais un signal vidéo impeccable et de lire des disques laser. Il peut en outre stocker images et sons, les transformer, et même les produire.
Les consommateurs souhaiteront-ils disposer de deux « terminaux multimédia »? L’un de ces terminaux l’emportera-t-il sur l’autre? Il est trop tôt pour le dire, mais une chose est sûre: cette évolution accentuera la banalisation de la télévision, laquelle devra composer à l’avenir avec d’autres usages et d’autres traditions.
La télévision en est avertie depuis longtemps déjà. En mars 1963, Nam June Paik exposait à la galerie Parnass de Wuppertal, en Allemagne, ses « 13 distorted TV sets » [Treize téléviseurs déformés], reliés à un générateur de fréquences ou à un magnétophone, qui provoquaient sur l’écran des écritures vidéo primitives, sous forme de zébrures et de crachotis. L’intuition de Nam June Paik – le destin du téléviseur dépasse la télévision! – était géniale. En brisant pour la première fois le caractère unidirectionnel de l’émission télévisée, en réalisant le rêve alors impossible d’écrire soi-même dans le poste, il explorait déjà, au-delà de terminal passif, réceptacle d’un message délivré par une autorité centrale, les possibilités de l’écran vidéo.
Nombreux sont les professionnels de la télévision qui considèrent cette évolution positive, au prétexte que la banalisation et l’interactivité agrandiront le cercle de leurs spectateurs ou de leurs clients, élargiront la base de la démocratie, et, en réduisant à néant la fascination technique traditionnellement exercée par la télévision, feront tomber le mur qui sépare aujourd’hui encore les créateurs des téléspectateurs.
Je ne partage pas entièrement leur avis. Je crains en effet que la télévision, si elle est privée de sa magie technique, ne se dégrade vite en une forme pataude de radio.
Elle a eu pendant trente ans la chance exceptionnelle de faire figure de technologie de pointe. En 1953, à l’intérieur des rares foyers européens équipé d’un téléviseur, on voyait des installations sanitaires vétustes, un chauffage au charbon… et un téléviseur, ovni domestique dont le propriétaire mettrait un certain temps à domestiquer l’usage. La fascination qu’exerçait l’objet était totale, à la mesure de celle éprouvée par Tintin lorsqu’il découvrait, dans l’édition 1941 de « L’île noire », que le vrombissement d’avion qu’il entendait émanait de ce parallélépipède étrange: « Un appareil de télévision! » sursauta-t-il. Ou par cette vieille dame, citée par les auteurs de « La télé des allumés », qui recouvrait son poste d’un rideau pour que les gens de la télé ne la voient pas se déshabiller. En 1983 encore, la famille européenne moyenne n’avait, chez elle, aucun objet plus « high tech » que son poste, majoritairement noir-blanc, sans télécommande, qui pourtant la fascinait.
Longtemps l’écran de télévision et sa liturgie demeurèrent une norme incontestée de la modernité. Dans les années soixante, et même soixante-dix, on pouvait, pour certaines consommations populaires, exprimer l’idée de nouveauté en inscrivant simplement un slogan, une photo ou un dessin dans un cadre symbolisant le téléviseur. Un nettoyeur à sec affichait sa modernité en inscrivant « Pressing 2000 » dans le fameux rectangle aux côtés bombés, et un coiffeur son dynamisme en proposant dans la même géométrie sa « coupe de l’homme moderne ».
Les gestes quotidiens qui entouraient le téléviseur étaient chargés d’un grand respect pour la technique: l’attente de la montée en température des lampes; les changements de chaînes, opération que l’on consentait de loin en loin, parce qu’il fallait se déplacer, tourner un gros bouton à crans ou enfoncer une touche à longue course; le branchement des régulateurs de courant, qui protégeaient parfois des parasites produits par les solex et autres mobylettes; le tout rythmé par le ballet des speakerines, des interludes, des horloges, des mires.
Les hommes de télévision profitaient largement de cette aura. Les « dispositifs de soirée électorale », les « grands événements en direct », les génériques, les spots, les clips, fonctionnaient parce que les gens étaient fascinés par la technologie. Fascination qui survécut longuement à l’arrivée des transistors, à la télécommandes et à la gestion scientifique du conducteur d’antenne – jusqu’à ce qu’il apparaisse en vérité que, les téléspectateurs étant des consommateurs, le temps d’antenne était trop précieux pour être gaspillé de la sorte.
Vint alors la micro-informatique, qui a rongé la magie de la télévision dans la tête des enfants d’abord, dans la pratique professionnelle des adultes ensuite.
Dans les pays très développés, plus d’un enfant sur deux vit dans un foyer où l’on trouve soit une console pour jeux vidéo, soit un micro-ordinateur. Aux États-Unis, les consoles sont utilisées, en moyenne, une heure et demie par jour, En France, le même niveau d’usage est atteint sans doute les mercredis, les samedis et les dimanches, un temps pris en grande partie sur celui de la télévision.
Ce détournement de l’attention des jeunes finira par décourager certains annonceurs publicitaires et pèsera donc sur les ressources à long terme de la télévision, c’est-à-dire sur la qualité de ses programmes. Mais il y a pire. Les jeunes, garçons surtout, ne préfèrent leur console que quelques années. Après quoi, ils reviennent à la télévision. Mais ils y reviennent complètement changés. Ils ne la voient plus comme leurs parents la voient. Elle leur apparaît désormais comme un jeu vidéo auquel ils n’ont pas le droit de jouer, comme une version dégradée de loisirs qu’ils avaient connus plus chatoyants. Ils ne s’y résolvent que parce qu’ils doivent se socialiser. La différence ressemble à celle entre le sport pratiqué dans un club, avec liberté de choix et matériel performant, et le sport pratiqué à l’école, standardisé, pauvre, mais que l’enfant apprécie puisqu’il lui permet de jouer avec ses copains.
On observe un détournement d’attention similaire chez la plupart des adultes occupés dans le tertiaire. Guichetiers et journalistes, golden boys et caissières, employés des chemins de fer et policiers, professeurs et chercheurs, utilisent tous un micro-ordinateur compatible IBM ou un Macintosh, et jonglent avec les souris, les menus déroulants, les icônes, les aides contextuelles. Chaque heure passée devant leur machine inscrit dans leur mémoire un univers, une liturgie, un rapport à l’écran, qui les détachent de la relation traditionnelle qu’ils avaient avec leur bon vieux téléviseur.
A l’orée du troisième millénaire, ils se sont réhabitués à une image qui assume sa platitude, sans point de fuite, sans perspective – un événement esthétique de première grandeur. Leur il s’est accoutumé à la superposition de plans déliés les uns des autres (c’est le principe des « fenêtres » de Windows et de Macintosh). Ils acceptent donc sans peine les habillages que leur propose désormais la télévision, qui eussent bien surpris un téléspectateur des années soixante: l’écran découpé en tranches, des pointeurs comme ceux des souris informatiques, des infographies pour illustrer les news, aux États-Unis en tout cas.
La pratique du micro-ordinateur leur a enseigné surtout que les images de télévision peuvent se stocker, se rappeler, se modifier, se transmettre. Ils s’irritent donc de ne point disposer des mêmes fonctions sur leur poste de télévision. Ils éprouvent le sentiment que la télévision a cessé d’être « la » chose, pour n’être plus qu’une sous-chose.
Cette sape de la télévision par l’informatique ne concerne pas qu’une mince élite. Elle est un mouvement massif et populaire, porté notamment par des millions de secrétaires et des millions d’enfants, qui disent: « Nous voulons du pouvoir sur ce qui se passe dans l’écran. » La télécommande ne leur suffit plus, ils veulent une souris, une touche F1 donnant une aide contextuelle par télétexte. Ils veulent, comme avec le CD-I, promener une flèche sur l’écran et donner leurs ordres en cliquant sur des icônes. Ils veulent qu’une partie de la surface supplémentaire de leur écran télé 16/9 soit dévolue à une barre d’icônes. Il veulent des téléviseurs disposant de plusieurs mégas de mémoire pour stocker des images. Ils veulent une interface normalisée entre leur téléviseur et leur micro-ordinateur. Toutes choses d’ores et déjà possibles, techniquement et économiquement.
D’ailleurs, les choses bougent. Deux indices: depuis 1993, les producteurs de disques américains sont de plus en plus nombreux à faire la promotion de leurs nouveautés en diffusant des clips non plus sur les chaînes de télévision, mais sur les réseaux de téléinformatique, sur Compuserve notamment; et CNN, symbole de la nouvelle télévision thématique des années quatre-vingt, a ouvert « CNN on-line », un services de débats en prolongement d’émissions, accessible par micro-ordinateurs.
Jadis, l’entreprise de télévision agençait ses programmes au sein d’une grille qu’elle diffusait sur un canal unique, sur une fréquence qu’elle était seule à utiliser. Un même terme – « la chaîne » – désignait l’entreprise, le canal et la grille. A Paris, TF1 diffusait le programme TF1 sur le canal 25, celui du bouton TF1 de la télécommande; à Rome, Mamma RAI diffusait les programmes de la RAI Uno sur le canal 1.
Mais peu à peu, ces trois niveaux se différencièrent les uns des autres et prirent leur autonomie. Une même entreprise de télévision se mit par exemple à produire plusieurs programmes: c’est, en France, le cas de TF1 qui produit aussi LCI, de France 2, qui propose France Supervision, de M6 qui offre Série Club. Certaines fréquences, c’est-à-dire, plus prosaïquement, certains boutons de la télécommande, se mirent à donner accès à des programmes différents, produits par des entreprises différentes: sur le câble, en France, par exemple, Canal J devient, en soirée, Canal Jimmy; en Grande-Bretagne où cette situation existe depuis longtemps, la « 3 » est occupée le matin par Sunrise, la journée en semaine par Carlton TV, et en fin de semaine par London Week-End. Enfin, plus spectaculaire, les programmes, que les chaînes de télévision tentaient de s’approprier symboliquement, même si elles ne les produisaient pas, se sont mis à circuler de chaînes en chaînes: les films, les séries, les retransmissions sportives et, bien sûr, les animateurs eux-mêmes.
De ce maelström ne sortent intacts que les deux extrémités de la filière télévision: le téléspectateur et ses pratiques d’un côté, le producteur de programmes de l’autre. Tout le reste se recompose selon un schéma beaucoup plus complexe que l’ancienne organisation autour des « chaînes » de télévision.
Cette désagrégation de blocs monolithiques – dont les monopoles publics, ORTF, BBC, RAI, SSR, étaient les figures extrêmes – n’est pas complètement achevée. Mais déjà l’on voit apparaître un système de blocs spécialisés, organisés en un réseau mouvant de marchés précaires: les régies publicitaires tendent à devenir indépendantes des « diffuseurs », lesquels recourent désormais à une pléiade de prestataires techniques et confient la conception de leurs programmes à des producteurs indépendants, lesquels à leur tour s’appuient sur des consultants ou commercialisent leurs droits via des distributeurs.
Cette désagrégation ne signifie pas, pour autant, la disparition de la télévision généraliste. Il y a deux raisons à cela.
La première est que l’ancien système, celui des monopoles publics en Europe, ou des networks aux États-Unis, ne disparaîtra pas d’un coup, même s’il a cessé d’avoir le vent en poupe; pendant de nombreuses années encore il restera majoritaire.
La deuxième est que même des « petites chaînes », M6 en France, Channel Four en Grande-Bretagne ou Fox aux États-Unis, peuvent offrir des programmes « de rassemblement ». Beaucoup d’observateurs estiment que le public désire, consciemment ou non, fréquenter un média de rassemblement, que ce soit pour des raisons familiales et sociales, et en déduisent que les « chaînes généralistes » dureront éternellement.
Je pense que les « chaînes généralistes » devraient être plus méfiantes. L’évolution de la radio française montre que la concurrence peut remplacer le confortable partage du marché entre compères généralistes et conduire à un éclatement des positions de marché entre une dizaine d’acteurs, qui tous peuvent se prétendre « généralistes » à leur manière: RTL, France-Inter et Europe 1 en tentant de satisfaire tous les publics le matin; NRJ en diffusant toutes les musiques que les jeunes veulent consommer; France Info en couvrant les besoins d’informations d’un public très varié. « La » radio généraliste se porte donc bien en France, mais « les » stations généralistes se portent moins bien. Les groupes de media propriétaires de ces stations ont réagi d’une manière simple: ils ont multiplié les enseignes. Le groupe Hachette a flanqué Europe 1 d’Europe 2 et, indirectement, de Skyrock; le service public a maintenu sa part de marché grâce à France Info; RMC a acheté Nostalgie; etc.
La télévision de la fin des années quatre-vingt dix connaîtra sans doute une évolution similaire, à une importante nuance près: la radio s’est mise à évoluer à cause de l’ouverture physique des réseaux, au début des années quatre-vingt, alors que la télévision doit fonctionner dans un espace hertzien restreint, avec un câble au nombre de canaux limité et une réception satellite qui, sauf en Grande-Bretagne, balbutie. Elle n’aura donc pas assez d’espace pour qu’éclatent bientôt les tendances dont elle est travaillée.
Les amateurs de permanences peuvent donc se rassurer. La télévision du début du XXIe siècle ressemblera beaucoup à la télévision d’aujourd’hui. Les grandes entreprises de 1995 y tiendront toujours le haut du pavé. L’audience globale du media n’aura pas beaucoup bougé, ni sa répartition par genres de programmes. La télévision généraliste nationale fournira toujours l’essentiel du menu des téléspectateurs. Les innovations majeures – le numérique, la télévision interactive, le multimédia – seront encore minoritaires. Sous cette enveloppe stable, cependant, l’organisation de la télévision aura entamé une mue profonde, en direction d’une télévision plus informatique, plus internationale, plus locale, plus banale, et, qui sait, plus modeste.
La folie Amérique
246 millions de téléphages
Les États-Unis comptent aujourd’hui plus de 246 millions de téléspectateurs (enfants de deux ans compris) dans 95 millions de foyers. Sur les 98 % de foyers équipés de télévision, 91 % possèdent une télécommande, 71 % ont plusieurs récepteurs et 79 % ont au moins un magnétoscope. Quelque 63 % des foyers sont abonnés au câble, la moitié pour une offre à option payante.
Ce qui différencie le plus les États-Unis de l’Europe, c’est la structure de l’offre, quelque 1400 chaînes de télévision (dont 1100 à but commercial) se partageant le marché.
Les Networks (réseaux – ABC, CBS, NBC, Fox) diffusent un minimum de 15 heures hebdomadaires en prime-time et couvrent 75% du territoire. Ils sont retransmis par 700 stations affiliées. On attend la prochaine naissance des Networks UPN (Paramount) et Warner Brothers. Les Networks sont des mines d’idées pour les programmateurs européens, puisqu’ils diffusent en premier les séries, sitcoms ou jeux qui apparaîtront quelques mois plus tard sur les écrans européens.
Les indépendants représentent 400 chaînes non fédérées.
Les superstations sont à l’origine des stations locales indépendantes qui émettent hors de leur marché de base. WTBS (Turner) et WGN (Tribune) en sont deux exemples.
Les autres chaînes sont soit publiques (comme PBS et ses 300 affiliés) ou thématiques (CNN, Nickelodeon, USA Network), payantes par abonnement ou en pay per view (option payante).
Source: Audience, no. 13, avril-juin 1995.
D’un nom et de quelques termes
Nam June Paik (1932)
Inventeur, producteur et réalisateur d’origine coréenne, Paik quitta la Corée en 1950 après des études de musique. Après une thèse sur Schönberg réalisée au Japon, il s’installa en Allemagne et entra au laboratoire de recherche du Studio de musique électronique de Radio Cologne. Connu pour ses actions spectaculaires (comme couper la cravate du compositeur John Cage en plein concert) il fut décrit à l’époque comme « ce Coréen qui emploie habituellement le jet d’oeuf, le raccourcissage de cravate, le plongeon en baignoire pleine et l’éclatement de violon ». Il prit rapidement conscience que tout le monde regarde la télévision sans agir sur elle et présenta, en 1963, une exposition de treize écrans TV montrant les déformations d’un même personnage. En 1965, il acheta sa première caméra vidéo et présenta à la fin de l’année, à New York, la première exposition d’Electronic Art. Auteur notamment de Marshall Mac Luhan Caged (1967) et de Sextronic Opéra (1967), il produisit Video Commune (1970), une émission pionnière de 4 heures en direct. Puis, le premier janvier 1984, son émission « Bonjour Monsieur Orwell » reste le premier programme conçu par un artiste et retransmis simultanément aux États-Unis, en Europe et en Corée.
Sitcom
Comédie de situation, à l’exemple de « Maguy » ou de « Tel père, tel fils ». Le sitcom est une série mettant en scène, dans un lieu unique, des sketches dans lesquels les comédiens sont aux prises avec des événements quotidiens, sur un principe d’identification du spectateur (relations avec des collègues de bureau, consommateurs dans un bistrot, famille). Cette technique de tournage, importée des États-Unis, est peu coûteuse, car elle permet de réaliser deux à trois séries différentes sur un même plateau et de rentabiliser au maximum les équipements et le personnel.
Camescope
Contraction des mots caméra et magnétoscope. Appareils vidéo destinés au grand public, les camescopes ont renvoyé le Super 8 aux oubliettes. Actuellement la bataille fait rage entre différents standards, VHS, Vidéo 8 et Beta, notamment.
CD-I
Compact Disc Interactif, le CD-I est un disque compact qui peut stocker indifféremment du texte, des images, des animations, du son ou de la vidéo. La paternité du CD-I revient à Philips et à Sony qui ont signé, en 1987, un accord sur les spécifications techniques de ce support. Le CD-I est normalement utilisable sur un lecteur raccordé à un téléviseur, mais il peut aussi s’utiliser sur un micro-ordinateur. Le CD-I fut commercialisé pour la première fois en 1991 aux États-Unis.
Photo-CD
Disque compact utilisé pour le stockage des photos, mis au point par Kodak. Le Photo-CD permet d’utiliser des photos numériques sans passer par une prise de vue spécifique, les photos étant développées puis numérisées. Le Photo-CD peut se raccorder au téléviseur ou au micro-ordinateur.
Compuserve
Serveur télématique proposant des services de messageries, d’information et d’échanges, Compuserve est l’un des serveurs les plus populaires dans le monde.
Touche F1
Sur les micro-ordinateurs PC, la touche F1 appelle la fonction d’aide des programmes.
Nicam
Le Near Instantaneous Companded Audio Multiplexed (Nicam)s est un système numérique de transmission du son développé par la BBC pour la télévision.