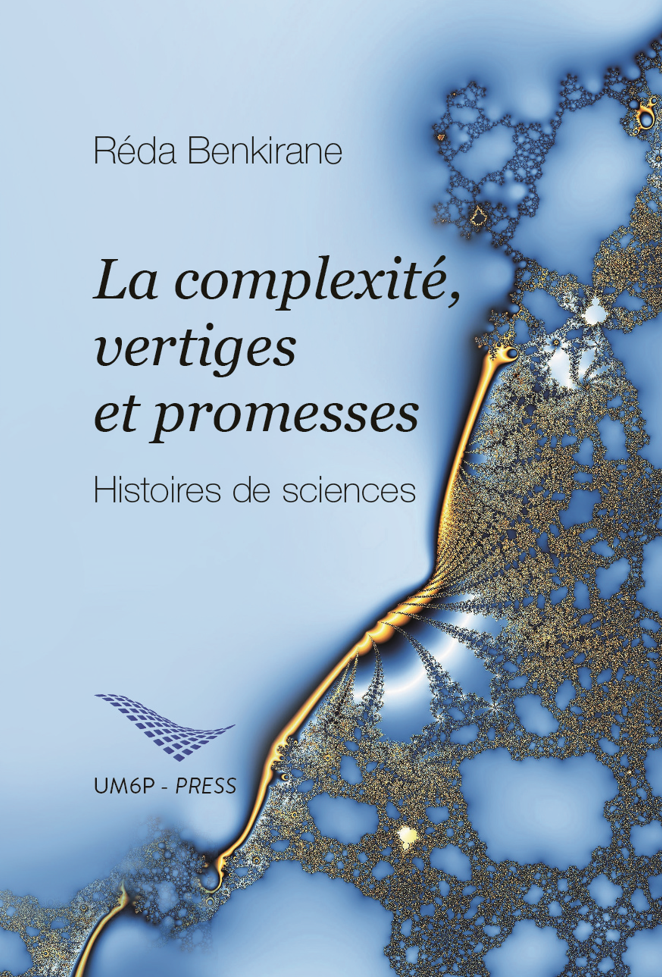GRANDE ENQUÊTE
Si nous laissons crever les télévisions
de service public, nous crèverons avec elles…
Michael Tracey, spécialiste de la télévision, a écrit de nombreux rapports à l’intention des professionnels de la communication. Il publiera prochainement The Ceremony of Innocence: Public Broadcasting and the Modern World (New York, Sage).
Les télévisions de service public connaissent aujourd’hui, partout dans le monde, de grands malheurs. Faut-il en déduire qu’elles sont condamnées, au profit absolu des télévisions privées à but commercial? Ou leur actuel déclin annonce-t-il au contraire une renaissance triomphale?
 Pour tenter de répondre à ces deux questions, mon collègue Willard Rowland de l’Université du Colorado et moi-même avons enquêté deux ans durant. Nous avons étudié sur place les télévisions publiques de plusieurs pays, nous sommes entretenus avec de très nombreux responsables de chaîne, fonctionnaires, journalistes et universitaires. Nous avons réuni des milliers de pages d’interviews, analysé de nombreux rapports officiels, lu je ne sais combien d’articles de presse et autres documents.
Pour tenter de répondre à ces deux questions, mon collègue Willard Rowland de l’Université du Colorado et moi-même avons enquêté deux ans durant. Nous avons étudié sur place les télévisions publiques de plusieurs pays, nous sommes entretenus avec de très nombreux responsables de chaîne, fonctionnaires, journalistes et universitaires. Nous avons réuni des milliers de pages d’interviews, analysé de nombreux rapports officiels, lu je ne sais combien d’articles de presse et autres documents.
Au terme de ce parcours du combattant, nous avons buté sur deux questions centrales: comment faire une télévision publique « nationale » si, comme certains signes l’annoncent, l’Etat-nation doit disparaître? Et, en fin de compte, quel type de société voulons-nous pour l’avenir? Ce ne sont pas là des questions abstraites. Notre enquête nous a montré que dans les nouvelles démocraties d’Europe centrale, comme la Pologne, la Hongrie ou la Tchécoslovaquie, le corps politique ne sait trop quel statut donner à ses télévisions nationales. Un statut « public »? Après un demi-siècle de communisme, cela sonne trop étatique, d’autant que l’Europe centrale n’a jamais connu de télévision à la fois publique et indépendante, et imagine donc mal ce qu’elle pourrait être, et qu’elle est sensible, par ailleurs, au chant suave des « sirènes du marché ».
Mais enfin, prenons notre bâton de pèlerins, et marchons.
Sur notre chemin, d’emblée, un exemple emblématique, celui de la BBC, télévision de service public jadis prestigieuse, financée par les redevances des téléspectateurs.
Dès la fin des années 1980, un vocabulaire nouveau envahit les étages de BBC Television: « coproductions », « cofinancements », « parrainages », « ventes à l’étranger » – seul manque à ce lexique du parfait commerçant le mot « publicité », laquelle est interdite à la BBC. Fallait-il voir là des méthodes innocentes pour mettre un peu de beurre sur les épinards de la BBC, ou, au contraire, les premiers signes d’un hiver mortel pour le service public?
En février 1990, la BBC annonçait qu’elle avait conclu un accord, le premier du genre, avec la Banque Lloyd, qui acceptait de parrainer l’émission « Le Jeune Musicien de l’Année » à hauteur de 1.3 millions de livres sterling. En juillet de la même année, David Waddington, alors ministre de l’Intérieur, avertit la BBC qu’elle devrait maîtriser mieux ses coûts et se débrouiller pour compléter ses revenus, produits de la redevance, laissant entendre que la redevance pourrait ne plus être indexé au coût de la vie, en d’autres termes, que les ressources publiques de la BBC pourraient décliner en valeur réelle. Le ministre fit remarquer de surcroît, histoire d’enfoncer le clou, qu’au cours des trois années précédentes les télévisions privées britanniques avaient réussi à réduire leur personnel de 15 % , alors que la BBC, en réduisant le sien de 30’000 à 27’000 personnes, n’avait « fait » que du 10 %.
C’est que le Conseil des Gouverneurs de la BBC, décidé depuis belle lurette à lui faire subir une cure d’amaigrissement, était tombé sur un bec. Il avait nommé en 1987, comme directeur-général, un comptable, Michael Checkland, dans l’espoir que celui-ci introduirait dans la maison une rigueur financière accrue, raboterait les dépenses, serrerait les contrôles, réduirait le personnel. Or Checkland, une fois en place, avait refusé d’agir avec la brutalité que l’on attendait de lui, par crainte de mettre trop à mal « la capacité de création » de la BBC. Le Conseil crut découvrir alors chez John Birt, adjoint de Checkland et homme de programme, un papable plus « réaliste », plus « pragmatique », c’est-à-dire plus disposé que son chef à manier la hache. Entre-temps, les taux d’audience de BBC Television s’étaient mis à chuter. En novembre 1991, les télévisions commerciales cartonnaient à 43 %, alors que la BBC ne faisait plus que 32.9%. Le Conseil des Gouverneurs annonça donc que Michael Checkland serait remplacé par John Birt au terme de son contrat, dix-huit mois plus tard.
La presse britannique laissa entendre aussitôt que la situation financière de la BBC la contraindrait à licencier 8000 collaborateurs supplémentaires, à fermer plusieurs studios et à privatiser plusieurs de ses activités. Des prédictions que l’avenir révéla exactes.
Cela dit, l’histoire de BBC Television, pour emblématique qu’elle soit, n’a d’intérêt que confrontée au paysage bouleversé de notre époque. La « communication » n’est pas une chose abstraite, que l’on peut isoler de son contexte social.
Or l’âge postindustriel dans lequel nous sommes paraît-il entrés ressemble curieusement aux débuts de l’âge capitaliste. Les Murdoch, Berlusconi et Malone n’ont pas inventé la poudre. Comme jadis les Carnegie, Mellon et Ford, ils parlent de marché, pas de société; de consommateurs, pas de citoyens; de désirs, pas de besoins; de quantité, pas de qualité; de prix, pas de valeur; de planète, pas de nation. Leur discours est si dominant, à l’heure actuelle, qu’on le trouve même dans la bouche des responsables de télévisions publiques, où il devrait être aussi obscène que « merde » dans la bouche d’une nonne.
Rappelons le contexte politique, social, culturel et économique de cette fin de 20e siècle.
A la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les sociétés occidentales industrialisées ont établi un ordre fondé sur des notions telles que le plein-emploi, la stabilité des monnaies, la croissance perpétuelle, la cohérence de l’Etat-nation, la stabilité internationale par la crainte d’une guerre atomique, la sécurité sociale étatique pour tous. Cet ordre supposait un consensus sur la nature de la communauté national et sur la nécessaire solidarité de ses membres.
Les syndicats, en exigeant le partage des fruits du capitalisme, ont contribué de façon importante à l’élaboration de cette éthique collective. Les partis conservateurs aussi, en acceptant, de manière bénignement paternaliste, de s’entendre avec les partis sociaux-démocrates, bénignement réformistes: la fin des idéologies a été à l’ordre du jour longtemps avant que ne fût proclamée « la fin de l’Histoire ».
Les « communicateurs », dans quoi j’inclus les télévisions et les radios de service public, porte-parole efficaces et indiscutés de cet ordre consensuel, payés sur les deniers de la collectivité, les télévisions et les radios commerciales, les journaux et les magazines, les compagnies téléphoniques enfin, ont trouvé, dans cet ordre douillet, une niche à leur goût.
Cet ordre fut cependant altéré, dès les années 1970, par des tensions nouvelles, parmi lesquelles la stagflation, les crises pétrolières, le sous-investissement, la concurrence du tiers monde, l’avidité d’une classe ouvrière s’étant découvert des goûts de luxe, et le monde économique en vint à chercher de nouveaux moyens d’assurer sa prospérité, fût-ce au risque de démanteler certaines institutions-clés, mises en place au lendemain de la guerre.
son Premier ministre, après leur effondrement conjoint de 1974. Des « gifles » qui provoquèrent chez beaucoup de gens de droite, haut placés et bien financés, la froide détermination de corriger ces « dérapages » de l’Histoire. Ainsi sont nés les mouvements reaganien et thatchérien, dont les partisans arguaient, en se fondant sur les travaux de S’est surajouté à ces changements structurels le désir de vengeance d’une droite politique humiliée. Il est difficile de dater les « tournants » qui se produisent dans l’histoire des mentalités. En l’espèce, deux moments me paraissent pourtant s’imposer: l’humiliation de l’ultra-conservateur Barry Goldwater après qu’il eut été battu aux présidentielles américaines de 1964 par le « progressiste » Lyndon B. Johnson, et l’humiliation du Parti Conservateur britannique, et d’Edward HeathMilton Friedman et de ses Walkyries de l’École de Chicago, que la crise économique et sociale des années 1970 ne tenait nullement aux contradictions structurelles du capitalisme, mais au virus du collectivisme et de l’étatisme, lâchés dans la nature depuis la fin de la guerre, qui avait fini par tuer le potentiel créatif tant des individus que du « marché ».
Ces néo-conservateurs estimaient que rien, dans l’ordre d’après-guerre, ne méritait de rester intact. Et que si les choses ne changeaient pas d’elles-mêmes, il fallait les dynamiter politiquement, en sabotant des carrières professionnelles, en bouleversant les organisations, en privilégiant le commercial, en soutenant les régimes étrangers accommodants, fussent-ils néo-fascistes ou autoritaires, en démolissant les syndicats, en multipliant enfin, dans une espèce de formidable in vitro social, une nouvelle race de bureaucrates maniaques de l’économie. Et qu’une fois ces constructions intellectuelles installées, puis sanctifiées par l’élection de gouvernements de droite, il suffirait, pour achever la contre-révolution, d’ériger en valeurs primordiales les besoins des individus-consommateurs et des entreprises.
C’est ce qui advint.
Disparurent alors, sous les décombres de l’ordre ancien, des concepts aussi enracinés que le bien public, l’intérêt collectif, la communauté, la culture générale, la citoyenneté, la nécessité de gouverner. L’idée même d’Etat-nation commença à être contestée. Il est vrai que les grandes entreprises commençaient à se trouver à l’étroit sur leurs marchés nationaux. Elles entonnèrent donc, avec une belle ferveur, des hymnes au « marché mondial » et à la « mondialisation ». Or il se trouve que, technologies nouvelles aidant, rien ne se prête mieux à la « mondialisation » et au marketing que la communication…
Le Culte du Marché conduisit en outre à ce que George Ritzer appelle la « macdonaldisation » de la société. De plus en plus d’institutions adoptèrent en effet les valeurs du géant du fast-food: l’efficacité, la vitesse d’exécution, le mise à disposition de biens et de services donnant au consommateur le sentiment qu’il « en a pour son argent », la prévisibilité, le contrôle étroit des processus, le remplacement des hommes par les machines.
Max Weber avait prédit au 19è siècle déjà que notre quête de rationalité – nous dirions aujourd’hui notre quête de mondialisation et d’efficacité à tout prix – finirait par enfermer les affaires humaines dans une « cage de fer » bureaucratique. Il n’y a évidemment aucun mal à devenir plus efficace, surtout si l’on dépense un argent public devenu rare. Le danger, et je mesure le poids de ce mot, est que la quête d’efficacité tend, l’expérience le montre, à devenir une fin en soi, et l’on finit par réorganiser non pour atteindre un objectif d’excellence, mais pour réorganiser.
Dans le même temps se produisit un formidable rétrécissement du domaine public, phénomène dont la communication moderne, parce qu’elle est profondément individualisante, destructrice du sens de ce qui est public, est largement responsable.
Lloyd Morrisett, président de la Fondation Markle, qui finance de nombreux projets liés au media, inquiet de ce que 50 % seulement des électeurs aient pris la peine de voter lors des élections présidentielles de 1988, avait décidé de lancer une étude sur la couverture de cette consultation par la télévision. Ce qui m’intéresse ici, c’est moins l’étude elle-même que la raison invoquée par Morrisett pour l’organiser: sa nostalgie d’une Amérique disparue, innocente et communautaire, qu’il espérait faire revivre grâce à la télévision. Pour illustrer son projet, il racontait ainsi les visites qu’enfant il faisait à sa cousine Mary Ellen. (Imaginez-le lisant ces lignes avec la voix d’un homme mûr, cependant que des images à la Norman Rockwell, le célèbre peintre de « l’Amérique profonde », défilent dans sa tête.)
« Les soirs d’été, lorsqu’il faisait doux, nous allions souvent à pied jusqu’au magasin de glaces de Main Street [la Grand-Rue]. C’était un endroit où l’on aimait voir et être vu, et j’étais heureux de baigner dans l’admiration que ma cousine provoquait chez les autres garçons. (…) Durant la journée, Main Street était le cur des affaires; le soir, le centre de la vie sociale. Enfant, j’étais fasciné seulement par le charme de ma cousine, le goût des laits frappés, et le sentiment de possibles aventures. Mais aujourd’hui, avec le passage des années, je me rends compte à quel point Main Street était importante pour tous ceux qui vivaient à Jerseyville, Illinois. Elle réunissait les habitants de la bourgade; lorsqu’ils venaient faire du lèche-vitrines, prendre livraison de leurs achats, ou déposer des vêtements chez le teinturier, ils s’arrêtaient et faisaient un brin de causette.(…) Mainstreet contribuait puissamment à forger un sentiment de communauté. »
Quelqu’un faisait observer récemment que si Norman Rockwell vivait encore, il se présenterait en disant: « Salut! Je suis Norman. Je peins des mensonges. » Mais qu’importe. Les souvenirs mélancoliques de Morrisett ont une valeur allégorique évidente.
Comme il le dit d’ailleurs lui-même, le rôle rassembleur de Mainstreet a commencé à décliner dès la fin de la Deuxième guerre mondiale et, « bien que souvent pleuré, il semble impossible à recréer ». Il aurait pu dire: « impossible à recréer au sens physique du terme ». Morrisett étant en effet convaincu que les gens continuent à éprouver le besoin d’une communauté, mais qu’aujourd’hui, au lieu de le concrétiser autour des pavés de Mainstreet, ils le concrétisent virtuellement: « La télévision, écrit-il, est devenue la Mainstreet de l’Amérique [moderne] ». Pour preuve, il cite les audiences énormes que la télévision américaine réunit lors des finales de baseball, ou qu’elle a réuni lors des funérailles de Kennedy, du couronnement d’Elizabeth, de la tragédie de Challenger, de la première nuit de la Guerre du Golfe.
Vivre au même moment la même expérience. Se sentir unis. Exister plus fort. Ce sont là, en effet, des indices qui suggèrent la réalité d’une communauté. J’ai des doutes cependant. Considérez les funérailles de Kennedy, qui furent, si l’on en croit l’écrivain Norman Mailer, « l’un de ces moments de l’Histoire où nous nous retrouvons ensemble dans le même lieu de douleur ». Il est, je crois, une caractéristique universelle: lorsqu’un convoi funéraire passe dans la rue, nous le regardons passer, ou nous arrêtons, en douloureux silence. Par compassion sans doute, mais surtout parce qu’il nous rappelle que nous aussi mourrons un jour. Cet instant de recueillement, loin de nous relier à la communauté, nous conduit à penser à nous-mêmes. Le monde moderne et ses nouvelles technologies de communication nous inclinent semblablement à penser à nous-même et à notre vie privée. Ils ne laissent guère de place à la culture publique et au sens de « l’autre ».
Le domaine public est le lieu où l’on prend plaisir à rencontrer des inconnus. La famille, elle, est le lieu où l’on se console des déceptions que ces inconnus nous infligent. Or la famille a été exilée au 20è siècle dans les banlieues et les HLM, décentralisée, dispersée. Depuis cet exil, elle est desservie par un réseau technologique de lignes électriques, de canalisations, de téléphones, de routes, elle est amusée et informée par une télévision centrée par définition sur l’habitat individuel. Nous avons réalisé cette dispersion avec une efficacité technique redoutable. Mais plus nous avons été efficaces et plus nous avons détruit la possibilité même d’une vie communautaire et d’une culture publique. Elmer Johnson écrit en conclusion de son essai remarquable sur la place de la voiture dans la société américaine: « L’empiétement du marché sur nos vies tend à nous rendre insensible à l’intérêt général, ce complexe de biens communs qui s’étend au-delà de nos âmes privées, au-delà de nos âmes utilitaristes. »
Les nouvelles technologies de communication aggravent encore ce tableau. Un ingénieur m’expliquait il y a peu le système de communication interactif qu’il développait quelque part en Californie: « Le signal vidéo d’une caméra située dans la maison A, s’enthousiasmait-il, peut être envoyé sur l’écran d’un poste de télévision située dans une maison B, ce qui permet aux gens de disposer de leur propre vidéophone. Grâce à ce dispositif, la grand-mère habitant à un bout de la ville pourra regarder la fête d’anniversaire de son petit-fils, organisée à l’autre bout… » J’eus envie de hurler: « Mais pourquoi la grand-mère n’a-t-elle pas été invitée? » Il en va de même avec l’usage que certains snobinards font d’Internet, avec ses communautés virtuelles, ses relations virtuelles, sa sexualité virtuelle, situées dans le monde supposément merveilleux du cyberespace [on lira à ce propos, dans « Le Temps stratégique » No 63, d’avril 1995, « Nous allons tous pouvoir nous shooter au virtuel… » par Philippe Quéau]. En nous retirant ainsi dans le royaume de notre domicile privé et de notre psyché individuelle, nous construisons un avenir dans lequel la technologie, loin de nous libérer, désocialisera notre vie et nous empêchera d’exprimer notre humanité.
On peut résumer de la manière suivante le paysage géopolitique de cette fin de siècle: libéralisation économique, mondialisation, rationalisation, déclin du domaine public, désintégration sociale, déshumanisation des relations humaines. Quels effets aura ce paysage sur le devenir de la communication en général, des télévisions de service public en particulier?
La communication en général. On ne peut à ce propos éviter de faire référence au projet d' »autoroutes de la communication », popularisé par Al Gore, vice-président des États-Unis. Comme il l’expliquait à Buenos Aires en mars 1994: « Nous disposons désormais de moyens technologiques et économiques qui nous permettent de rassembler toutes les communautés du monde. Nous pouvons créer un réseau d’information planétaire capable de transmettre des messages et des images de la plus grande ville au plus petit village de chaque continent. Le président des États-Unis et moi même sommes convaincus que la création de ce réseau de réseaux est la précondition essentielle à un développement durable qui bénéficie à tous les membres de la famille humaine. (…) Ce réseau nous permettra de partager de l’information, de nous relier entre nous, d’être enfin une communauté planétaire. Ces liens nous permettront de développer (…) des démocraties fortes (…), nous aideront à éduquer nos enfants, nous permettront d’échanger des idées à l’intérieur d’une même communauté et entre nations. Ils permettront aux familles et aux amis de transcender les barrières du temps et de l’espace. Ils permettront l’existence d’un marché planétaire de l’information, où le consommateur pourra acheter et vendre ses produits. (…) Je vois venir un nouvel Age Athénien de la démocratie… »
A première vue, bravo. Qui pourrait être contre davantage de démocratie, davantage de richesses pour tous, contre une harmonie planétaire, contre un sens accru de notre appartenance à la « famille humaine »? Je crains cependant qu’Al Gore, en liant le développement des autoroutes de l’information aux besoins des consommateurs et du marché, prépare, pour l’an 2000, quelque chose qui ressemblera plus à la galerie marchande d’Athènes (Géorgie, États-Unis) qu’au forum qui existait il y a vingt siècles à Athènes (Grèce). Ray Smith, PDG de Bell Atlantic, dont la tentative avortée de fusion avec Telecommunications Inc. avait fait rêver beaucoup de monde à la prompte concrétisation des « autoroutes de l’information », n’indiquait-il pas, en décembre 1993, que quatre « applications imparables » (four killer applications) allaient permettre de trouver les milliards de dollars nécessaires au financement du projet: les films à la demande, le télé-achat, les jeux vidéos à la demande, et la publicité permettant le télé-achat immédiat? « Les fruits sont mûrs », assurait-il (plums are ripe to be picked).
Dans le réseau de réseaux annoncé par Al Gore il y a donc deux modèles possibles: Internet, qui permet l’échange d’information, et « les autoroutes », qui ne livrent que du plaisir. D’un côté le forum civique, de l’autre le cirque.
Abordons maintenant, il est temps, la télévision.
Le paysage géopolitique de cette fin de siècle a sur elle deux types de conséquences. Il favorise en premier lieu l’avènement du « multi-chaînes », un bombardement de matière télévisée qui tend à son tour, ce n’est pas un mince paradoxe, à désinstitutionnaliser la télévision… Je m’explique.
A l’origine, la télévision, publique notamment, concentrée dans les mains de l’establishment politique, social et culturel, entretenait avec ses téléspectateurs un dialogue rationnel et de bon goût. Cela non à cause de sa vertu, mais parce qu’en ce temps-là, elle ne disposait que de très peu de longueurs d’onde pour émettre. La pénurie obligeait chacun à se restreindre, à mesurer ses propos.
Puis soudain, l’entreprise Home Box Office eut, au milieu des années 1970, l’idée de diffuser des signaux de télévision par satellite. La pénurie technologique fut remplacée par une abondance presque illimitée. Certains proclamèrent aussitôt: « Pourquoi continuer à biberonner télévisuellement les gens? La technologie leur donne désormais les moyens de choisir eux-mêmes ce qu’ils ont envie de voir sur leur petit écran. Ils peuvent enfin affirmer leur souveraineté. La même chose s’est-elle pas produite pour l’écrit, qui a explosé avec l’apparition des technologies modernes d’impression? »
La télévision multi-chaînes va, à mon sens, contribuer à démolir plus encore le sens de ce qui est public, sans lesquels, faut-il le répéter, il ne peut y avoir de service public. Mais soyons honnêtes: cette démolition n’est possible que parce que vous et moi, téléspectateurs, acceptons d’en être les complices.
L’actuelle situation géopolitique de cette fin de siècle met par ailleurs l’idée même de culture publique au défi, puisque dans une société dominée par l’idéologie de marché, ce qui compte ce ne sont pas les réflexions et les décisions qui viennent d’en haut, mais les myriade de décisions individuelles qui surgissent d’en bas. Avant que ne se développe ce Culte du Marché, l’establishment politique estimait avoir le droit et le devoir d’intervenir dans le fonctionnement de la télévision, par le biais d’institutions publiques, afin de garantir la variété, la profondeur et la qualité des programmes, et promouvoir ainsi le bien-être de tous. Mais aujourd’hui, avec un Culte du Marché exacerbé par le « multi-chaînes », une telle intervention « publique » paraît inutile et inconvenante. Il faut, dit-on, laisser le consommateur, titulaire de droits démocratiques, manifester sa souveraineté sans entrave.
Dans ces conditions, l’on comprend mieux pourquoi les télévisions publiques se sont engagées dans une course folle pour redéfinir leurs missions, se restructurer, débusquer des ressources nouvelles, revoir leur philosophie de programme, et trouver enfin une « meilleure réponse » à la question de leur positionnement dans la société: doivent-elles être haut de gamme, moyen de gamme ou bas de gamme? Élitaires ou populaires? Universelles ou enracinées dans le terreau local?
Je retiendrai ici pour rapide discussion trois thèmes centraux et récurrents: les cures d’amaigrissement imposées aujourd’hui aux télévisions publiques; les suggestions qui leur sont faites de trouver des modes de financement non publics; les efforts entrepris par certains pour les enfermer dans un ghetto ultra-élitaire.
L’amaigrissement. Les autorités de tutelle exigent des télévisons publiques qu’elles se redimensionnent et soient plus efficaces. Michael Checkland, alors directeur-général de la BBC, nous a expliqué ce que cela signifiait en pratique: « Licencier du personnel, donner des travaux à faire au dehors (…) Dans toute grande organisation, vous réévaluez sans cesse la manière dont vous gérez la maison, le nombre de gens dont vous avez réellement besoin. Aujourd’hui, à la BBC, vous entendez les gens parler partout de bi-media c’est-à-dire de fusion des départements radio et télévision traitant du même genre de sujets [l’information, les émissions religieuses, les émissions scolaires, par exemple]. Hé bien, à l’époque où je suis devenu directeur-général, personne n’aurait pensé la chose possible (…) mais aujourd’hui, où que j’aille, tout le monde réorganise. (…) Vous pouvez avoir ainsi une masse de création plus intéressante. Je ne crois pas que les valeurs que défend [la BBC] puissent être défendues par des organisations trop petites. (…) Je ne crois pas non plus que nous ayons atteint la limite de ce que nous pouvons faire. Dans les années à venir, la BBC continuera à maigrir. »
L’ennui de tels amaigrissements est que les organismes de télévision ne sont pas tous aussi obèses que Polski Telewizi y Radio avec ses 11’000 employés faisant Dieu sait quoi. Mais enfin, comme le disait Checkland, personne ne dispute la nécessité de rendre les choses plus efficaces. La vraie question est de savoir où s’arrêter pour ne pas mettre en péril les qualités intangibles mais vitales de la maison. L’une des forces de la télévision publique a toujours été sa capacité à faire éclore de nouveaux talents. Non par des mesures techniques, pointues et limitées à un département spécialisé, mais par une qualité générale d’accueil, permettant à tel scénariste, tel réalisateur, tel journaliste, de mûrir ses qualités sans précipitation excessive. Or les télévisions publiques sont en train de perdre cette capacité, par manque de moyens matériels, par manque d’espace pour les expériences lentes, par déficit de mémoire institutionnelle. Elles dépendent de plus en plus de producteurs extérieurs dont le souci principal est de survivre.
Pour David Plowright, l’homme qui a longtemps présidé aux destinées de Granada TV, télévision commerciale de service public, l’époque où l’on pouvait encore « prendre le temps » – de former de nouveaux talents, ou tout simplement de penser – est révolue. « Maintenant, dit-il, ce qu’il faut que nous fassions, c’est commencer à former les politiciens. Pour eux, la télévision n’est pas l’activité de loisirs la plus importante [de cette fin de 20è siècle], mais surtout un truc où ils voudraient être vus. Je crois que les politiciens ont tout fait foiré, pas seulement en Grande-Bretagne, mais aussi en France, en Italie, en Allemagne, et qu’ils commencent tout juste à se rendre compte de ce qu’ils ont perdu. (…) Ils devraient comprendre que la télévision [publique] est avant tout un reflet de la société qu’ils sont censés gouverner et organiser. (…) Or quel genre de Grande-Bretagne est reflétée aujourd’hui sur les écrans? Une Grande-Bretagne stupide, ou franchement vulgaire. Rares sont les occasions où ce que vous voyez à la télévision vous inspire un peu. Là est le danger, si la BBC perd ses nerfs et se met à courir derrière l’audimat des débuts de soirée. »
Une chose est claire, en tout cas: les télévisions publiques consacrent désormais trop d’énergie à faire des économies et trop peu à faire de bons programmes.
Comme nous le faisait remarquer de manière sardonique un responsable de télévision européenne: « Nous avions jadis des directeurs de télévision qui avaient un objectif social décent, plus l’envie de faire de l’argent sans trop s’ennuyer. Aujourd’hui, nous avons des directeurs qui ne savent parler que de segments de marché. Désormais, les télés sont dirigées par les comptables. (…) Je n’ai rien contre les comptables, mais j’ai toujours pensé que l’argent devait servir les idées, et non les dominer. »
En tout état de cause, l’amaigrissement des télévisions publiques ne semble pas près de s’arrêter. Partout l’argent se fait rare – qu’il proviennent des caisses de l’Etat, des taxes de redevance, du parrainage ou de la publicité -, partout l’on introduit de nouvelles procédures: comptabilité plus stricte, budgets à base zéro, budgets par production, marché interne aux chaînes de télévision, privatisation d’activités, etc. Efforts certes louables, mais qui, dans une perspective historique, tiennent du marchandage faustien, les télévisions de service public abandonnant au diable leur âme, en échange du droit de survivre.
Le financement non public. La question est de savoir s’il est sain, pour une télévision de service public, d’être obligée de « trouver de l’argent ailleurs ». L’idée traditionnelle du financement public est d’assurer à la télévision publique non seulement les moyens de fonctionner, mais aussi de garder une indépendance sans compromis. Si le téléspectateur paie directement les programmes qu’il regarde (comme dans le système de la Pay TV par exemple), la télévision est contrainte aux compromis permanents.
Les responsables de télévision publique que nous avons interrogés se disent tous prêts à se lancer dans certaines aventures « commerciales » afin de s’assurer des revenus supplémentaires, à la condition exprès, toutefois, que ceux-ci restent marginaux dans le financement de leurs chaînes. Cela posé, ils admettent qu’ils ne peuvent revendiquer un socle de financement solide et indexé si, dans le même temps, ils sont incapables de produire des programmes assez populaires pour que leurs taux d’audience restent suffisants.
Deux questions s’imposent: des taux d’audience suffisants, c’est quoi? Et populaire, c’est quoi?
Si j’en crois les discussions que nous avons eues, à la BBC notamment, il est difficile, pour une télévision publique, en-dessous de 30% d’audience, de se dire « nationale ». Et si elle veut être à la fois populaire et intègre, le risque est grand qu’elle ne cède à la tentation de banaliser ses programmes. Explications d’un responsable de télévision publique: « Beaucoup de mes collègues disent que les temps ont changé, qu’il sont désormais commerciaux et durs. Et que comme il faut bien que nous grandissions, que nous progressions, que nous nous renforcions, il faut aussi que nous produisions des « programmes à formule », des séries en somme, qui soient non seulement des succès commerciaux en termes généraux, mais: a) des succès immédiats – qui attrapent le téléspectateur par le collet, dont les coûts soient aisément analysables, qui soient reproductibles immédiatement, qui puissent être co-produits, qui attirent des parrainages, qui puissent être vendus à l’étranger, et b) des succès qui génèrent eux-mêmes de solides profits. Il faut se demander alors: « Quel niveau de profits veut-on atteindre? Quelle formule est capable de satisfaire à tant ces critères à la fois? » La réponse sera forcément que le produit, pour être vendable, devra être mou, un vrai sac de compromis. »
Le ghetto ultra-élitaire. Certains arguent qu’une télévision publique a le devoir de proposer des programmes « difficiles », ceux que les télévisions commerciales ne peuvent ni n’ont l’intention de diffuser. L’idée séduit certains responsables de télévisions publiques, qu’ils soient fatigués de se défendre (« Vous coûtez trop cher et n’êtes même pas capables de faire de l’audience! »), qu’ils se méfient des velléités populistes des télévisions contemporaines, ou n’aient d’autre ambition que d’agrandir leur empire personnel…
La plupart d’entre sont cependant opposés à une telle marginalisation. « La seule manière pour la télévision publique de garder un rôle vigoureux est de proposer aux téléspectateurs un bon mélange de programmes. Chez nous, nous faisons de très bonnes comédies par exemple, ce qui est assez inhabituel pour une télévision publique. Nous sommes aussi très forts en sport. (…) Il nous serait évidemment facile de dire, OK, nous abandonnons tous ces trucs populaires, nous les laissons à d’autres. (…) Mais ce n’est pas en nous marginalisant que nous survivrons (…) C’est au contraire en ayant le courage de proposer un éventail de programmes très large. » On notera à ce propos que les espèces ayant disparu de la surface de la Terre avaient toujours eu pour stratégie de se replier sur des pâtures dédaignées par leurs ennemis…
La vraie difficulté est de déterminer ce qu’est un programme populaire et de qualité. Lorsque l’on en discute, la crainte de « l’élitisme », les jugements de valeur, les hiérarchies sous-jacentes entrent dans la mêlée. Les responsables des télévisions publiques, lorsqu’on les interroge à ce sujet, s’en tirent généralement par une pirouette: pour être à la fois populaires et de qualité, disent-ils, ils font tout ce qu’ils font « avec classe », avec une « conscience professionnelle supérieure », dans le but de fournir un « service de qualité » au plus grand nombre… Un « plus grand nombre » qu’ils considèrent toutefois moins comme un objectif de survie économique que comme la raison d’être philosophique de leur mission de service public.
Voilà, il est temps de conclure. La plupart des responsables de télévision publique que nous avons rencontrés sont convaincus que leur media doit être créatif et intellectuellement indépendant; doit servir le public et non se servir de lui; maintenir la qualité de sa production à un niveau élevé; rechercher l’excellence dans ses programmes; fuir comme la peste le nivellement par le bas.
De telles professions de foi n’ont de sens, cependant, que si la société qu’elle sert a pour sa télévision publique un minimum de compréhension et d’empathie. C’est là que le bât blesse.
La société, en son état moderne, n’éprouve en effet pour la télévision publique et les valeurs qu’elle prétend défendre qu’une sympathie modérée. Les gouvernements lui cherchent des poux dans la tête, portés par l’idéologie du temps et soutenus silencieusement par des téléspectateurs-consommateurs plus soucieux de leur confort personnel que de bien commun. Les entreprises géantes réduisent à une insignifiance comparative « les simples individus » que la télévision publique entend éclairer. Pendant ce temps, la dérégulation, le commerce, le multimédia, érigés en cultes nouveaux, sabotent la notion même de communauté, hors de laquelle la télévision publique n’a plus de raison d’être. Cependant que la télévision commerciale, par son refus de l’excellence, son goût de la médiocrité, du trivial, du superficiel, et son exploitation vampirique du marché, ébranle chaque jour que Dieu fait la foi de la télévision publique en sa mission.
La télévision publique, quel que soit son courage, ne pourra durer si elle est n’est plus en phase avec les réalités sociologiques du temps. Elle est certes optimiste par définition: n’a-t-elle pas construit un outil de divertissement haut de gamme, développé un journalisme de qualité, insufflé un esprit de perspicacité, d’audace, bref, d’excellence, à tous ses collaborateurs, convaincue que des efforts aussi méritoires suffiraient à faire venir les gens à elle?
Et au début ils vinrent. Mais c’était à une époque où la télévision nationale publique était en situation de quasi-monopole; les gens n’avaient donc pas le choix. Aujourd’hui, en revanche, la concurrence privée est omniprésente, obligeant la télévision publique à se poser de rudes questions: « Se pourrait-il que nous soyons comme une station scientifique installée sur une banquise en train de se disloquer? Se pourrait-il que les grands principes sur lesquels nous fondons notre action, que nos grandes hypothèses sur la nature de la société, soient en train de se disloquer sous les coups d’une réalité nouvelle? »
Au coeur de cette réalité nouvelle, on trouve la mise en cause de la nécessité même de gouverner, au prétexte que l’individu-consommateur-souverain est parfaitement capable de s’exprimer et de s’organiser à travers les mécanismes automatiques du marché. Margaret Thatcher disait qu’à ses yeux la « société » n’existe pas. Ronald Reagan, que le gouvernement est le problème, pas la solution. Mark Fowler, président de la Commission Fédérale de Communications nommé par Ronald Reagan, que l’intérêt public, c’est « ce qui intéresse le public ».
« La légitime raison d’être du gouvernement, écrivait Abraham Lincoln dans les années 1850, est de faire pour les gens ce qui doit être fait mais qu’ils ne peuvent faire, ou faire aussi bien, eux-mêmes. » Theodore Roosevelt observait, quant à lui, qu’une « société simple et pauvre peut être démocratique en se fondant sur le pur individualisme des gens, [mais qu’une] société industrielle riche et complexe ne le peut pas. [Dans une telle société, en effet], certains individus, notamment ces individus artificiels appelés entreprises, deviennent si grands, que l’individu ordinaire, à côté d’eux, fait figure de simple nain, et ne peut traiter avec eux d’égal à égal. Il faut donc que les individus ordinaires combinent leurs forces (…) dans la plus grande de toutes les combinaisons: le gouvernement. »
Richard Steiner suggérait, dans un article récent sur la nécessité de faire revivre l’héritage de Lincoln et des deux Roosevelt, qu’il est aujourd’hui urgent d’envisager crânement la fracture entre « les anges positifs » de notre nature et les anges sombres qui nous poussent sans cesse à « dégrader et dominer les autres » (Lincoln). Steiner commente très justement: « Le côté oppressif de la nature humaine? On ne peut l’annuler. En revanche, on peut le gouverner. »
Plus récemment, George Will tournait en ridicule ceux qui défendent l’idée aujourd’hui dominante que « l’intérêt personnel suffit à faire tic-taquer l’horloge de la société ». Il faisait observer qu’un pays bien gouverné « enveloppe l’individu d’un riche tissu de relations – droits, interdictions, devoirs, privilèges, coutumes – qui renforcent ce qu’il a de meilleur en lui, et tempèrent ce qu’il a de pire. »
Je reste pour ma part convaincu que la médiocrité et l’avilissement doivent être combattus; que l’esprit public doit être exalté; que les citoyens doivent être informés et éduqués, pour développer leur sens de cohérence et d’appartenance; qu’en un temps enfin où la société est menacée par des forces centrifuges dangereuses, radio et télévision publiques sont des contre-forces centripètes vitales.
L’Etat-nation démocratique a besoin d’une télévision publique, parce qu’il a besoin de qualité de vie, de cohérence, de stabilité, parce qu’il a besoin de permettre le vol de ses « anges positifs » et de tenir en respect les anges de la division, de la dégradation, de la domination. L’Etat-nation démocratique doit donner à la télévision publique les moyens de remplir une aussi haute mission. La télévision publique, en contrepartie, doit se débrouiller pour garder une large audience, sans rien renier de ses exigences de qualité.
Acrobatique? Oui, acrobatique.
© Le Temps stratégique, No 66, Genève, octobre 1995
De quelques noms cités
Max Weber (1864-1920)
Économiste, philosophe et sociologue allemand, Max Weber fut l’un des penseurs les plus marquants de son temps. Ses deux oeuvres majeures sont Économie et Société (1922) et L’Éthique protestante et l’esprit du capitalisme (1904 – traduit en 1964). Max Weber affirmait au début du siècle déjà que notre société occidentale est dominée par la rationalité.
Norman Mailer (1923)
Romancier américain flamboyant, Norman Mailer a pour thème de prédilection les contradictions de la société américaine (politique, guerre, sexualité). Il mêle allègrement l’autobiographie au reportage dans le but de « transformer l’Histoire en roman et le roman en Histoire ». Norman Mailer est notamment l’auteur de: An American Dream (1965 – Un rêve américain ), A Fire on the Moon (1970 – Bivouac sur la lune), The Executioner’s Song (1979 – Le Chant du bourreau).
Milton Friedman (1912)
Économiste américain, célèbre théoricien de la non moins célèbre « École de Chicago », il prétendit que les variations de l’activité économique dépendent des variations de l’offre de la monnaie (et non des variations de l’investissement, comme l’affirme Keynes). Sa théorie monétariste prône une politique libérale de non-intervention de l’État, et joua un rôle influent sur la politique économique des États-Unis et des pays européens. Auteur de Studies in the Quantity Theory of Money (1956) et de A Theory of the Consumption Function (1957), il reçut le prix Nobel d’Économie en 1976.
Edward Heath (1916)
Homme politique britannique, chef des Conservateurs, il devint Premier ministre après le succès de son parti aux élections de 1970. Empoignant avec brutalité les problèmes sociaux et financiers de son pays (vote d’une loi contre les grèves en 1971, flottaison de la livre décidée en 1972), il fit entrer définitivement la Grande-Bretagne dans la Communauté européenne en 1972. Après avoir dû abandonner son poste en 1974, il fut également remplacé à la tête du parti conservateur par Margaret Thatcher en 1975.
Barry Goldwater (1909)
Homme politique américain, Barry Goldwater fut sénateur de l’Arizona et candidat républicain aux élections présidentielles de 1964. Très conservateur, il critiqua violemment la politique de John Kennedy, qu’il accusait de créer un État socialiste. Goldwater perdit la course à la présidence des États-Unis face à Lyndon B. Johnson. Ses idées extrémistes en matière de politique étrangère firent craindre aux électeurs qu’il n’entraîne le pays dans la guerre. Barry Goldwater a également écrit The conscience of a Conservative (1960).
Le dilemme des TV publiques d’Europe
Analyse UER portant sur les TV publiques de 17 à 22 pays d’Europe pour la période 1988-1996 (résultats statistiques et prévisions).
Elles diffusent de plus en plus d’heures de programmes
Nombre moyen d’heures annuelles diffusées par les compagnies de télévision prises en compte dans l’étude
1988 8623 heures par an
1990 9616
1992 12 066
1994 13 359 (Télévision suisse romande: 7490; quatre chaînes SSR: 31 136)
1996 13 636
Elles dépensent de plus en plus
Augmentation moyenne des frais d’exploitation pour l’ensemble des télévisions publiques considérées, par année
de 1988 à 1994 (statistiques) 8.7 % (Suisse: 8 %)
de 1994 à 1996 (prévisions) 3.9 % (Suisse 5.7 %)
Malgré cela, elles perdent des parts de marché
Parts d’audience par jour, moyenne des télévisions publiques considérées
L’écran de vos nuits blanches
Studies in Broadcasting.Publication annuelle de NHK’s Theoretical Research Centre, Tokyo, Japon.
The Cultural Obligations of Broadcasting par Hayden Shaughnessy and Carmen Fuento Cado. European Institute for the Media, Media Monograph, no. 12, 1990.
Public Service Broadcasting in a Multichannel Environment : the History and Survival of an Ideal,par Robert A. Avery (ed). New York, Longman, 1993.
A Variety of Lives: a Biography of Sir Hugh Greene, par Michael Tracey. Londres, Bodley Head, 1983.
Television and the Public Interest: Preserving Vulnerable Values in Western European Broadcasting. Londres, Sage, 1993.
The Public Service Idea in British Broadcasting: Main Principles. Londres, Broadcasting Research Unit, 1983.