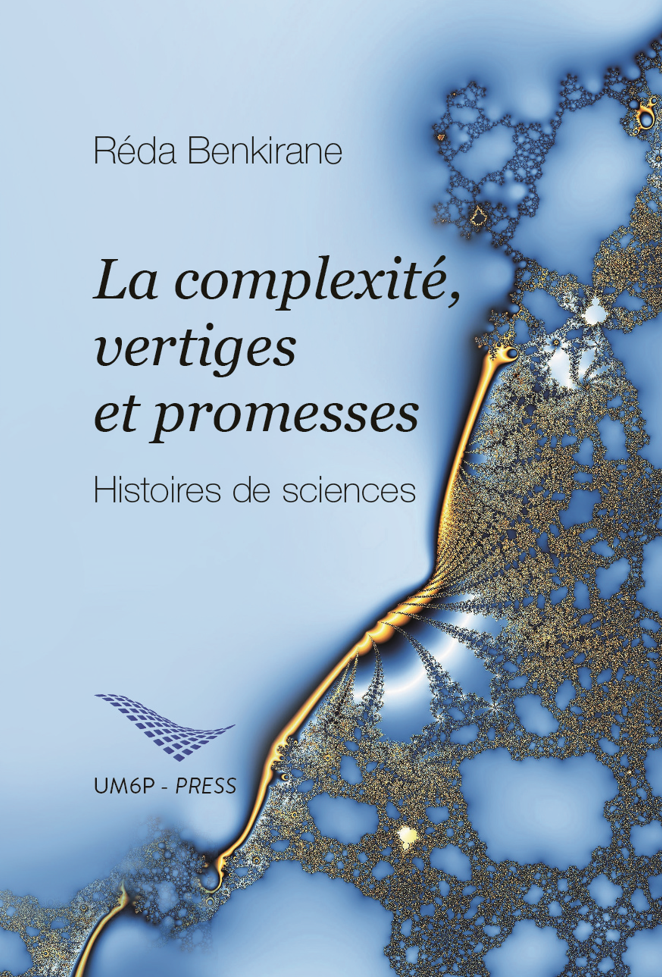Ibn Arabî et le voyage sans retour
par Claude Addas
[extraits]
Claude Addas est également l’auteur de Ibn ‘Arabi ou la quête du Soufre Rouge (Paris, Gallimard, 1989).
- Faut-il brûler Ibn Arabî ?
- La prière du Prince
- L’enfant et le philosophe
- « Je sus alors que ma parole atteindrait l’Orient et l’Occident »
Faut-il brûler Ibn Arabî ?
S’il est poète à ses heures, Sélim Ier n’est pas un rêveur. Maître de l’empire ottoman – après avoir sans états d’âme semé sur son chemin les cadavres de sa parentèle -, le père de Soliman le Magnifique est un conquérant pressé. Le 28 septembre 1516, il entre à Damas: la Syrie lui appartient, l’Egypte est sa prochaine étape. Après de durs combats contre les Mamelouks, il arrive au Caire en vainqueur le 7 février 1517. Au début d’octobre, il est de retour à Damas et met aussitôt en chantier la construction d’une mosquée et d’un mausolée qui, désormais, abritera le tombeau d’Ibn Arabî. Ce tombeau, gisant parmi les herbes folles dans un enclos à l’abandon, il l’avait déjà pieusement visité lors de son précédent séjour, à un moment où les préparatifs de l’expédition en Égypte semblaient devoir l’occuper tout entier. Les travaux, dont il contrôle personnellement l’exécution, avancent rapidement. Le 5 février 1518, la prière du vendredi est célébrée pour la première fois en présence du sultan.
Le personnage ainsi honoré d’un hommage impérial n’était pourtant pas de ceux dont, à l’époque, les notables damascènes vénéraient la mémoire. Un voyageur marocain, quelques années auparavant, avait pu à grand-peine se faire indiquer l’emplacement du cimetière privé des Banû Zakî, où reposait Ibn Arabî: l’oeuvre de ce dernier était alors en Syrie la cible de violentes polémiques et son auteur, frappé d’anathème, n’échappait à l’oubli que par la haine posthume qu’il suscitait chez la plupart. On s’interroge donc encore sur le motif de la fervente attention que porta Sélim à un maître spirituel dont l’enseignement était obscur et décrié: la métaphysique n’était pas son fort et sa politique n’avait rien à y gagner. On attribue à Ibn Arabî, il est vrai, un écrit parfaitement apocryphe – censé prédire, en termes sibyllins, les hautes destinées de la dynastie ottomane et, en particulier, la conquête de la Syrie. Mais ce grimoire a été manifestement rédigépost eventum et il est fort peu probable que Sélim l’ait connu. Il n’explique donc pas la surprenante dévotion du sultan, qu’imiteront sur ce point la plupart de ses successeurs.
Juste retour des choses ? Trois siècles auparavant, Muhammad b. Alî al-Arabî al-Hâtimî al-Tâ’î, surnomméMuhyî al-dîn ( » le Vivificateur de la religion « ), venu de son Andalousie natale, avait trouvé à Damas, où il avait choisi de s’établir au terme de longues pérégrinations, l’accueil dû à un éminent soufi. Et c’est entouré de vénération et fort paisiblement que, âgé de soixante-dix-huit années lunaires, il y avait rendu l’âme le 8 novembre 1240 (638 de l’hégire). Tout aussi paisiblement sa dépouille avait été conduite vers sa dernière demeure, sur le mont Qâsiyûn. A ceux qui le pleuraient ce jour-là, il ne laissait aucun bien – il avait renoncé, depuis son adolescence, aux biens de ce monde -, mais il léguait une oeuvre littéraire aux dimensions colossales.
Qu’on le considère comme un philosophe ou comme un mystique, comme un hérétique ou comme un saint, un fait demeure incontournable: avec plus de quatre cents ouvrages à son actif, Ibn Arabî figure parmi les écrivains les plus féconds de la littérature arabe. Si certains de ces écrits ne sont que de brefs opuscules, d’autres, en revanche, comptent des milliers de pages. Il y a, par exemple, ce Recueil des connaissances divines (Dîwân al-Ma’ârif), une somme poétique qu’Ibn Arabî a rédigée à la fin de sa vie en vue d’y rassembler l’intégralité des poèmes qu’il a composés au cours de sa longue existence, soit des dizaines de milliers de vers. Il y a ce commentaire du Coran en soixante-quatre volumes encore est-il inachevé ! -, aujourd’hui disparu. Il y a aussi et surtout les trente-sept volumes des Futûhât Makkiyya, Les Illuminations de La Mecque.
La première version est achevée en décembre 1231 et donnée en legs à son fils, » et après lui à ses descendants et à tous les musulmans d’Occident et d’Orient, sur terre et sur mer « . C’est dire que dans l’esprit d’lbn Arabî, ce qu’il a consigné dans cette somme n’est point seulement destiné à une poignée d’érudits. C’est aux musulmans de tous les horizons, de tous les temps à venir, que s’adresse son message. » Je sus alors que ma parole atteindrait les deux horizons, celui d’Occident et celui d’Orient « , déclare-t-il à la suite d’une vision survenue dans sa jeunesse. L’histoire lui a-t-elle donné raison ? Quand on songe que depuis plus de sept siècles son oeuvre n’a cessé d’être lue, méditée – attaquée aussi, nous y reviendrons – et commentée dans toutes les langues vernaculaires de l’islam; quand on sait l’influence majeure qu’elle va exercer sur tout le soufisme – » the mystical dimension of islam « , selon l’expression d’Anne-Marie Schimmel -, que ce soit dans ses formes érudites ou ses expressions populaires, force est de répondre par l’affirmative. En serait-il autrement, d’ailleurs, que la vindicte des oulémas à l’encontre d’lbn Arabî aurait cessé depuis longtemps. Si, depuis la fin du XIIIe siècle, ils persistent à combattre les idées que véhicule son enseignement, c’est qu’ils savent pertinemment que l’adversaire qu’ils traquent reste invaincu et que, de manière ouverte ou couverte, son oeuvre demeure une référence majeure pour les » Hommes de la Voie « .
Bien des facteurs que nous n’évoquerons pas ici, d’ordre historique, politique et socioculturel, ont contribué à ce rayonnement que les polémiques ont été impuissantes à éteindre. Il résulte aussi, à n’en pas douter, du caractère exhaustif de l’enseignement exposé dans les Futûhât: ontologie, cosmologie, hagiologie, prophétologie, eschatologie, exégèse, jurisprudence, rituel…, il n’est pas de question qui ne trouve une réponse dans ce compendium des sciences spirituelles – quand ce ne sont pas des réponses. Le Doctor Maximus a en effet le souci constant, lorsqu’il traite de questions litigieuses, d’indiquer les diverses opinions qui ont prévalu. Il n’exclut aucune des interprétations proposées, tout en signalant celle qui a sa préférence. Au demeurant – et contrairement à une opinion courante selon laquelle il était zâhirite -, Ibn Arabî n’est rattaché à aucune école juridique ou théologique. C’est un penseur indépendant, au sens le plus fort de ce terme. Non qu’il rejette l’héritage des maîtres qui l’ont précédé et dont son œuvre est, au contraire, totalement solidaire. Ibn Arabî, quoi qu’en disent ses adversaires, n’est pas un » innovateur « , du moins au sens péjoratif qu’ils donnent à ce terme. Les Futûhât sont d’abord l’expression d’une extraordinaire synthèse qui ordonne et rassemble les membra disjecta d’une longue et riche tradition mystique. La formulation est certes parfois inédite, souvent audacieuse, mais ce qu’elle véhicule était présent, en germe, bien avant que son auteur voie le jour.
La seconde version de cette Summa mystica – dont subsiste le manuscrit autographe – est achevée en 1238, deux ans avant la mort de l’auteur, et offre un état définitif et complet de son enseignement. D’emblée, on observe que les idées majeures qui s’y trouvent développées et le vocabulaire qui les exprime apparaissaient déjà dans ses écrits de jeunesse. Au surplus, Ibn Arabî a incorporé dans les Futûhât, pratiquement sans modification, de courts traités rédigés antérieurement. Aussi bien serait-il vain de vouloir retracer une évolution de sa pensée qui serait à mettre en rapport avec les étapes de sa biographie: c’est à un développement homogène de la doctrine à partir de prémisses immuables que l’on assiste. Et si, sur tel ou tel point, les écrits les plus anciens sont moins explicites que ceux qui leur succéderont, cela ne signifie pas qu’Ibn Arabî n’avait pas déjà une vue suffisamment claire du sujet traité: la situation politique en Occident, où commence sa carrière d’écrivain, lui imposait une certaine réserve. Protégé par de puissants personnages, entouré d’un cercle de disciples fidèles, Ibn Arabî sera plus libre de sa plume en Orient. Là encore, néanmoins, il usera de certaines précautions. Plusieurs de ses ouvrages ne connaîtront, de son vivant, qu’une diffusion restreinte.
C’est d’ailleurs à partir du moment, vers la fin du XIIIe siècle, où cette discipline de l’arcane ne sera plus observée que nâîtront des polémiques destinées à se poursuivre jusqu’à nos jours. La diffusion des Fusûs al-hikam (Les Chatons de la sagesse), et les nombreux commentaires qu’en firent les disciples des première, deuxième et troisième générations vont jouer à cet égard un rôle considérable. Beaucoup plus concis que lesFutûhât, cet ouvrage, qui, en une centaine de pages seulement, récapitule l’essentiel de la doctrine métaphysique et hagiologique d’lbn Arabî, donne davantage prise aux attaques de lecteurs malveillants. Tout dévoués qu’ils fussent à leur maître, les disciples – dont les gloses sont marquées par un langage plus philosophique, et donc plus suspect – ont contribué à faire des Fusûs une cible de choix pour les adversaires d’lbn Arabî.
Un procès toujours recommencé
On imagine mal un député français demandant aujourd’hui au Parlement d’interdire la diffusion des oeuvres de Maître Eckhart en invoquant la bulle In agro dominico de Jean XXII. En Égypte, un député a obtenu de l’Assemblée du peuple, en 1979, que les Futûhât soient retirées du commerce. Cette mesure a été, fort heureusement, rapportée par la suite; elle n’en est pas moins significative de la permanente actualité des problèmes que posent à la conscience musulmane des écrits vieux de bientôt huit siècles. Vénéré par les uns, qui le considèrent comme le Shaykh al-akbar, » le plus grand mâître « , anathémisé par d’autres, qui voient en lui un ennemi de la vraie foi, Ibn Arabî n’est indifférent à personne.
Les premières escarmouches éclatèrent dans la seconde moitié du XIIIe siècle; il ne s’agissait toutefois que de tirs isolés, sans grandes conséquences. Les attaques systématiques contre Ibn Arabî et son école ne se déclenchèrent véritablement qu’à l’aube du XIVe siècle, quand un docteur de la Loi (faqîh) du nom d’lbn Taymiyya (m. 1328) entreprit de démontrer le caractère hérétique de sa doctrine. Presque aussi abondant que le Shaykh al-akbar, il rédigea inlassablement d’innombrables responsa (fatwâ-s), dont l’édition publiée en Arabie Saoudite comporte trente-sept volumes; il y dénonce à coup de citations scripturaires les thèses qu’il extrait de l’oeuvre d’lbn Arabî. Du moins a-t-il de cette dernière une assez bonne connaissance. Si ses critiques portent essentiellement sur les Fusûs, il n’en a pas moins lu également les Futûhât et convient même en avoir tiré profit. Nombreux seront ceux qui l’imiteront sans avoir toujours ses scrupules. La longue liste des épigones d’lbn Taymiyya – que nous épargnerons au lecteur- témoigne de la continuité dans l’espace et le temps de polémiques dont la persistance surprend l’observateur occidental. Signalons pourtant que, invité à arbitrer une controverse surgie à Alexandrie, le célèbre Ibn Khaldûn délivra une sentence juridique prescrivant l’autodafé des livres d’lbn Arabî.
Que la prolifération de cette littérature anti-akbarienne ne nous abuse pas. Les sentences hostiles au Shaykh al-akbar sont certes nombreuses, mais leur contenu est immuable. Ce sont, à peu de choses près, les arguments avancés par Ibn Taymiyya et les textes témoins qu’il avait utilisés, qui sont indéfiniment repris. En outre, la virulence du discours – rhétorique oblige – masque souvent un jugement plus nuancé qu’il n’y paraît de prime abord. Dhahabî (m. 1348), élève d’lbn Taymiyya, s’est prononcé à maintes reprises contre Ibn Arabî. Mais n’écrit-il pas aussi à son propos: » Quant à moi, je dis que cet homme fut peut-être un saint… » ? Troublante réserve, que précède une dénonciation en règle des Fusûs. La remarque suivante nous permet peut-être de déchiffrer cette position ambiguë: » Par Dieu, mieux vaut pour un musulman vivre ignorant derrière ses vaches […] que de posséder cette gnose et ces connaissances subtiles ! » C’est moins la doctrine d’lbn Arabî que Dhahabî condamne, en définitive, que sa diffusion dans la » masse des croyants « (âmma).
Rien, de surcroît, ne serait plus contraire à la réalité que de croire – ou de laisser croire, comme s’y emploient les wahhabites – que tous les oulémas ont condamné Ibn Arabî. Certains soufis se sont opposés à l’école d’lbn Arabî; inversement, beaucoup d’oulémas, et parmi les plus prestigieux, ont défendu sa cause. Citons, parmi eux, Fîrûzabâdî (m. 1414), qui, au Yémen, rédige une fatwâ dans laquelle il s’évertue à démontrer la sainteté d’lbn Arabî et approuve le sultan al-Nâsir, qui accumule ses oeuvres dans sa bibliothèque. Moins d’un siècle plus tard, en 1517, Kamâl Pachâ Zâdeh (m. 1534), conseiller très écouté de Sélim Ier (lequel, décidément, est voué à jouer un rôle dans la destinée posthume d’lbn Arabî), émet une sentence recommandant au sultan, qui vient de conquérir l’Égypte, de réprimander ceux qui dénigrent le Shaykh al-akbar.
Évoquant les adversaires d’lbn Arabî, nous avons délibérément passé sous silence la propagande anti-akbarienne diffamatoire que publient régulièrement de nos jours les wahhabites saoudiens et leurs émules. La médiocrité intellectuelle de cette littérature pamphlétaire dispense de tout commentaire. Mais, pour malveillant qu’il soit, cet acharnement à combattre son oeuvre soulève tout de même une question: Ibn Arabî est-il, conformément à la signification de son surnom traditionnel, un » vivificateur de la religion » (Muhyî al-dîn) ou, comme préfèrent le désigner ses adversaires, un » tueur de la religion » (Mumît al-dîn) ?
La prière du prince
« Je n’ai eu de cesse, dès que je fus en âge de porter des ceinturons, de chevaucher des coursiers, de fréquenter les nobles, d’examiner les lames des sabres, de parader dans les campements militaires. » Personne, parmi ses proches n’eût sans doute pu prévoir que ce jeune garçon qu’attirait le clinquant des armures allait bientôt se vouer aux dures ascèses des renonçants. Tout destinait le jeune Ibn Arabî à une carrière militaire. L’Esprit qui souffle où il veut en avait décidé autrement.
La famille d’Ibn Arabî appartient à l’une des plus vieilles souches arabes de l’Espagne musulmane. Ses ancêtres, des Arabes originaires du Yémen, émigrèrent très tôt vers la péninsule Ibérique; vraisemblablement lors de la » seconde vague » de la conquête, celle qui, en 712 amena plusieurs milliers de cavaliers yéménites en Andalousie. Du moins sont-ils recensés parmi les » grandes familles » arabes qui occupent le sol andalou sous le règne du premier émir omeyyade (756-788). C’est dire qu’ils appartiennent à la khâssa, la classe dominante qui détient les hautes fonctions dans l’administration et dans l’armée.
Fier de son origine arabe, Ibn Arabî aime à rappeler dans nombre de ses poèmes qu’il descend de l’illustre Hâtim al-Tâ’î, poète de l’Arabie anté-islamique dont les vertus chevaleresques devinrent littéralement proverbiales. Il fait allusion d’autre part, à diverses reprises, à la position importante de son père, qui, précise-t-il, » comptait parmi les compagnons du sultan » – expression qui a donné lieu à de nombreuses conjectures et dont certains biographes tardifs ont tiré la conclusion qu’il ne fut pas moins que ministre. Un document édité il y a quelques années permet maintenant d’être beaucoup plus précis. Selon son auteur, Ibn Sha’âr (m. 1256), qui a rencontré le Shaykh al-akbar à Alep le 27 octobre 1237 et l’a interrogé sur sa jeunesse, Ibn Arabî » était d’une famille de militaires au service de ceux qui gouvernent le pays « . Évasive, cette formulation nous rappelle que la carrière du père d’lbn Arabî s’inscrit dans le cadre des fluctuations politiques qui ont accompagné l’effondrement du régime almoravide en Andalus.
Berbères venus du Sahara occidental, les Almoravides avaient débarqué dans la Péninsule à la demande des souverains des Taifas : ces États autonomes avaient vu le jour à la faveur de la chute du califat de Cordoue et s’inquiétaient de la progression continue des chrétiens, qui avaient pris Tolède en mai 1085. L’écrasante défaite qu’ils infligent aux Castillans moins d’un an plus tard à Zallâqa permet aux Almoravides de se présenter comme les défenseurs de l’islam andalou. Petit à petit, ils annexent les Taifas pour donner finalement naissance au premier État andalou-maghrébin, lequel marque une ère nouvelle dans l’histoire de l’Espagne musulmane. Dorénavant, son destin politique, religieux, culturel, est étroitement lié à celui du Maghreb. A une mosaique d’ethnies, de langues et de confessions se substitue peu à peu une société plus homogène, largement arabisée et islamisée, mais aussi plus repliée sur elle-même. L’inquiétude qu’ont fait naître les succès de la Reconquista favorise l’intolérance à l’égard des juifs et des chrétiens, qui émigrent massivement vers le Nord. Mais cette intolérance résulte aussi de la rigidité dogmatique des juristes mâlikites, dont l’ascendant sur les souverains almoravides est considérable. Le puritanisme des Almoravides, l’importance qu’ils donnent à la jurisprudence au détriment de l’étude du Coran et de la sunna, la » coutume du Prophète « , engendrent une casuistique sclérosante, qui étouffe les nouvelles aspirations religieuses dont témoigne notamment le développement du soufisme. Il est significatif à cet égard que les deux principaux soulèvements qui vont déstabiliser le régime se présentent comme des mouvements de réforme religieuse.
Après un séjour en Orient, où il a pris connaissance des ouvrages de Ghazâlî, Ibn Toumert, un Berbère du Sous revient prêcher au Maghreb un islam plus sobre, centré sur le tawhîd, I’affirmation de l’Unicité divine – d’où le nom de muwahhidûn, Almohades, donné à ses partisans. Fustigeant les dirigeants almoravides, qu’il accuse d’être des anthropomorphistes et des infidèles, il se proclame le Mahdî – celui qui doit assister Jésus à la fin des temps pour restaurer la paix et la justice – et prend les armes. A sa mort, en 1130, Abd al-Mu’min, l’un de ses plus anciens disciples, s’impose comme son successeur et poursuit la lutte. Elle s’avère longue et ponctuée de défaites ; cependant, la prise de Marrakech en 1147 met un terme à la souveraineté almoravide au Maghreb.
L’annexion de l’Andalus, I’Espagne musulmane, où les Almoravides sont en proie à de graves difficultés internes et externes, sera plus rapide. L’autodafé des oeuvres de Ghazâlî décrété par les autorités a suscité des remous dans la population, en particulier dans les milieux soufis. Ce mécontentement, qu’accentuent les échecs militaires (les Almoravides ont perdu Saragosse en 1118), favorise l’expansion de la révolte desmurîdûn, une espèce de congrégation qui s’est regroupée dans l’Algarve autour d’Ibn Qasî, lequel prétend également être l’Imâm, le Guide spirituel et politique de la communauté. Séduit par la propagande des Almohades, dont il espére le soutien, Ibn Qasî persuade Abd al-Mu’min d’envoyer des troupes dans la Péninsule. Les premières débarquent en 1146 et, un an plus tard, Séville et sa région sont sous obédience almohade. Mais la conquête est loin d’être achevée: Grenade reste sous la juridiction des Almoravides; Almeria est occupée par les Castillans, tandis qu’un émirat indépendant voit le jour dans le Levant sous l’égide d’Ibn Mardanish, un chef militaire qui installe son état-major à Murcie.
C’est dans cette ville, où son père exerce des charges militaires au service d’Ibn Mardanish, qu’Ibn Arabî vient au monde le 27 juillet 1165 (17 ramadân 560) ou, selon d’autres sources, le 6 août (27 ramadân). Moins de trois mois plus tard, Murcie est assiégée par les Almohades. Ces derniers devront pourtant attendre jusqu’en mars 1172 pour s’emparer de la cité. Ibn Mardanish ne survit pas à la défaite ; accompagnés d’une délégation comprenant les hauts dignitaires de l’armée, ses fils se rendent à Séville et prêtent allégeance au calife Abû Ya’qûb Yûsuf. Le souverain almohade, qui a succédé à son père en 1163, s’empresse de reprendre à son service les généraux d’Ibn Mardanish, dont il ne connaît que trop bien les compétences.
Le père d’Ibn Arabî est vraisemblablement du nombre ; c’est à cette époque, en tous les cas, qu’il émigre à Séville pour y poursuivre sa carrière au service des Almohades. Plus rien dès lors ne vient troubler l’enfance heureuse et insouciante d’Ibn Arabî. Le jeune garçon aime à chasser et, nous l’avons vu, jouer au soldat. Son destin semble tout tracé : à l’instar de son père, dont il est l’unique fils, il entrera dans l’armée.
Une foudroyante métamorphose
Rien, donc, ne laissait présager a priori que la vie de cet adolescent promis à une carrière militaire allait basculer du jour au lendemain. Saura-t-on jamais ce qui se produisit et à quelle date exactement ? Aucun texte connu d’Ibn Arabî ne permet à ce jour d’apporter une réponse claire et précise. Le célèbre texte où il décrit son entrevue à Cordoue avec le philosophe Averroès nous fournit, à tout le moins, un repére chronologique: Ibn Arabî s’y dépeint comme un jeune garçon complètement imberbe mais doté, déjà, de connaissances illuminatives qu’il a récemment obtenues au cours d’une retraite.
On peut déduire de ce récit qu’au moment de cet épisode il est approximativement âgé d’une quinzaine d’années. La suite du témoignage d’Ibn Sha’âr nous livre par ailleurs une information précise et détaillée quant aux circonstances de cette brusque et précoce metanoia: » La raison, lui raconte Ibn Arabî, qui m’a conduit à quitter l’armée d’une part et à entrer dans la Voie d’autre part, est la suivante: j’étais sorti un jour, à Cordoue, en compagnie du prince Abû Bakr [b.] Yûsuf b. Abd al-Mu’min. Nous nous rendîmes à la grande mosquée et je l’observais tandis qu’il s’inclinait et se prosternait dans la prière avec humilité et componction. Je me fis alors la remarque suivante: si un tel personnage, qui n’est pas moins que le souverain de ce pays, se montre soumis, humble et se comporte de la sorte avec Dieu, c’est que le bas monde n’est rien ! Je le quittai le jour même – jamais je ne le revis – et m’engageai dans la Voie. «
Mais ce document soulève presque autant de questions qu’il en résout. Ibn Sha’âr situe cet épisode en 1184, date à laquelle Ibn Arabî a dix-neuf ans. Or le portrait qu’Ibn Arabî brosse de lui-même dans le récit de sa rencontre avec Averroès, postérieure à son engagement spirituel, infirme une telle hypothèse. En outre, de quel prince s’agit-il ? Le calife Yûsuf a régné entre 1163 et 1184, mais il n’a pu se trouver à Cordoue à cette époque puisqu’il quitte l’Andalousie en 1176 pour le Maroc, où il demeure jusqu’en 1184. En mai de cette année-là, il franchit le Détroit et se rend directement à Séville pour passer ses troupes en revue. Peu après, le 7 juin, le calife quitte la capitale pour une expédition contre le Portugal dont il ne reviendra pas vivant. Au demeurant, son » patronyme » est Abû Ya’qûb (et non Abû Bakr), ce qu’Ibn Arabî n’ignore certainement pas. Il est vraisemblable dans ces conditions que le prince dont l’humilité dans la prière a proprement bouleversé Ibn Arabî est l’un des fils du calife, Abû Bakr, qui fut l’un de ses généraux.
En tout état de cause, une certitude demeure: l’incident survenu dans la mosquée de Cordoue constitue le point de rupture dans le cours, jusque-là paisible, de l’existence du jeune Ibn Arabî. Le petit grain de sable qui vient de percuter son destin déclenche une prise de conscience aussi brutale qu’irréversible. Sa décision est prise: il choisit Dieu. L’adolescent quitte tout, l’armée, ses compagnons, ses biens. Il se retire du monde – dans une caverne située au milieu d’un cimetière, selon l’un de ses biographes pour un face-à-face avec l’Éternel dont, d’une certaine façon, il ne reviendra jamais : » Je me suis mis en retraite avant l’aurore et je reçus l’illumination avant que le soleil ne se lève […]. Je demeurai en ce lieu quatorze mois et j’obtins ainsi les secrets sur lesquels j’écrivis ensuite; mon ouverture spirituelle, à ce moment, fut un arrachement extatique. «
Une prodigieuse métamorphose, au sens le plus fort de ce mot, s’est donc opérée chez le jeune garçon, qui, au sortir de cette réclusion, n’a de commun que le nom avec l’adolescent qui caracolait dans les garnisons militaires. Cette rupture radicale entre ce qu’il était jusque-là et ce qu’il sera dorénavant, Ibn Arabî en rend bien compte lorsque, pour évoquer sa vie d' » avant « , il l’appelle » ma jâhiliyya « , terme qui désigne l’état de paganisme – littéralement, d' » ignorance » – dans lequel vivaient les Arabes avant la révélation muhammadienne qui inaugurait une ère nouvelle de leur destinée.
L’enfant et le philosophe
Je me rendis un jour, à Cordoue, chez le cadi Abû l-Walîd Ibn Rushd [Averroès]; ayant entendu parler de l’illumination que Dieu m’avait octroyée, il s’était montré surpris et avait émis le souhait de me rencontrer. Mon père, qui était l’un de ses amis, me dépêcha chez lui sous un prétexte quelconque. A cette époque j’étais un jeune garçon sans duvet sur le visage et sans même de moustache. Lorsque je fus introduit, il [Averroès] se leva de sa place, manifesta son affection et sa considération, et m’embrassa. Puis il me dit: » Oui. » A mon tour, je dis: » Oui. » Sa joie s’accrut en voyant que je l’avais compris. Cependant, lorsque je réalisai ce qui avait motivé sa joie, j’ajoutai: » Non. » Il se contracta, perdit ses couleurs, et fus pris d’un doute: » Qu’avez-vous donc trouvé par le dévoilement et l’inspiration divine ? Est-ce identique à ce que nous donne la réflexion spéculative ? » Je répondis: » Oui et non; entre le oui et le non, les esprits prennent leur envol, et les nuques se détachent ! »
Ibn Arabî, Futuhât, I, p. 153-154.
« Je sus alors que ma parole atteindrait l’Orient et l’Occident »
La raison qui m’a conduit à proférer de la poésie (shi’r) est que j’ai vu en songe un ange qui m’apportait un morceau de lumière blanche ; on eût dit qu’il provenait du soleil. « Qu’est-ce que cela ? », demandai-je. « C’est la sourate al-sh’u’arâ (Les Poètes) » me fut-il répondu. Je l’avalai et je sentis un cheveu (sha’ra) qui remontait de ma poitrine à ma gorge, puis à ma bouche. C’était un animal avec une tête, une langue, des yeux et des lèvres. Il s’étendit jusqu’à ce que sa tête atteigne les deux horizons, celui d’Orient et celui d’Occident. Puis il se contracta et revint dans ma poitrine ; je sus alors que ma parole atteindrait l’Orient et l’Occident. Quand je revins à moi, je déclamai des vers qui ne procédaient d’aucune réflexion ni d’aucune intellection. Depuis lors cette inspiration n’a jamais cessé.
Ibn ‘Arabi, Diwan al Ma’arif