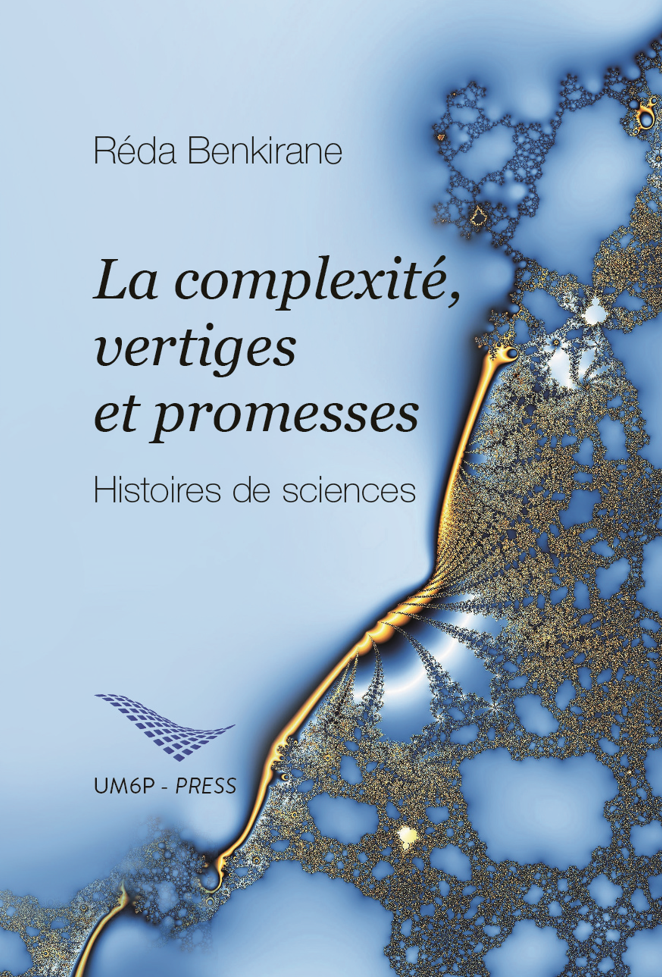Gnomon:
les débuts de la géométrie en Grèce
par Michel Serres
La géométrie grecque émerge, peut-être de l’astronomie et des algorithmes courants dans le croissant fertile.
 La dissémination des ports, d’Apollonie sur la mer Noire à Cyrène l’Africaine ou de Pergé en Asie Mineure à la Sicile ou l’Italie, s’élargit autant que se concentrent les producteurs de connaissances en écoles rivales. La société enseignante et savante mime dès sa naissance la société tout court. Des villes-États se dispersent et s’affrontent sur les rives de la mer: de même la petite cité athénienne de l’Académie, par exemple, sous la direction de Platon, livre des batailles acharnées contre dix sophistes, Hippias, Protagoras ou autres, et conclut des alliances temporaires avec des étrangers de Crotone, Cnide, Locres, Élée: Pythagore, Eudoxe, Timée, Parménide, Théodore de Cyrène.
La dissémination des ports, d’Apollonie sur la mer Noire à Cyrène l’Africaine ou de Pergé en Asie Mineure à la Sicile ou l’Italie, s’élargit autant que se concentrent les producteurs de connaissances en écoles rivales. La société enseignante et savante mime dès sa naissance la société tout court. Des villes-États se dispersent et s’affrontent sur les rives de la mer: de même la petite cité athénienne de l’Académie, par exemple, sous la direction de Platon, livre des batailles acharnées contre dix sophistes, Hippias, Protagoras ou autres, et conclut des alliances temporaires avec des étrangers de Crotone, Cnide, Locres, Élée: Pythagore, Eudoxe, Timée, Parménide, Théodore de Cyrène.
De l’Empire grec
Jamais la grécité ne parvint à l’unité, ni quand fleurirent les hégémonies d’Athènes, Thèbes, Sparte ni même quand les grandes puissances des quatre points cardinaux, Mèdes et Perses, Macédoniens, Carthaginois ou Romains les menacèrent de destruction. Nulle ligue ne dura longtemps parce que les Grecs, rivaux inépuisables aux rivages de la mer, se bornèrent, tel Alcibiade, à rêver un Empire unitaire. Les cités ou roitelets se détestaient aussi vaillamment que les philosophes. Cependant le littoral s’hellénise, les bords des trois continents Asie, Afrique, Europe, parlent grec. Mais la langue commune du commerce nautique meurt, comme les hégémonies brèves, les écoles, les petits dieux, comme ce que nous nommons l’économie. Rien ne restera de rien. Cet effondrement se nomme Antiquité.
Or en moins de quatre siècles, de Thalès de Milet à Euclide d’Alexandrie et qu’ils le veuillent ou non, les penseurs grecs, rivaux de villes et d’écoles, d’économie et de religion, acharnés à se contredire, fils de la terre contre amis des formes ou penseurs du mouvant contre éternitaires, ont, ensemble, construit, de façon foudroyante et inattendue, un Empire invisible et unique dont la grandeur sans décadence perdure jusqu’à nous, un bâtiment sans autre exemple dans l’histoire où ils nous amènent encore, à plus de deux millénaires de distance, à travailler selon les mêmes gestes qu’eux et sans l’abandonner sous le prétexte de la confusion de nos langues et même si nos haines croissent. L’humanité a-t-elle jamais formé un accord équivalent? Cette réussite s’appelle les mathématiques.
Tradition
L’histoire telle qu’elle s’écrit aujourd’hui interdit de parler, comme Ernest Renan le fit, de miracle, pour l’origine de la géométrie en terre grecque. Les scientifiques de ce jour admettent l’existence d’événements rarissimes dans certaines disciplines, les historiens, au contraire, n’en rencontrent plus dans la leur et n’y trouvent que des lois. Comme si le temps monotone avait changés de camp. Pourtant, la naissance de l’espace abstrait constitue un événement très inattendu même pour ceux qui savent ce qui se passa dans les calculs d’Égypte ou de Mésopotamie; cependant la construction de cet Empire grec auquel nous demeurons soumis peut passer pour encore plus improbable: à preuve qu’elle ne figure, malgré sa réalité tangible et vivante, dans aucun livre d’histoire.
Nous avons tous refait durant notre enfance le voyage de Samos à Milet, du calcul des entiers au cas d’égalité des triangles et de Milet à Chios ou Abdère vers la mesure du cercle ou du cône et du cylindre et, si nous avons poursuivi notre odyssée, nous a conduits vers tous les ports de la carte, en reprenant par 1e commencement le temps de construction de ces objets idéaux transparents. Existe-t-il désormais une seule école dans le monde qui néglige d’apprendre aux enfants les mêmes éléments dans un même langage? Mathématique en grec ancien veut dire: ce qu’on enseigne ou qu’on apprend; où et quand ne l’enseigne-t-on pas? Iraniens, Espagnols, Français, Anglais, Tamouls, non avons tous parlé grec en disant parallélogramme, logarithme et topologie. Cette langue en ce système vit encore et nous unit. Rien ne reste de ces villes, ni de Cyrène ni de Pergé, rien ne demeure de ces écoles, ni d’Élée ni de Crotone, ni temple, ni arme, ni échange, ni atelier de production, mais la liste qui court des entiers aux sections coniques n’a pas pris une ride, même si parfois nous n’entendons pas sous les vocables de nombre ou de diagonale les mêmes choses que les anciens Grecs. Qui se moqua mieux de l’histoire et de ses fluctuations que le petit collectif qui, si vite, établit cette rubrique, unique dans le temps et résistant à son usure? Qui méprisa mieux les batailles que ce groupe d’irréconciliables ennemis forgeant une langue commune, la seule qui sache arrêter les conflits et qui n’ait jamais besoin de traduction? Tous les culturalismes du monde ne peuvent rien à cette communauté ou à l’universalité de cet enseignement. Nous sommes coupés de l’Antiquité par tous les chemins possibles; par les mathématiques, elle demeure notre contemporaine. Sans aucune étrangeté, puisque nous ne pouvons commettre aucun contresens sur elle.
Dur et doux
Thalès vint-il au pied des pyramides pour évaluer les conditions de la longue durée? Que faut-il faire pour demeurer? La guerre, le jeu mortel du plus fort, la tyrannie, les échanges, l’esclavage, les outils, la production, tout s’arrête et s’efface à quelque moment. Le plus fort n’est jamais assez fort pour avoir toujours le temps. La gigantesque masse de pierres se délite ou se recouvre de sable sous les vents et pourtant la tombe de Chéops maximisait toutes les données, stratégie, puissance et capital, religion, armement et fortune. Le volume, dont Bonaparte calcula que les moellons pourraient entourer la France d’une muraille haute et continue, n’accède pourtant point à la dimension du temps. Quel empire y parviendra? A l’époque de Thalès, le vieux pharaon était doublement mort, presque oublié. Le plus dur ne dure pas.
De même que d’autres cultures jouèrent, pour durer, non le vainqueur mais la victime, ainsi Thalès inverse le jeu du plus dur: seul perdure le plus doux. Toutes les matières et puissances s’usent, qu’adviendra-t-il de la forme pure? De l’image la plus évanouie, la moins concrète, la plus légère, la moins dicible possible? Dont l’écriture n’a aucune importance, dont même la trace peut se perdre sans dommage pour le sens, dont la mémoire même peut passer ou mourir sans inconvénient pour l’histoire? Dessinez-la faussement, il n’importe.
Ne la dessinez pas, ne l’écrivez même pas, qu’importe encore. Plus: détruisez sources ou témoignages, supprimez les monuments, brûlez manuscrits partiels ou bibliothèques entières, effacez presque entièrement la période où cette forme a vu le jour, elle demeure contre toute annulation, invariante dès lors qu’elle entra dans la rigueur, présente dans nos oublis. Même son concept branle sans gros dommage: nous n’entendons plus semblable raison ni la même similitude, cependant rien ne change notablement. Qu’il reste de la pyramide un déplacement dans l’espace des homothéties, théorème aussi fugace et doux qu’un rayon de Soleil muni de ses ombres et elle remplit enfin la dimension du temps.
En rapportant l’ombre du tombeau à celle d’un poteau de référence ou à la sienne propre, Thalès énonce l’invariance d’une même forme par variation de taille. Son théorème comporte donc la progression ou réduction infinies de la dimension dans la conservation d’un même rapport. Du colossal, la pyramide, au médiocre, piquet ou corps, et ainsi autant qu’on voudra, vers le petit, le théorème dit un logos ou rapport identique, l’invariance d’une même forme du modèle géant au modèle réduit, et réciproquement: quel mépris, soudain, de la hauteur et de la force, quelle estime de la petitesse, quel effacement de toute échelle ou hiérarchie, désormais dérisoire puisque chaque stade répète le même logos ou rapport sans aucun changement!
| Les pyramides de Gizeh. |
Diogène Laerce:
« Hiéronyme dit que Thalès mesura les pyramides d’après leur ombre, ayant observé le temps où notre propre ombre est égale à notre hauteur. »
Plutarque:
« La hauteur d’une pyramide est rapportée à la longueur de son ombre exactement comme la hauteur de n’importe quel objet vertical mesurable est rapportée à la longueur de son ombre à un même moment de la journée. »
Thalès démontre l’extraordinaire faiblesse du matériel le plus lourd jamais appareillé, ainsi que la toute-puissance, par rapport au temps qui passe, d’un certain logiciel: du logos lui-même à condition de le redéfinir, non plus comme parole ou dire, mais, en l’allégeant, comme rapport pareil; encore plus doux parce que les termes s’équilibrent, s’effacent l’un par l’autre de sorte qu’il ne demeure que leur pure et simple relation. Des restes maximaux du pouvoir maximal de l’histoire optimalement conservés, Thalès tire la douceur ou légèreté minimales. Même la mesure s’oublie dans le nouveau logos de la similitude où un rapport entre petits en égale un autre entre grands. Miracle: de moyens presque nuls naît le plus long des empires possibles qui se moque de l’histoire sans connaître la décadence. Nous commençons à peine à estimer pareille économie, corne d’abondance qui fournit infiniment à partir de presque rien.
Soleil et Terre
Toute l’aventure commença-t-elle par l’astronomie? Comment observait-on dans l’Antiquité?
L’aiguille du cadran solaire ou gnomon projette des ombres sur le sol ou le plan de lecture, selon les positions, au cours de l’année, des astres et du sol. Depuis Anaximandre, dit-on, les physiciens grecs savent reconnaître sur ces projections quelques événements du ciel. La lumière venue d’en haut écrit sur la terre ou la page un dessin dont l’allure imite, représente les formes et les places réelles de l’Univers, par l’intermédiaire de la pointe du stylet.
Comme nul, en ces temps, n’avait vraiment besoin d’horloge et que les heures variaient beaucoup, puisque les jours d’été ou d’hiver, quelles que soient leur longueur ou leur brièveté, invariablement se divisaient en douze, le cadran solaire servait peu à dire l’heure, de sorte que la montre ne l’a pas du tout remplacé, mais, en tant qu’instrument de recherche scientifique, montrait un modèle du monde, donnant la longueur de l’ombre à midi aux jours le plus long et le plus court et donc indiquant équinoxe, solstices et latitude du lieu, par exemple: plus observatoire, donc, qu’horloge. Nous ne savons vraiment pourquoi l’axe ou l’essieu se nomme gnomon, mais nous n’ignorons pas que ce mot désigne ce qui comprend, décide, juge, interprète ou distingue, règle qui permet de connaître. La construction du cadran solaire met en scène l’ombre et la lumière naturelles interceptées par cette règle, appareil de connaissance.
D’après un lieu d’Hérodote fréquemment cité, il semble que les Grecs héritèrent des Babyloniens le gnomon et la division du jour en douze parts: qui dira ce que la numération sexagésimale de ces derniers doit à leur divisions de l’année en trois cent soixante jours et qui dira l’inverse? Bref, chaque angle ou segment de trente degrés divise le ciel en zones que la langue grecque nomme zôdion de zôon, animal, et odos, voie, c’est-à-dire figurine de bête ou de tout autre être vivant; l’adjectif correspondant désigne l’orbite, la route, le chemin zodiaque. En retour le substantif dit les signes zodiaque. Le ciel se peuple de formes vives, point par point.
Remonter des ombres à la lumière qui les induit et de celle-ci à sa source unique, voilà une leçon de Platon, quand il parle de la connaissance. Il ne s’agit pas d’image poétique, mais du geste quotidien des astronomes, exactement leur méthode qui induit mille renseignements de la longueur et de la position de la trace ou marque obscure. Ils savaient construire dans cette optique une règle aussi précise que le style qui écrit. Le noir de l’encre sur la page blanche reflète la vieille ombre venue du Soleil par l’aiguille du gnomon. Cette pointe écrit toute seule sur le marbre ou sur le sable comme si le monde se connaissait soi-même.
Gnomon: aiguille ou axe du cadran solaire
Qui sait, qui connaît? Jamais l’Antiquité ne posa ces deux questions. Où placer la tête ou l’oeil, parmi cet observatoire? Dans la plage d’ombre, à la source lumineuse, à la place de la pointe du cadran? Voilà des problèmes modernes. Par exemple, l’usage de la lunette astronomique suppose qu’on ait inventé le sujet, qui va se placer du bon côté de la visée, contemplant, observant, calculant, ordonnant les planètes: il n’existe pas en langue grecque ancienne. En ce temps-là, le monde tel quel s’emplit de connaissance comme on dit que les cieux chantent la gloire de Dieu. Pour cette culture, le gnomon connaît: discerne, distingue, intercepte la lumière du Soleil, laisse des traces sur le sable comme s’il écrivait sur la page blanche, oui, comprend. Parmi l’espace extérieur et ses événements clairs ou noirs siègent la connaissance et le corps entier; la vie, le destin et le groupe sont plongés dans l’étendue ou dans le monde dont ils ne se distinguent pas. Celui-ci s’applique sur lui-même, se réfléchit dans le cadran et nous participons à cet événement ni plus ni moins qu’un piquet, puisque, debout, nous faisons aussi de l’ombre, ou que, scribes assis, le style à la main, nous laissons aussi des traces. La modernité commence quand cet espace mondial réel passe pour une scène et que cette scène, maîtrisée par un régisseur, se retourne comme un doigt de gant ou un schéma d’optique simple et plonge dans l’utopie d’un sujet connaissant, intérieur, intime. Ce trou noir absorbe le monde. Mais avant cette absorption, le monde comme tel reste le siège du connaître. Nous ne pouvons plus comprendre cette phrase, nous qui, de plus, détruisons ce que nous connaissons.
Remonter des ombres à la lumière et des images reproduites ou projetées à leur modele, voilà les leçons communes à l’astronomie grecque et à la théorie platonicienne de la connaissance. Que l’outil qui permet cette opération s’appelle dans la première, un gnomon, voilà qui nous aide à placer hardiment hors de nous le centre actif du savoir.
De plus, le firmament se peuple de formes vives, les signes du zodiaque. Si la lumière vient du Soleil, même quand il disparaît pendant la nuit, qui donc porte sur le dos des statues, en bois ou en pierre, de bêtes, sur le chemin haut placé du zodiaque, pour qu’elles se projettent, immenses, sur la paroi sombre du ciel? La caverne platonicienne décrit le monde lui-même. Nous ne saurons jamais si Platon a perçu d’abord sur la voûte étoilée au-dessus de sa tête l’Ours ou le Chien, avant de concevoir dans sa philosophie le ciel intelligible des formes précédant ou conditionnant l’intelligence des choses du monde, mais nous voyons assurément que les apparences des constellations se réduisent à des ensembles de points. Nul n’a jamais vraiment vu ici ou là Balance ou Bélier mais tout simplement un simplexe: jamais une image continue et floue, mais des clous juxtaposés. Comme si les modèles célestes restaient fidèles à la théorie des pythagoriciens pour lesquels toutes choses sont nombres. Mais d’où sortent ces statues qui font des ombres scintillantes sur le ciel noir?
Machine et mémoire
Nous avons du mal à traduire le mot gnomon parce qu’il vibre d’harmoniques autour de la chose qu’il désigne et que la connaissance scintille à la pointe de son axe.
Littéralement, il signifie, sous une forme apparemment active: qui discerne, qui règle, mais désigne toujours un objet. Dans son commentaire à la deuxième définition du second livre d’Euclide, Thomas L. Heath le décrit comme « a thing enabling something to be known, observed or verified », une chose permettant à quelque chose d’être connu, observé ou vérifié. Le voisinage de ces deux choses ou leur répétition a du sens: elles ont rapport entre elles, toutes seules. En cette chose ou par elle, au lieu qu’elle occupe, le monde montre la connaissance.
Comme l’axe du cadran se dressait perpendiculaire à son plan, l’expression « à la manière du gnomon » exprimait chez les Grecs, à une période archaïque, l’angle droit ou le fil à plomb. Du coup, nous pourrions presque le traduire par règle ou équerre, d’autant qu’Euclide, au lieu indiqué, appelle gnomon les aires des parallélogrammes complémentaires d’un parallélogramme donné, de sorte que leur addition ou soustraction les laissent ensemble semblables entre eux. Ainsi, une équerre montre deux rectangles ou deux carrés complémentaires d’un carré ou rectangle donné: le mot français lui-même semble signifier l’extraction du carré ou cadran.
Encore un coup, comment décrire le gnomon? Comme un objet, une tige dont le placement convenable donne des résultats étonnants, latitude, solstice, équinoxe. Qu’il fournit automatiquement. Cela veut dire qu’il marche tout seul, sans aucune intervention humaine, comme un automate, sans sujet moteur: connaissance machinale, puisqu’elle intercepte un mouvement, celui du Soleil. Préférons ici machine à instrument, tant, pour nous, l’outil fait référence au sujet qui l’utilise ou à l’action volontaire et finalisée pour laquelle celui-ci l’a conçu et fabriqué. Au contraire, l’activité mentale que désigne le mot gnomon, en grec, se réfère ici à la machine, à un objet. Le gnomon réalise l’une des premières connaissances automatiques de l’histoire, la première machinerie unissant du matériel à des logiciels. Le rôle du sujet, sa fonction connaissante ou pensante, n’ont rien de commun ici, avec ceux qu’ils prendront dans ce que nous nommons jusqu’à aujourd’hui, la connaissance scientifique.
Le calcul des latitudes d’après l’ombre du Soleil aux solstices et aux équinoxes, première liaison mathématique entre l’astronomie et la géographie, donna lieu, d’autre part, à l’établissement, par Ptolémée ou avant par Hipparque, de ce que l’Antiquité appela des tables de cordes: longues listes des rapports entre la mesure des côtés de triangles rectangles et celle de leurs angles, où on peut lire la naissante trigonométrie. Voici la mémoire, voilà le gnomon: à la machine correspond la table, à la connaissance automatique s’associe la mnémotechnie. De même, dans la science des Babyloniens, coexistent les procédures automatiques de calcul et les tables de mesures. Autrement dit et plus généralement, une pensée algorithmique montre toujours deux composantes, l’une qu’on peut dire machinale et l’autre qu’on doit appeler mnémonique. Capitalisation ou récapitulation des résultats des procédures machinales ou conditions de leur reconduction. L’automate et les tables ou les dictionnaires. Matériel et logiciels.
|
Le profil de l’Univers
Le gnomon ou cadran solaire sert moins à dire l’heure dont tout le monde se moque depuis l’Antiquité jusqu’à nos grands-parents, qu’à construire un modèle géométrique de l’Univers: observatoire à la fois et schéma cosmographique du monde. AB figure le style du gnomon, BC mesure l’ombre que fait le Soleil à midi au solstice d’été, BZ celle du solstice d’hiver, BD l’ombre équinoxiale. Les droites et le cercle se dessinent alors sur le méridien et le définissent, la ligne FG représente l’horizon et le point A la Terre flottant au centre de la sphère du monde. Dés lors, les deux lignes MJ et KH suivent les tropiques et LI l’équateur, comme NO perpendiculaire à celui-ci, l’axe du monde. L’angle ENO égal à BAD donne exactement la latitude du lieu et l’angle DAE, égal à DAC, l’inclinaison de l’écliptique, estimée à 24°, c’est-à-dire au segment circulaire intercepté par le côté du pentédécagone régulier. L’ensemble de ces informations, découvertes successivement d’Anaximandre à Vitruve (architecte romain du 1er siècle av. J.-C.) et de Pythéas de Marseille (navigateur et géographe grec du IVe siècle av. J.-C.) jusqu’à Ptolémée en passant par Hipparque, remonte pour une grande part à une très haute Antiquité. Thalès écrivit deux livres sur les équinoxes et les solstices, OEnopide a sans doute donné l’estimation à 24° de l’inclinaison de l’écliptique. Il faut lire le schéma comme un profil du monde tel que les savants grecs le concevait mais aussi comme une somme de l’histoire de leur science: chaque génération depuis le Ve siècle en a au moins une ligne. Pour donner une idée plus exacte des performances que les Grecs tiraient du gnomon, voici comment calcule Ératosthène (276-195 av. J.-C.). Il en pose un à Syène en Égypte non loin de la première cataracte du Nil, ville située sur le tropique du Cancer. En ce lieu, il ne fait pas d’ombre à midi le jour du solstice d’été. Le même jour à la même heure, Ératosthène mesure l’angle que fait le Soleil avec un second gnomon posé dans la ville d’Alexandrie qu’il pensait située sur le même méridien. Les deux angles alternes-internes sur la figure sont égaux, or celui qu’il a mesuré vaut la cinquantième partie d’un cercle, il suffit donc de multiplier par cinquante la distance d’Alexandrie à Syène pour obtenir la longueur entière du méridien terrestre. Résultat grandiose obtenu avec des moyens minimaux. Pour améliorer la mesure, Ératosthène estime l’ombre du gnomon non point projetée sur un plan, mais sur une sphère ou peut-être le polos dont parle Hérodote dans le lieu déjà cité. |
Anthyphérésie ou algorithme d’Euclide (procédure) |
PGCD. Soit deux nombres 20 et 12. A diviser le premier par le second, il reste 8; si on divise 12 par 8, il reste 4 et si, de nouveau, on divise 8 par 4, l’opération, tombant juste, ne laisse pas de reste. On dit alors que 4 divise à la fois 20 et 12 au titre de leur plus grand commun diviseur.
Pour le trouver, on a divisé l’un par l’autre les deux nombres et le second par le reste de leur division, ensuite celui-ci par le second reste, le troisième par le second et ainsi de suite jusqu’à ne plus trouver aucun reste. On appelle PGCD le dernier nombre de la suite.
Euclide. Éléments.
L’anthyphérésie consiste en une soustraction qui retranche la plus petite de deux grandeurs de la plus grande et confronte la plus petite avec le reste et ainsi de suite.
« VII, 1: deux nombres inégaux étant proposés, le plus petit étant toujours retranché du plus grand, si le reste ne mesure celui qui est avant lui que lorsqu’on aura pris l’unité, les nombres proposés seront premiers entre eux. »
« X, 2: étant donné deux grandeurs inégales et la plus petite étant retranchée de la plus grande, si le reste ne mesure jamais le reste précédent, ces deux grandeurs seront incommensurables. »
Musique (table ou machine)
Arpad Szabo décrit dans lesDébuts des mathématiques grecques la Sectio canonisattribuée à Euclide.
La corde entière est partagée pour produire la quarte ou la quinte. On retranche alors le petit segment du grand. On retranche le reste du petit segment. On pouvait opérer cette soustraction deux fois pour la quinte et trois fois pour la quarte (2/3 et 3/4). Ainsi après avoir retranché le plus petit segment du plus grand, on retranchait le reste du plus petit jusqu’à disparition finale de tout reste.
Voilà, selon lui, l’origine de l’algorithme d’Euclide.
Une autre raison?
Toute la connaissance annoncée par le mot gnomon et accumulée autour de sa tige, tout ce savoir objectal et tabulaire, se distinguent fortement de ceux que nous groupons classiquement autour de la démonstration ou de la déduction, pour les mathématiques, et de l’expérience, en ce qui concerne la physique selon les critères de rigueur et d’exactitude, ainsi qu’autour du sujet, personnel ou collectif. Il y a là un autre logos, une épistémé différente, bref, une autre raison que nous aimerions nommer algorithmique. La pensée algorithmique, efficace et présente chez les Égyptiens et les Babyloniens, coexiste en Grèce ancienne avec la nouvelle géométrie, quoique dissimulée sous sa transparence ainsi cachée par la mathématique officielle, hellène de tradition, elle va perdurer, féconde, pendant de nombreux siècles, avant d’acquérir, de nos jours, un statut parallèle à celui de la première.
Une astronomie sans oeil
Un entendement formé aux sciences modernes s’étonne de ce qu’il ait pu exister si anciennement une astronomie sans vue ni regard comme la contemporaine. Si le cadran solaire ne fonctionna presque jamais comme une horloge, si nous devons plutôt le voir comme un observatoire, ce mot même, anachronique et mal choisi, nous tromperait. Le gnomon précède aussi peu le théodolite que le cadran ne pressent la montre. Car l’astronome grec n’observe pas comme le firent les âges classique et moderne où les coupoles se construisent autour des lunettes et des télescopes. L’acte de voir n’y a pas le même lieu et ne prend pas la même place dans celui de connaître.
Nous avons l’habitude d’interpréter la connaissance comme un doublet de sensation et de formalités abstraites et les philosophes répètent volontiers comme des perroquets qu’il n’y a rien dans l’entendement qui n’ait d’abord été dans les sens. Cela suppose un sujet, puis un corps et tout un entraînement qui a aiguisé la sensation au moyen d’un matériel raffiné. Ici et en ces temps, le gnomon et le plan de projection reçoivent seuls l’information, non l’il. Le récepteur objectif, axe et marques, laissera sa place au corps sensible, mais l’occupe d’abord. Lorsqu’ils relatent l’histoire de Thalès venu au pied de pyramides pour en mesurer la hauteur, les historiens ou doxopraphes grecs confondent significativement l’ombre d’un piquet quelconque et celle d’un corps: qu’il s’agisse du bâtiment formidable, du bâton ou de celui dont nous pensions qu’il observait, qu’importe, chacun à sa manière, pierre, bois ou chair, assure le rôle canonique du gnomon, la fonction de discerner, objective. Science sans sujet, science qui se passe du sensible ou qui ne passe pas par lui. Mettez un bâton à sa place et rien ne changera, construisez un tombeau de pierre au lieu où il se décompose, cadavre, et le savoir demeure, invariant. Qu’on puisse voir là de la lumière, des ombres et leur partage, toute une scène sensorielle, qui en doutera, mais rien ne transite d’elle à travers un sujet, porteur de facultés, filtrée ou non par une théorie ou aboutissant à sa construction. Dans le diagramme du Soleil, à la source claire, des rayons, de l’essieu et de l’écriture au sol, il n’y a pas de place pour l’il, ni de site qu’on puisse nommer point de vue. Et cependant la théorie s’y montre. La mesure exacte ou approximative, rigoureuse parfois, la réduction abstraite, le passage savant du volume au plan méridien et de celui-ci à la ligne et de celle-ci au point, le modèle géomètre du monde se dessinent là sans qu’ici interviennent des organes, des fondions ni des facultés. Le monde se donne à voir au monde qui le voit: voilà le sens du mot théorie. Mieux: une chose – le gnomon – intervient dans le monde pour que celui-ci puisse lire sur soi-même l’écriture qu’il trace sur soi. Poche ou pli de connaissance.
Au sens littéral, le gnomon est intelligent puisqu’il met ensemble des situations choisies entre mille autres et donc discerne et comprend. Récepteur passif, il voit la lumière, actif, il écrit sur la page la lisière d’ombre, théorique, il montre le modèle du ciel. Pour que nous accédions de nouveau, nous autres contemporains de nouveau avertis d’elle, à cette science automatique, oui, à cette intelligence artificielle, nous devons oublier les préjugés philosophiques de l’intermède moderne: l’homme au centre du monde, à la place du gnomon, le sujet au milieu de la connaissance, son récepteur et son moteur universels, plus la reconstruction imaginaire en son intimité noire où nul jamais n’entra, sauf quelques philosophes transcendantaux munis d’un mythique rameau d’or, de cette même scène d’ombre et de lumière qu’ils reproduisirent à partir d’un oeil réel vers le filtre d’un légendaire entendement. Au fond rien de plus facile que de laisser cette faculté compliquée pour lire simplement ce que le Soleil écrit sur le sol.
Le gnomon n’est pas un outil au sens d’un bâton tenu par un singe qui ainsi prolonge sa mainmise ni au sens d’une loupe qui grossit l’objectif et augmente les performances de l’il. L’artifice ne se réfère pas au sujet, orienté par lui, mais il demeure objet parmi les objets, entre le Soleil et le sol eux-mêmes, chose rendue intelligente par sa place en un lieu singulier du monde qui passe par elle pour se réfléchir sur soi. Par le gnomon l’Univers pense auto kath’auto, se connaît lui-même par lui-même.
L’idéalité mathématique naissante jamais ne se référa en Grèce à un sujet pensant ni ne se pensa par un idéalisme. Au contraire, la pensée la plus prégnante resta le réalisme. Or le réalisme des idéalités, savoir la forme chose ou la chose forme, se montre au pied du gnomon dans la scène où les choses voient les choses. Le point, la ligne, l’angle, la surface, le cercle, le triangle, le carré… naissent là comme formes idéales dans la ténèbre et la clarté, au milieu des choses mêmes, dans le monde tel quel, réels comme les rayons de lumière, les franges d’ombre, mais surtout leurs bords communs.
Tables ou listes canoniques
Que se correspondent des tables de nombres et un instrument d’observation d’où on les tire ou sur lequel on les retrouve, un historien des sciences ne peut s’en étonner, habitué, en quelque manière, qu’une science commence en cet état: par exemple, la lunette astronomique indique mille positions d’autant d’astres et un registre les recueille. Bien venue, mais tardive, une théorie compréhensive rend désuet cet état: ainsi, les lois de Kepler et de Newton effacent en une phrase ce fatras puisqu’à partir d’elle n’importe qui retrouve à l’instant, comme application numérique, tel détail local.
Un espoir identique mobilise les chimistes du siècle dernier que leur matériel amène expérimentalement à dresser des tables de corps dont ils se prennent à rêver, comme des astronomes, qu’une loi générale les gomme en les comprenant d’un coup. Cette coexistence de listes, tables ou rubriques, et d’un appareillage, simple ou compliqué, nous paraît caractériser une ère préthéorique, où l’observation l’emporterait sur les lois, dans l’attente de l’induction à venir.
|
Tables alphonsines ou tolédanes Entreprises sur l’ordre d’Alphonse X le Sage (1221-1284), roi de Castille et de Leon, elles furent exécutées par un groupe d’astronomes, sous la direction d’Isaac ben Saïd, achevées en 1252 et imprimées continûment jusqu’au XVIe siècle. |
Quand nous voyons coexister, dans l’Antiquité, les tables de cordes qui donnent les valeurs d’un arc ou d’un angle à partir des mesures des côtés d’un triangle et cet instrument d’observation que les Grecs appelaient gnomon, nous conservons dans l’esprit le schéma historique induit par l’arrivée de Newton ou de Kepler parmi les tables alphonsines ou tolédanes recueillant la position des astres. Nous percevons alors la figure d’un savoir expérimental qui associe un instrument et des tables de nombres dans l’attente d’une théorie dont la puissance unitaire rend désuets le premier en même temps que les secondes. Par ce schéma, nous comprenons la situation antique et elle s’y plie évidemment. Voici le gnomon: il précède le télescope; voilà les tables de cordes: elles ressemblent aux tables tolédanes. L’ensemble constitue une préastronomie prémoderne en attente de la théorie trigonométrique.
Or nous venons de contracter une nouvelle habitude en voyant coexister une machine et sa mémoire, un instrument automatique et des programmes. Même schémas d’une certaine manière, mais tout autre cependant puisque nous n’attendons pas une loi théorique dont la compréhension globale annulerait d’un trait de plume nos logiciels et leur rapport au matériel. Il s’agit d’une manière de savoir authentique et originale et non d’un présavoir ou d’un état précédant le savoir, il s’agit d’une connaissance et non de son fonctionnement incomplet. L’astronomie grecque fournit plutôt un exemple du deuxième modèle qu’un paradigme du premier.
Géométrie
Parvenu au pied des pyramides, Thalès, mais qu’importe son nom, démontre la similitude des triangles formés, le premier par Chéops et son ombre, mais qu’importe le tombeau choisi parmi les trois semblables et le nom du pharaon qui gît ici, le second par un piquet planté là et sa noire moitié. Une légende cite ce bâton alors qu’une autre désigne l’ombre portée par le géomètre debout. Que préférer, du corps ou du pieu? Les angles sont égaux et les côtés proportionnels. La même raison fait se répondre la pyramide et les deux éléments érigés, raison identique mais dicible en trois énoncés.
Premièrement, ou plutôt, en fin de compte, elle définit l’homothétie, à la lettre, une même façon d’être là, de se poser, ou mieux, un espace de transports, déplacements avec ou sans rotations. Voilà l’énoncé de science rigoureuse, lisible désormais en cette histoire qui relate les mesures de Thalès au cours de son voyage.
Deuxièmement, ou plutôt moyennement, elle exprime ce fait patent que chacune de ces fiches droites, normales sur l’horizon, peut passer pour un gnomon: le moment de midi rapporté par l’une des légendes marque la fonction principale du cadran solaire de fixer le méridien et, sur lui, les solstices et les équinoxes, moments solennels où l’ombre s’allonge vers ses extrema. Thalès, dit-on, avait écrit deux livres sur eux. Pour accomplir cette fonction, la pyramide équivaut ici à l’essieu ou au bâton fiché là qui équivaut à son tour à ce passant immobile, figé dans la contemplation de la lumière apicale: tous des gnomons. Et le tombeau porte un puits funéraire qui vise l’absence d’étoile qui, dans le ciel, marque le nord. Cet énoncé moyen disant la ressemblance ou la similitude ou mieux l’homothétie au sens littéral de tout ce qui peut servir de tige ou d’axe à un tel observatoire, il faut l’appeler historique, parce qu’il raconte l’astronomie des Ioniens et leurs premiers modèles du monde, ainsi que ce qui s’ensuit géométriquement. Sans doute, l’équivalence des gnomons de hauteur variable entraîne l’homothétie des triangles associés pour un même monde stable, selon l’énoncé de géométrie canonique, sans doute les droites de celle-ci viennent des rayons solaires de ceux-là ou de leurs bords aveugles d’ombre, et les cercles des orbites et les points sans dimension des marques impalpables aux solstices ou aux équinoxes: le miracle grec tombe et descend du ciel, la vieille question de l’origine de la géométrie se résout en ce passage lumineux et noir des astres à cet axe, dont le nom dit qu’il connaît.
| Apex: point du ciel vers lequel semble s’avancer le Soleil.Similitude: comparer le mot grec signifiant la science, et le mot de sa famille qui signifie le cippe funéraire, planté verticalement sur la tombe. |
Mais troisièmement ou plutôt d’abord et archaïquement, la méditation anthropologique lentement conduite dans Statues rend cohérente et pensable, sans le firmament et avant la géométrie, une similitude fondamentale entre le tombeau et sa momie de pharaon, le corps vivant érigé, mi-obscur et mi-clair, et le piquet planté en ce site défini. Marquages par la mort et par ce qui en sort, du lieu singulier, de l’être-là, repères par la fiche et l’hermès qui se dresse aux limites, voici trois statues, au sens que ce livre a donné à ce mot, trois bornes exactement homothétiques, c’est-à-dire mêmement posées-là, momies, corps vivant, cairn, obélisque ou menhir, staff ou stock, assumant la même fonction de désigner un gisement, sépulture, habitat ou frontière – oh! miracle! de tracer bientôt, grâce au Soleil, de ce lieu l’exacte latitude. Cet énoncé dépasse l’histoire et fonde l’énoncé de science, car il dit la même chose dans une autre langue. L’énoncé moyen d’astronomie dit la même chose dans la même langue, métrique, exacte, précise, quasi formelle et la géométrie s’y trouve déjà née, comme embryonnaire. Mais le troisième ou premier, le plus enfoui et originel, découvrant trois statues en ces trois corps apparemment dissemblables, fait voir la rigoureuse homothétie au sens littéral de ces trois témoins locaux et mortuaires, de ces trois marqueurs de gisement, et la dit dans une langue primordiale si pleine d’ombres que tout notre effort de pensée depuis l’origine de la géométrie n’a pas suffi à la retrouver, retraduire ou déchiffrer, derrière la lumière des théorèmes. Or cette clarté aveuglante sort de cette obscurité comme les statues ressuscitent de la terre, de cette terre première et fondamentale que répète sans le savoir depuis plus de deux millénaires le mot géométrie. Le sol bouleversé par la crue du Nil revient de même au chaos et aux premières ténèbres d’où la mesure le rend à la clarté. Celles-là n’empêchent pas celle-ci d’apparaître, mais toujours la lumière interdit qu’on voie jamais l’obscurité. La géométrie rayonne tant qu’elle nous éblouit et donc cache sa matrice noire. Oui, elle tombe et descend du ciel, par l’histoire aisée de l’astronomie, chute et cathode simple et facile; mais elle monte de la terre, anabase et procession, sort du tombeau, de la caverne où danse l’ombre des statues, ressuscite d’entre les morts. Toujours prêtes à rire et à éclater en moqueries plaisantes, les paysannes thraces de la fable savent que l’observateur des astres tombe dans le puits: nous apprenons par elles que la place de Thalès cède sous ses pas comme une sape. Oui, la géométrie porte justement le nom de sa mère la terre sur laquelle ce qui tombe du ciel se mesure. Jalonnée à l’aide du gnomon, elle demeure à l’ombre comme un fondement, comme une fondation creusée sous la science; ci repose la momie, en des entrailles noires où se fiche le piquet d’où monte le savoir.
L’énoncé géométrique se développe dans le temps, nouveau, moderne, du savoir scientifique; l’énoncé astronomique se relate dans le temps de l’histoire des sciences qui naît avant le début de la géométrie; l’énoncé statuaire se dit dans le temps de l’anthropologie ou celui des fondations qui supporte les deux autres.
Chaque signe semblable, disposé en forme coudée, compte les nombres impairs qu’il faut ajouter successivement pour construire un nouveau carré. On retrouve sur les nombres les bandes d’équerre.
| Cathode: en grec et littéralement chemin qui va de haut en bas, descente.Anabase: en grec et littéralement, mouvement de bas en haut, ascension. Mot consacré par une expédition militaire célèbre de Cyrus le Jeune, racontée par Xénophon. |
Artifices
Euclide appelle gnomon ce complément coudé d’un carré que les charpentiers nomment communément une équerre, mot de métier qui décrit à merveille l’extraction d’un carré au beau milieu de son angle droit en creux. Que celui-ci quitte la normale et s’infléchisse vers l’aigu ou l’obtus, le parallélogramme intérieur reste semblable à l’extérieur, obtenu en ajoutant au premier le gnomon: bande ou couronne autour d’une forme qui ainsi se reproduit autant qu’on veut.
On comprendra l’arithmétique géométrique des pythagoriciens lorsqu’on saura qu’ils appelaient gnomon le complément exprimé en nombres impairs des nombres carrés successifs. Loin d’écrire comme nous cette situation:
12+3 =22
22+5=32
32+7=42…
n2+(2n+1)=(n+1) 2
ils la dessinaient comme on le voit ci-contre et comme un simplexe ou des étoiles dans le ciel.
Cela reproduit, sans différence notable, la définition d’Euclide: les nombres impairs font l’équerre autour du carré intérieur et reproduisent avec lui, indéfiniment, un carré extérieur évidemment semblable au premier. Avec des schémas où l’angle droit fléchit, on peut ainsi produire des nombres triangulaires, pentagonaux… en général polygonaux. Théon de Smyrne les appelle nombres gnomoniques. Nous accédons par ces procédures à des dispositions qui annoncent le triangle de Pascal.
Axe du cadran solaire, le gnomon devient une équerre: instrument ou artefact dans les deux cas. Le premier dessine sur le sable quelques stations du Soleil alors qu’une règle, ainsi nommée du latin rectus, angle droit ou ligne droite, comme l’équerre, peut les décrire sur une page. On définira la géométrie comme science qui ne se permet que la règle et le compas. Que penser du statut, de la place et de la fonction de ces artefacts dans un savoir parfaitement pur? Deuxièmement, équerre ou gnomon, bandes latérales coudées, formes complémentaires à deux côtés, agrandissent ou réduisent, reproduisent à loisir carré ou parallélogramme, en laissant sauve la similitude. On peut retourné l’histoire de Thalès dans les deux sens: le gnomon solaire lui fait découvrir l’homothétie ou bien par l’homothétie, la croissance gnomonique fait passer du piquet, modèle réduit, à la pyramide géante. Enfin, le gnomon aligne des suites de nombres. Comment le définir sinon comme une loi de série? Ajoutez un impair, faites la somme des impairs, vous obtiendrez les carrés successifs. Ou bien: juxtaposez la bande complémentaire, le parallélogramme semblable apparaîtra. Le gnomon se définit comme une loi de construction, comme la règle d’une suite ou son engendrement. Règle automatique, marchant toute seule, inscrivant la chaîne à loisir ou chaque chaînon sans que nous intervenions. Cette opération se passe de sujet actif ou pensant, de même que l’axe de l’essieu écrit sur le sol en notre absence.
| Triangle de Pascal 1 11 121 1331 14641 15101051 etc… |
Tout le monde reconnaît deux sortes d’artefacts: ceux qui ne dépendent pas de nous et ceux qui en dépendent. Les premiers seuls fonctionnent sans trêve ou, mieux, ne cessent jamais d’être des artefacts. Exemples: le mur et le toit nous protègent toujours, même quand nous dormons, mais quand nous laissons la bêche et la plume, elles dorment, inutiles et anéanties; intelligentes exclusivement à nos heures extatiques. Au fond, les vrais outils ne dépendent pas de nous, les autres se reposent trop souvent pour avoir droit authentiquement à ce titre. Appeler donc d’un nom identique, exprimant la connaissance, trois automatismes, celui du piquet dressé vers le Soleil, celui de l’équerre ou de la bande latérale qu’on ajoute ou retranche et celui de l’opération dont le retour itéré construit des séries de nombres, nous ramène à l’intelligence artificielle. Dont nous voyons les avatars, le devenir en ces trois états: d’abord chose, pieu ou axe, outil spéculatif, ensuite règle propre à reproduire à loisir droites, angles, polygones idéaux, extraits ou, mieux, abstraits de cette règle, enfin opération formelle sur des nombres, règle automatique, algorithme.
Perpendiculaire et automate
Selon le gnomon, disaient les Anciens: cela voulait dire verticalement. Nous traduisons: perpendiculairement, car ce mot, dans nos langues et pratiques, se réfère au fil à plomb, ce cordeau que les Grecs appelaient stathmè. Ici, l’appareillage du maçon se dit d’un mot dont la racine désigne la stabilité, l’équilibre, comme celle du mot épistémè, la science elle-même. En cet objet, cet artefact, se réunissent, pour une cohérence et un concours admirables, l’origine statique de la géométrie que j’avais retrouvée en relisant les Définitions d’Euclide, dans le Passage du Nord-Ouest, et sa fondation statuaire: l’épistémologie et l’anthropologie, la linguistique et l’histoire. Non plus seulement la terre et le ciel, mais le savoir et la chose. Ténèbres et clarté, les énoncés les plus idéaux, abstraits ou formels et les plus charnellement humains conspirent à merveille en ce simple et facile fil à plomb. Stable pour la mécanique, masse ou pierre lourde et dense, statue droite pointée vers la terre basse, règle fine qui dessine sur le parement une ligne presque parfaite pourvu qu’on la teigne de couleur liquide (elle écrit donc comme le gnomon), cette chose jamais ne trompe et marche automatiquement.
Selon le fil à plomb: perpendiculairement. Soit à repenser ou soupeser ce dernier adverbe que nous employons à l’étourdie. Quoi? Le gnomon, vertical, signifie à la fois intelligence et artefact? Mais la perpendiculaire aussi. Certes, elle pend comme le cordeau du maçon et pèse de même que son plomb, jouit bien sûr de la plus grande pente tout autant que l’attache des plateaux d’une balance, suspendue comme un pendule: mais elle pense. Le verbe penser ne connaît pas d’autre origine que peser, pendre ou pente. Que nous nous évertuions à tisser le lien du sens propre et dur au sens figuré, très doux, par l’évaluation ou l’estime, la décision sur la pesette concernant la teneur en or d’une pièce ou d’un lingot, voire l’inquiétude proche de la crainte ou de l’attente, la référence reste la balance, le pendule, toujours le fil à plomb ou stathmè: oui, la perpendiculaire pense, ou plutôt, le gnomon entretient avec la connaissance le même lien ou rapport, la même raison que la perpendiculaire avec la pensée. L’intelligence artificielle ne date pas d’hier. Dès l’origine de la science, il existe des choses, ou des états de choses que l’histoire de nos langues associe aux activités mentales, comme si ces artefacts, gnomon, fil à plomb, règle ou compas, équerre, passaient pour les sujets de la pensée.
Cela ne revient pas à redire la théorie pragmatiste de l’origine des sciences pures d’après laquelle la pratique précède constamment le savoir, les choses construites de main d’homme détenant ou contenant le secret des spéculations abstraites à venir, comme si la suite et le système des théorèmes déployaient, mimaient, sublimaient, réordonnaient une histoire préalable et obscure d’actes et de gestes: des faits, avant le droit; des ancêtres, adroits mais grossiers, faisaient sans savoir. Nous ne falsifierons ni ne vérifierons jamais ces jugements sur le passé, faux et vrai à loisir comme toute loi de l’histoire, le malheur ayant poussé à fonder l’éducation sur un arbitraire pareil. Rien ne prouvera ni n’infirmera jamais le pragmatisme, théorie de professeurs qui croient qu’inventer consiste à recopier excellemment un texte écrit par des mains calleuses ou que la découverte se réduit à l’interprétation. Non, la théorie ne se ramène point toujours à l’explication de ce qu’implique le travail manuel. Oui parfois, souvent non. Mille manipulations n’amènent à la rigueur que celui qui l’a déjà trouvée. Mais qu’importe. De profonds linguistes prétendent que le mot populaire « baratin » émane aussi de la pratique ou du verbe grec correspondant à notre verbe faire, puisque le discours favori des intellectuels consiste à exalter l’action, dont ils se gardent, au détriment de l’abstraction; dont ils ne se séparent jamais. Le comble du baratin consiste à parler de faire alors qu’on disserte seulement. Bref.
Que nos langues donc nous ramènent, pour la connaissance, à des artefacts aussi primitifs et simples que le fil à plomb ou le gnomon indique seulement que le sujet humain de la pensée date d’une époque récente: l’intelligence artificielle est plus ancienne que l’intelligence tout court, conçue comme une faculté de l’esprit, elle-même se réduisant, le mot l’indique expressément, à une possibilité de faire. Le je pense a trois cents ans alors que le gnomon dit qu’il connaît depuis plus de trois millénaires. Et je trouve plus difficile de concevoir une instance virtuelle, interne à l’individu, condition transcendantale des opérations intellectuelles, que de voir le cordeau ou l’axe du cadran écrire automatiquement.
Nous employons ce dernier adverbe à l’étourdie. Pour nous, un automatisme s’accomplit sans que la volonté ou l’intention y participe. Or toute la familles dont ce mot fait partie se réfère à une racine indo-européenne – men – où, au contraire, se retrouve l’activité mentale: véhément, dément, commentaire, mention, mensonge, mémoire, monument, monstre, démonstration, montre, monnaie se rangent dans le sous-ensemble latin issu de la racine, alors que les mots anamnèse, manie et automate appartiennent au cousinage grec. Nous disons avec un mot d’entendement une chose dont nous voudrions qu’elle en fût dépourvue. Il suffit, dans la famille, de rapprocher quelques parents pour obtenir de beaux effets de sens. Exemple: comme une montre, l’automate commente ou démontre grâce à sa mémoire et mime monstrueusement les actes mentaux; voici une phrase qui semble méditer ou décider sur les questions en apparence hardies que nous posons à propos de l’intelligence artificielle alors qu’elle se réduit, aux yeux et à l’oreille de l’artisan de la langue, à la répétition monotone de la même unité de sens, à une sorte de tautologie ou plutôt de redondance. Le cadran solaire lui doit sans doute sa comparaison avec nos montres. Il y a beau temps que nos langues savent que les automates pensent, au moins le disaient-elles avant même que les Grecs, Arabes et modernes ou classiques montassent des statues mobiles, pour l’ornement ou le tourment des contemporains.
|
Extatique: au sens étymologique, caractérise un état hors du repos.Comparer baratin et [mot grec signifiant], agir, travailler, d’où vient notre pratique.
|
En somme, l’automate entretient avec l’activité mentale la même relation que le gnomon avec la connaissance, que la perpendiculaire ou le pendule avec la pensée ou que le stathmè, fil à plomb, avec l’épistémè, la statue stable avec l’épistémologie. Science droite, pensée, connaissance, mémoire, actes mentaux, démence ou manie… la philosophie que nous avons apprise nous induit à les distribuer, comme des facultés, fonctionnant bien ou mal, autour d’un sujet transcendantal, case par case ou en couronne, mais la langue qui écrit ou parle cette philosophie depuis quelques millénaires les ramène à leurs lieux d’origine, l’essieu du cadran solaire, l’équerre, le cordeau et la balance… comme si elle décrivait une intelligence objectale. S’il existe une règle pour la direction de l’esprit, ou plusieurs, et si la langue note quelque redondance encore entre l’orientation que cet esprit doit suivre et la chose qui l’indique, puisque règle et direction répètent le latin rectus qui signifie la ligne droite, alors le sujet, en tierce position, ne fait qu’imiter une forme objective. L’esprit, premièrement, réside-t-il déjà en celle-ci? Et pourquoi résister au plaisir raffiné de dégager l’étymologie, fort scientifique, de poêle: mot issu du latin balnea pensilia, bains suspendus. Que faire en un poêle, sinon dire que je pense?
Les philosophies qui aujourd’hui s’enseignent dans les classes d’où les leçons de choses ont disparu, plaçant le sujet dans le langage, pour que seuls ceux qui pérorent acquièrent un statut noble, s’arrêtent, timides, à mi-chemin de ce retour vers les objets du monde, puisque le langage habite en nous, bouche, gorge et gestes du corps, et hors de nous, dans les bibliothèques et sémaphores, bandes sonores et récepteurs radio: interne-externe, artificiel et naturel, sans qu’on puisse décider. Le sujet, là, hésite entre un quasi-sujet, de la culture collective à l’inconscient personnel, et un quasi-objet, des livres aux codes: mais que signifie une phrase pareille où un mot, sujet, glisse et ne peut pas se poser entre son propre sens et son contresens?
Construit par nous qui nous trouvons construits par lui, collectivement et dans le temps d’une histoire longue, usité par nous, individuellement et dans les groupes, le langage, exercé dans l’usage quotidien ou l’expérience rare et stylisée, nous apprend immédiatement qu’il se comporte comme un artefact qui pense. Son artisan souvent se trouve conduit par lui. En d’autres termes, il fait partie de l’intelligence artificielle, comme la monnaie.
Matière et forme
Gnomon vertical, équerre coudée, règle, compas, perpendiculaire, pendule affectent une forme constante: droite verticale, ou horizontale dans le cas de la balance, normale ou ronde, selon. Forme signifie aussi bien contour, figure, bords, définition et détermination au sens littéral que principe d’organisation de l’objet. L’angle droit décrit aussi bien l’apparence de l’équerre que son squelette constitutif, sa construction. Ainsi la forme peut passer pour phénomène et pour essence, l’aspect ou la réalité. Que pierre, marbre, fer ou bronze entrent dans l’axe ou le cadran au titre de matière première, qu’importe, pourvu qu’il se dresse normalement au plain du sol. L’information qu’il montre ou donne correspond à sa forme et varie avec elle. Selon celle-ci, la première s’altère. La connaissance gît dans la forme. Le langage, à nouveau, assimile forme et information. Dans la première gît la seconde.
| Gnomon signifie aussi l’équerre et la perpendiculaire. |
Les techniques de jadis informaient la matière: le tourneur modelait la terre glaise pour tirer l’urne du cercle et de ses mains tangentielles; ainsi d’un tas de pierre le maçon élevait la maison sur le plan de l’architecte et le forgeron violentait deux fois le métal pacifique, au feu et par le marteau. L’industrie ajouta un supplément de plans à l’artisanat, mais dans les mêmes voies. Nous avons changé tout cela. Nos techniques, aujourd’hui, tendent plutôt à explorer ou reconnaître d’abord les formes fines et complexes éparses dans les choses du monde et à choisir l’une d’entre elles ou à en mêler plusieurs quand elles correspondent à nos desseins et aux contraintes de la fabrication envisagée: elles les précèdent même quelquefois. Certes, nous montons encore des horloges en métal, comme autrefois, mais tel cristal, telle molécule, voire tel atome ou isotope, font maintenant de meilleures montres, automatiques et fidèles, et tel autre cristal fonctionne comme soupape ou semi-conducteur. Les formes tout informées gisent dans les choses elles-mêmes où il suffit de les recueillir; ainsi nos oeuvres inversent les anciens procédés où l’information ne venait que de nos mains habiles ou de l’entendement expert. L’idéalisme, narcisse, ne trouvait dans le monde que sa propre image qu’il y imprimait à grands frais de travail. La science et la technique réduisaient le réel à leurs représentations. Or la terre meuble et glaise, la pierre avant l’appareil, le métal dans sa gangue, en eux-mêmes et par eux-mêmes cristallins, recèlent mille artefacts comme en une corne d’abondance que les mains et les volontés anciennes ignoraient en la bouchant. Notre intelligence, notre entreprise un peu sotte, violente, grossière, avaient fermé la porte du trésor, alors que le monde cache mille fois plus de merveilles que nos décisions. Le sens, la direction, le projet du travail se retournent. En ce dimanche des techniques, nous reconnaissons d’abord que l’Univers a déjà beaucoup forgé: voici la fontaine de l’information.
Il n’y a pas de matière dans l’Univers. Autrement, les sciences physiques: auraient fini par rencontrer des limites dans leur avancée ou leur histoire, bornes prévues et posées par la métaphysique matérialiste. Or celle-ci s’évanouit à mesure que progressent les premières qui ne cessent de relever des formes sans rencontrer jamais une matière qu’elles ne nomment pas, pour ne reconnaître que la masse. La matière n’existe pas, on ne trouve que des formes, comme les atomes, et jusqu’à la plus petite particule, avec ou sans masse, des formes sans nombre, plus leur mélange, chaotique ou ordonné, système ou noise qui agite et secoue comme dans un panier leur innombrable multiplicité. Il n’y a que de l’information dont le stock énorme dans le monde, sans doute exprimable par un très grand nombre, mathématiquement fini mais physiquement infini, laisse la science dans une histoire ouverte. Même le poids code un champ de forces, même n’importe quel agrégat, colloïde ou organisme surcode encore un sous-ensemble de formes codées. Seuls le mélange et le désordre, noise, chaos, donnent l’illusion de la matière.
Dès lors, l’intelligence est immanente et, sans doute, coextensive à l’Univers. Le monde donne un énorme stock de formes. La nôtre ne fait pas exception dans un entourage noir qui attendrait passivement que nous l’informions. Il existe une immense intelligence objective dont l’artificielle et la subjective constituent des sous-ensembles petits. Connaître pour nous consiste à nous mettre dans une forme analogue à celle que nous connaissons. L’objet que nous construisons, nous le forgeons de façon analogue à certaines choses du monde, définitivement nos pilotes. Intelligent, le gnomon intercepte le flux descendant du Soleil et tous deux, tout seuls, dessinent sur la terre, d’où sort cette statue dressée, l’information objective et partielle de l’ombre qui parle en partie de la forme globale du monde.
La géométrie sommeillait sous la terre ou rêvait dans l’éclat du Soleil: le gnomon des anciens Grecs ou des Babyloniens l’a peu à peu réveillée le long des formes singulières communes à l’ombre et à la lumière.
Que l’esclave mis en scène dans le Ménon de Platon témoigne d’un monde oublié dont il se souvient devant nous, par un exercice de réminiscence, il faut le croire et penser aussi que Socrate et Platon rappellent à bon escient les rythmes inspirés des poètes qui les ramènent à ces temps perdus. Mais il faut de plus décrire en précision ces mondes et ces temps qui réapparaissent dans le cours de la démonstration.
Quand les historiens des sciences reviennent sur le problème ici traité de la duplication du carré, ils recherchent, en ce lieu du Ménon et sur la figure, des traces ou témoins de la géométrie grecque au Ve siècle, aujourd’hui oubliée de tous sinon d’eux, parce qu’on n’en a conservé que de rares fragments, dont celui-ci. Reconstruire le schéma et démontrer le rapport du côté à la diagonale permet de reconstituer savoir perdu et passé révolu: travail de réminiscence. Or l’histoire des sciences fait généralement aussi peu référence à la théorie en faveur de laquelle Socrate appelle un ignorant et suscite pour lui ce problème que l’histoire de la philosophie traitant de la réminiscence fait référence à la duplication du carré lui-même. Et si d’aventure les deux mémoires s’identifiaient? Socrate et l’esclave s’adonnent-ils au même effort que le nôtre, tendus vers la reprise d’un savoir oublié? Quels rapports peut-on définir de la science à la mémoire?
| Dupliquer: non point copier pour obtenir un double, mais construire une même forme de surface double.A la page 81 b-c du Ménon, Socrate cite un fragment de Pindare sur l’âme renaissante. Pindare (518-438 av. J.-C.), auteur d’odes, Olympiques, Pythiques, etc. |
Or l’erreur a lieu deux fois et deux fois par excès. Pourquoi? Parti d’un côté AB de deux pieds, donc d’une surface de quatre, l’esclave prolonge le premier du double, lui accorde quatre pieds, tombe sur une superficie de seize, alors que l’on en demandait huit, le double de quatre. Il revient alors en arrière et choisit un côté de trois pieds pour un carré de neuf. Ces tirs trop longs s’expliquent à nouveau par le problème du gnomon. Ce mot signifie l’équerre mais aussi, redisons-le, la table pythagoricienne qui exhibe les carrés parfaits, les nombres impairs et la suite des entiers: les premiers sur la diagonale, les derniers sur les côtés. Les impairs font le gnomon, sur l’équerre qui reste.
Or le jeune ignorant saute de deux à quatre et redescend de quatre vers trois: il suit donc les côtés du carré en nombres entiers au sens de l’algèbre géométrique des anciens pythagoriciens. Autrement dit, le gnomon encore le précède.
Réminiscences
Il se souvient. Il se souvient d’abord des tentatives de définition dans le dialogue: il a dû l’écouter, caché dans quelque recoin. Rappelons, en effet, que l’exercice parallèle à la définition de la vertu consista en celle de la figure et qu’on se mit d’accord de refuser d’abord les deux premiers résultats: la figure n’est ni la forme ni la couleur; mais qu’on accepta de dire qu’elle est la limite où se termine un solide. La ligne fait le bord de la figure comme celle-ci fait celui d’un corps. Donc l’esclave se trompe parce qu’il suit le bord, celui du carré dessiné par Socrate et celui du schéma numéral. Mais de la ligne à l’aire comme d’elle au volume, c’est-à-dire de la limite à la variété qu’elle entoure ou définit, la conséquence ne vaut pas. L’esclave se trompe parce qu’il se souvient de la définition par le bord. Mémoire immédiate.
Il se souvient, deuxièmement, de l’état où se trouvait la géométrie grecque avant la découverte de la diagonale, d’un monde oublié. De l’algèbre géométrique, des vieux pythagoriciens, du règne des nombres entiers. Le monde mathématique de Platon, Théodore, Théétète, Eudoxe s’est totalement coupé de celui-là. En ce temps-là, on faisait confiance au gnomon, chargé de connaître. La nouvelle école a perdu cette connaissance-là, devenue méprisable et bonne à tout prendre pour des esclaves. Et le jeune homme la sait, la dit, la représente. Il connaît le tableau du gnomon. Vraiment? Nous témoignons, nous qui entendons et lisons le dialogue, à deux millénaires de distance, qu’il sait sa table de multiplication, puisque, sans hésiter, il répond quatre à la question combien font deux fois deux? et qu’il confirme aisément que quatre fois quatre font seize et que trois fois trois font neuf. Mais pour Socrate et son école, ce savoir tabulaire et numéral revient à l’ignorance. Connaître ses nombres équivaut à ne connaître rien. Mais nous lisons que l’esclave récite sa table. Qu’est-ce vraiment qu’une table, sinon une mémoire? La plus facile à retrouver. L’esclave suit la table et le tableau et le gnomon: il se souvient. Il se rappelle un savoir que le platonisme cache et méprise. Autrement dit, derrière la géométrie, celle précisément qui détermine un carré double par la diagonale du carré simple de départ, se cachent dans l’oubli l’arithmétique et l’algèbre géométrique dont celui qu’on méprise se souvient. Du coup, il témoigne par son corps, sa langue et surtout son état, du rang dans lequel l’ancienne science tombe: dans l’ordre de l’ignorance et de la servitude, dans le camp du concret par rapport à l’abstrait. Le philosophe se réserve le métalangage dans lequel se définit ce rapport nouveau du pur et du concret et donc désormais peut juger à son aise du savoir et de son histoire en les faisant tous deux commencer par lui.
Mais Socrate se souvient aussi quand il dit qu’il ne sait pas. Il reste vrai qu’il ne sait pas. Il doute et cherche. Et questionne. Et surtout coupe en éléments et morceaux les grandes phrases rhapsodiques et les pans d’encyclopédie. Fantassin, piéton, il veut marcher pas à pas. D’abord ceci, ensuite cela. Mettons d’abord ceci hors de conteste avant de passer à cela qu’on examinera de la même manière. Coupons en deux, procédons par dichotomies. Socrate ne sait que ces procédures, méthode ou cheminement prudent et circonspect. Mais prenons encore au sérieux la théorie divine qu’il vient d’emprunter à Pindare: et s’il se souvenait, lui aussi, d’un antique savoir? Socrate se souvient des procédures pas à pas de la pensée algorithmique et il la représente par son personnage et son état d’homme qui parle et qui n’écrit pas. Depuis la nuit des temps dans le croissant fertile, la division par deux, privilégiée, permet de calculer de tête plus aisément. Le petit esclave et Socrate marchent ensemble et vont le même amble vers le monde disparu dont ils sont les prosopopées; le vieux maître causeur interroge l’ignorant qui ne sait ni lire ni écrire, selon les antiques et exactes procédures que celui-ci n’ignore pas, sans jamais quitter des yeux le chaînon précédent lorsqu’il passe au chaînon suivant et en revenant tout de suite en arrière s’il arrive qu’il en saute un – retournant donc à la case trois après le brusque écart de deux à quatre.
Le jeu ne se joue point à deux, mais à trois: non pas Socrate, Ménon et l’esclave puisque les deux derniers se substituent l’un à l’autre, mais Platon, Socrate et l’ignorant. La Paidéia, éducation et histoire, passe par trois états: le philosophe-roi, le soldat-piéton et l’homme de ménage ou travailleur des champs, selon l’antique partage. Platon pense dans l’univers de la géométrie, espace pur, métrique rigoureuse, irrationalité maîtrisée: voici venue la diagonale, l’alogos allié au logos et mélangé avec lui, voici venu le Royal Tisserand dont le portrait clôt le Politique; l’esclave, quant à lui, compte de tête les nombres entiers dans l’algorithme traditionnel, logistique méprisable des marchands et producteurs, pendant que Socrate, raisonnant toujours dans l’ancien état, sans écrire, découvre le nouveau monde du carré portant la diagonale en sautoir. Il fait le lien entre les deux règnes; comme un messager.
Platon hante nos pensées dont nous ne pouvons pas nous défaire ou plutôt nous habitons celles qu’il conçut alors que le petit esclave n’a pas quitté les anciens pythagoriciens liés encore aux tables babyloniennes Socrate ne sait rien, comme l’enfant, et n’écrit pas, comme l’esclave; ils gardent tous deux l’ancienne mode dont par eux Platon et nous nous souvenons, antique moment plongé dans les méthodes orales et les procédures pas à pas, mais accèdent soudain, émerveillés, se tenant par la main, à un nouveau monde abstrait.
|
Algorithme: contrairement aux apparences, le mot ne vient pas du grec mais de l’arabe et signifie: suite finie d’opérations élémentaires pour un schéma de calcul ou la résolution d’un problème.
|
La pensée algorithmique s’engloutit dans l’oubli et ne constitue plus, par ses comptines, que la préhistoire de la science. Le jeune esclave se souvient du gnomon et de ses lois tabulaires parce qu’il fonctionne comme une mémoire, comme la table de multiplication. La pensée algorithmique, artificialisable, se réduisait sans doute à de telles mémoires. Ne disons pas: intelligence artificielle, mais plutôt: mémoire artificielle. Autrefois, souvenons-nous-en, le savoir se réduisait peut-être au souvenir. Mais la géométrie nouvelle en révèle les lacunes: on ne trouve aucun nombre sur le gnomon, entre 3 et 4 sur les côtés ni entre 4, 9 et 16 le long de la diagonale. La géométrie complète ses ratés, annule un savoir lié au souvenir. Elle invente un autre monde qui pullule entre les nombres et dont on perd vite le compte. Fin temporaire de la lutte qui oppose l’abstraction et la mémoire, toutes deux considérées comme économie de pensée: ici la première gagne là où la seconde fuit. Mais si celle-ci est écrasée dans la bataille grecque, elle continue la guerre cependant, du côté des Arabes au Moyen Age, chez les plus grands mathématiciens classiques, comme Pascal et Leibniz, architectes d’algorithmes plus que de géométries, enfin dans l’ère contemporaine: nous venons d’apprendre à économiser la pensée, donc à gagner, sur les deux tableaux: celui où brille encore la lumière du soleil platonicien, la mathématique pure, mais aussi celui où le souvenir s’est asservi la vitesse même de cette lumière. Des esclaves objectifs travaillent au sein des ordinateurs: tout l’ancien dialogue suit des procédures aisées à inscrire sur des logiciels.
Mesure et position
La conduite de la discussion a bifurqué soudain de l’arithmétique à la géométrie: si tu préfères ne pas faire de calculs, montre donc! Socrate triche, à l’évidence. Il a demandé la longueur du côté. L’esclave, loyal, répond quatre ou trois pieds. On requiert de lui une mesure, il donne une quantité. Mais quand vient la diagonale comme côté du carré doublé, on ne parle plus que de qualité: sur quelle ligne le carré de surface double se construit-il? Sur celle-ci. Interrogatifs et démonstratifs ont désormais quitté la quantification pour qualifier ce qu’on montre. Nul ne demande au demandeur: quelle longueur? Il questionne l’ignorant sur un contenu à propos duquel personne, en retour, ne l’inquiète. Il a bien trouvé le côté mais ne l’a pas mesuré. Socrate triche: il sait qu’il ne trouvera pas l’exacte longueur.
Les deux erreurs par excès avaient eu lieu en mesurant le côté du carré au moyen de nombres entiers: l’esclave compte quatre et trouve seize, revient à trois et aboutit à neuf. Premier essai sur le pair, et deuxième par l’impair, deux tirs trop longs. Le nombre cherché ne sera donc ni ce pair ni cet impair.
Torpeur et narcose
Impasse, embarras, le dialogue s’arrête et Socrate, en intermède, rappelle à Ménon sa comparaison de la torpille. La métaphore exprime la contradiction et le trouble où se trouve à cet endroit l’interlocuteur du philosophe. Mais nous-mêmes ne comprenons rien avant de nous souvenir de l’origine de la torpille: ce poisson ainsi se nomme parce qu’il nous plonge non dans la stupeur mais dans la torpeur. A le toucher, chacun s’évanouit. Paraît s’endormir. Mais à nouveau nous ne comprenons rien si par-delà l’origine latine nous ne nous souvenons pas que la torpille porte, en grec, le nom de narkè, qui l’apparente à la narcose et à nos narcotiques. Voilà une étrange pharmacie. Le choc issu du contact avec la bête nous paraît; aujourd’hui électrochimique. Nous clarifions cette expérience au moyen de plusieurs sciences, électrostatique, biochimie, neurologie, tout un éventail raffiné déployé. Or notre pharmacie des narcotiques nous ramène à la torpille comme si la langue, par son histoire, avait suivi le même chemin que la science elle-même qui, depuis au moins deux siècles, accumule les expériences autour de ce poisson étonnant. Comme s’il y avait deux histoires des sciences, parallèles: celle qui raconte les manipulations de la physiologie et celle qui se souvient de la torpille latine et de la narcose grecque, du sommeil narcotique et de la torpeur étrange où nous plonge la décharge. Nous comprenons par notre science quelque chose qui touche à l’électricité, que Platon connaît mal, mais Platon nomme une bête de sorte que nous comprenons quelque chose qui touche à notre chimie, à notre pharmacie, mais aussi à la sienne. La torpille endort comme un narcotique. Narcisse enfin se fascine jusqu’à s’endormir, dans l’enfermement total en soi, devant son image que lui renvoient les eaux lisses d’une source. Narcisse-narcose porte le nom du poisson, ou porte en lui cette bête, et se foudroie lui-même comme un pharmakon totalement solitaire sans société ni environnement. La narcose entretient avec l’individu seul le même rapport que l’archaïque victime que les Grecs nommaient pharmaceutique avec le collectif. Au jeu de s’auto-connaître, les je vont-ils tuer le moi comme une foule déchaînée met à mort le pharmakon? Connais-toi toi-même! Foudroie-toi, sujet narcissique de la pensée! Philosophie du sujet, cette drogue suicidaire…
Notre savoir développé en une série, électricité, chimie, pharmacie, neurologie, psychopathologie se ferme, quand on remonte son histoire, comme on plie un éventail, et notre langue seule, transmise, nous relie au passé comme une ligne noire. Les savants contemporains se montrent fiers, à juste titre et volontiers, d’avoir découvert une origine biochimique à la commotion électrique. Certes. Mais la langue le savait déjà, depuis longtemps. Parfois l’histoire des sciences ne requiert qu’une certaine mémoire. La mémoire artificielle de la langue.
Pair et impair: la démonstration apagogique, par l’absurde
Soit un carré de côté 1 et b sa diagonale. Par le théorème de Pythagore, nous savons que b2= 12+12= 2 d’où b = 2. Puisque 12= 1 et 22=4, b vaut entre 1 et 2. Écrivons cette valeur m/n en supposant cette « fraction » réduite à sa plus simple expression. Donc: 2 =m/n d’où nous tirons: m2 = 2n2. Alors m2 est pair: donc m aussi. Première conséquence:n est impair.
Or un carré pair est divisible par 4, c’est le cas de m2; donc 2n2 est aussi divisible par quatre. Alors, n2 est pair et n est pair
Par conséquent n est impair et pair, chose impossible. 2 ne peut donc se mettre sous la forme m/n.
On appela, dès l’Antiquité, cette première démonstration par l’absurde: apagogique.
Elle met en échec l’arithmétique pythagoricienne primitive qui n’admettait que les entiers ou à la rigueur que les rationnels. Tout à coup, l’espace montre des longueurs que le calcul ne comprend plus. Si tu ne peux calculer, montre donc: cette parole de Socrate, plus habile ou profonde qu’il ne paraît, indique exactement la bifurcation.
La démonstration apagogique montre que les nombres rendent impossible ce que l’espace, bien évidemment, rend possible.
La démonstration de Socrate, dans le Ménon, dit que l’espace rend possible ce que les nombres rendent impossible.
Et elles passent toutes deux par le pair et l’impair.
Le dialogue se souvient de la démonstration apagogique et la remonte, si j’ose dire, dans l’autre sens. Et la torpille foudroie par la contradiction ou l’absurdité. Apagogique signifie conduit hors du droit chemin, dévié ou séduit. J’ai bien parlé de bifurcation. Séduit: fasciné par la torpeur.
Or le gnomon se dessine par nombres entiers, impairs et pairs: le petit esclave les a suivis. Montre, maintenant, ne compte plus, montre la diagonale! La voici: elle passe par 1, 4, 9, 16… par les nombres que nous appelons désormais carrés parfaits. Allons, montre donc la diagonale côté d’un carré d’une aire de huit pieds! Elle manque. Non montrable, indémontrable.
Le gnomon ne connaît que les carrés parfaits. Science parfaite du logos, ignorant les irrationnels; science archaïque et très imparfaite du logos parfait: la mathématique dans son authenticité démonstrative naît par conséquent hors du logos, lorsqu’elle s’écarte de lui et peut mesurer rigoureusement cet écart. La science commence hors du langage. Le gnomon donc ne connaît pas tout. On peut demander ou inventer des connaissances inconnues de cette mémoire qui porte le nom de cela qui connaît. Voilà le coup de foudre issue de la torpille. Qu’il existe des connaissances hors du gnomon autorise qu’on cherche ce qu’on ne connaît pas – ce que la connaissance même ne connaît pas.
Torpillage du gnomon, torpillage des vieilles pratiques, de leur mémoire, du compte par l’espace, du logos par l’alogos, du dicible par l’indicible, du langage par la science, torpillage de l’artifice, de la mémoire langagière et artificielle, de la pensée algorithmique. Autrefois juge, essayeur, pierre de touche, le gnomon ne décide ni ne connaît plus; ignorant comme un enfant esclave, deux fois sot. Délivrance! Il existe des connaissances hors de la mémoire.
Il n’y a pas de démonstration avant les Grecs, avant la démonstration apagogique, avant la géométrie, avant l’irrationnel. Certes. Il n’y a que du compte. Si tu préfères ne pas faire de calculs, montre donc! Voilà une phrase d’origine. Montre, tu démontreras! Inventer la géométrie et 1a démonstration consiste à remplir les lacunes du gnomon, celles de la connaissance, de l’intelligence artificielle, de la pensée algorithmique. Celle-ci ne démontre pas. Elle comptait seulement.
Émergence des figures idéales
Aussi fidèle et raffinée que se présente la reconstruction par algorithmes de la mathématique grecque en ses commencements, il reste qu’elle se distingue de cette entreprise par la géométrie des lignes et des solides, l’espace abstrait ou les objets idéaux, une sorte d’autre monde infiniment retiré. La pensée ou la pratique algorithmique rend compte de la théorie des nombres, de la mesure, des pensées variables et profondes sur les rationnels et les irrationnels issus de la duplication du carré ou de celle du cube, mais suppose, là, cube ou carré, côtés sans épaisseur et solides rigoureux, transparents ou parfaits, inexistants avant l’aube grecque. Il faut maintenant comprendre l’émergence de ces idéalités.
|
Les paradoxes de Zénon: paru d’un point pour accéder à un autre, le voyageur ou le mobile doit passer d’abord par le milieu du segment qui les sépare, ensuite par le milieu du segment qui reste, et ainsi infiniment. Donc il n’arrive jamais au but.
|
Elle peut cependant aller plus loin que l’arithmétique, formellement parlant, car ses procédures pas à pas témoignent avec constance de la sécurité voulue et contrôlée de ses démarches. Elle ne va pas n’importe où, et ne passe point par n’importe quelles étapes. On peut donc imaginer une méthode, au sens étymologique de chemin dessiné, qui étende son processus à des règles plus complexes ou plus générales qui permettraient d’avancer ce qui serait prévu dans un programme donné au préalable et seulement ce qu’on y trouverait à l’exclusion de toute autre chose. La procédure algorithmique présenterait alors un premier échantillon naïf de ce que deviendrait par la suite une démonstration en forme. Du procès pas à pas vers l’interdiction de ne faire aucun pas non prévu à l’avance, la distance ne paraît pas infranchissable. Autrement dit, la théorie et la pratique de la démonstration supposent un algorithme. Celui-ci prépare dans l’histoire celle-là.
Zénon d’Elée
Une fois encore j’imagine que l’école éléate a dû contribuer de manière décisive à combler le fossé qui paraît séparer la recette de la rigueur et l’espace usuel de l’étendue idéale où les nouveaux objets manifestent leur apparition.
Les paradoxes de Zénon laissent oublier leur mise en scène au profit de leur mise en forme. Et s’ils nous conduisaient infiniment de l’une vers l’autre? La flèche qui vole d’arc en cible ou Achille dont la course s’évertue à rattraper la tortue, comme fait le lièvre dans la fable d’Ésope, l’une et l’autre sans espoir de succès, empruntent chacun une voie, autrement dit une méthode. Observe avec quelle précision se mettent en place tous les éléments d’un algorithme chemin ou méthode pour atteindre un but, finalité pratique et simple d’un dispositif, mesure exacte du segment parcouru, décomposition du processus en éléments, procédure pas à pas, c’est bien le cas de le dire, répétition qui reprend, dans la figure et la forme, scène et nombre, le même geste à faire après le même geste fait, dérivation très probable à partir d’une fable. Observe encore certain mime de l’anthyphérèse, de la soustraction algorithmique alternative, issue de la tradition, et qui enlève ici la moitié du tout, ensuite la moitié du reste, puis encore la moitié du reste, et ainsi de suite, comme si Achille ou la flèche opéraient la soustraction en se mouvant. Observez enfin, dans l’autre sens du temps, combien l’algorithme infinitésimal encore à naître, ou du côté d’Abdère dans un siècle ou à l’âge classique passé deux millénaires, innovera peu par rapport à ces procédures. Toute la mise en scène donc, la forme au départ, révèlent une pensée algorithmique.
Achille court ou marche, la flèche part et vole, toute la recette échoue. Ni le coureur champion ni la pointe sagittale ne parviennent à leur but. Pour la première fois, un procédé sûr de son résultat, une bonne recette de mesure, s’enrayent, en vertu même de leur parfait fonctionnement et sur un exemple lumineux et excellent. La répétition n’engendre que la répétition, le pas à pas piétine sans arrêt possible. On rira du héros du courage, dérisoire image de la bête couarde, la vitesse ne leur servant plus de rien. De manière canonique, Zénon met à mort la métrologie traditionnelle: l’algorithme millénaire du croissant fertile s’éteint à Élée.
Le parcours de la flèche ou d’Achille ne tend plus au but prescrit, mais bifurque, soudain pris par une finalité très nouvelle. Courant, volant, les deux vecteurs s’enlisent dans la fondrière étroite mais abyssale du segment, liés à l’algorithme collant, mais ensemble tendus vers un point unique à la limite de tous les points effectivement parcourus ou possibles, filtré par toutes les stations dépassées. Cela signifie qu’on élimine ou soustrait les lieux par où on passe ou peut passer, disqualifie ceux où l’on arrive ou peut arriver, discrédite tous ceux où l’on reste ou habite, au profit du seul vers où l’on va sans y atteindre. On entend déjà les accents platoniciens. La procédure, simple au bout de tous les comptes, discriminant ce point de tous les autres, divise le segment par une seule dichotomie, en somme: tous les points et un seul. D’un côté, on peut voir et toucher, fouler aux pieds des lieux concrets, actuellement ou virtuellement, y demeurer, y accéder, y passer, en partir, le monde ou le chemin de ces lieux-là restant ouvert à la course ou au vol; de l’autre, un point émerge, intangible, indépassable, inaccessible, qu’Achille ne verra jamais, que la pointe de la flèche ne percera pas, que nul n’habitera. Il émerge de la mer immense des autres. Le monde mesurable autant qu’on veut, par approximation et même exactitude, avoisine immédiatement un autre monde infiniment lointain, sans dimension puisque la métrique s’épuise à l’atteindre: trou absent sur le dessin. Tracez donc sur l’arène la trajectoire du héros ou le vol du vecteur, vous ne marquerez point sur leur orbite le lieu vers lequel tous se hâtent: nul ne peut l’écrire ni le dessiner. Si vous le piquez sur la feuille ou le sable, Achille ou la pointe y passèrent, ce ne peut être lui. Vous tenez en main le style, autrement dit le dard lui-même, le trait qui vole avec lequel vous écrivez sur la page, et il ne peut inscrire le point après lequel il court toujours. La science naissait hors du langage, elle naît hors de l’écriture. Voici le premier lieu intelligible, atopique, au bout de ce court chemin égal au plus long chemin possible. L’abstraction géométrique devient la limite de la somme infinie des soustractions algorithmiques.
Voici quelqu’un, là, de tel aspect ou de tel âge, bien vivant et individué, aux cent signes caractéristiques; pour le penser, dit Platon, il faut concevoir dans un autre monde tout à fait séparé de celui-ci, une idée d’homme ou l’homme idéal. Celui-là participe de celui-ci. Comment les concevoir tous deux, le théorique et le concret ensemble, répond Aristote, sans former l’idée abstraite d’un troisième, à laquelle ils participeront? Et comment, de nouveau, concevoir les trois, l’homme de ce monde-ci, celui de la première théorie et le second de la seconde, sans un quatrième qui… cet argument à l’infini, dit du troisième homme, bien loin de critiquer ou de détruire le lieu abstrait intelligible des idées ou des formes, contribue à le décrire et le fonder, de même que la mise en scène de Zénon conduit infiniment de la représentation concrète ou de la recette métrique au voisinage, à la limite de l’idéalité non représentable et qu’on ne peut dessiner ni écrire, soustraite jusqu’à l’épuisement à toute appréhension: des points visités ou visitables au but invisible et inaccessible. L’abstrait gît au fond de cet abîme, infiniment lointain, mais infiniment voisin.
Voici, bien vivant, le jeune esclave ignorant qui, sous la torpille de Socrate, démontre la duplication du carré en construisant la diagonale irrationnelle. Platon prétend qu’il se souvient d’un monde oublié puisqu’il sait sans avoir appris. Sans qu’Aristote intervienne, nous remettons en scène l’autre esclave de l’autre monde en train de calculer l’aire d’un autre carré, scène qui à son tour porte en abîme, dans son carré repris, une implication infinie de diagonales, de côtés ou de Socrate empoisonnants. Nous venons de nous rappeler, en l’inventant, l’ensemble des questions et des problèmes, mathématiques et philosophiques, entrant dans la classe du troisième homme. Interminablement, sur une figure qui se déplie ou s’emboîte sans cesse, de mondes en mondes fuyant vers l’amont et d’oublis recommencés en souvenirs manquants, un jeune esclave renaissant de son ignorance, calcule, compte, redouble une longueur puis en soustrait une part, incapable d’arriver tout seul à la diagonale qu’on peut et ne peut tracer, présente là mais irrationnelle. L’esclave pense algorithmiquement, le maître n’oublie pas la géométrie. La définition de l’abstrait géométrique, modèle de l’abstrait théorique requis par Platon pour penser ou exister ou percevoir, émerge d’une méthode ou voie infinie sur laquelle Achille et la flèche nous précèdent et nous guident, laissant indéfiniment derrière eux les algorithmes enrayés.
Le tracé des diagonales du pentagone restitue un pentagone dont les diagonales, indéfiniment, font apparaître en autre pentagone.
Généralisation
Le raisonnement de Zénon se répète: avant d’arriver au but, il doit passer par le milieu du segment, mais auparavant franchir le quart et encore avant accéder au huitième, et ainsi indéfiniment, de sorte qu’Achille ne peut commencer. Le point initial revêt donc le même statut que le terminal. Le paradoxe, par les mêmes processus pas à pas, touche au point milieu puis à n’importe quel point: alors tout segment devient idéal. Il faut appeler paradoxe l’ensemble de ces démonstrations parce que les éléments qui s’en dégagent s’éloignent beaucoup de l’opinion commune.
Éléments
Le terme Éléments, qui traduit en latin et dans nos langues modernes le titre usité par Euclide et sans doute avant lui par Hippocrate de Chios, a pour origine les lettres L, M, N de même que l’alphabet récite, épelle les premières lettres grecques: alpha, bêta et que le solfège chante les notes: sol, fa; car le titre authentiqueStoicheia signifie bien les lettres, comprises justement comme éléments de la syllabe ou du mot.
Mais aussi bien que ces éléments de langue écrite, il veut dire ceux du monde, eau, terre, à la manière d’Empédocle qui use, là, du terme rhizome: racine, origine radicale des choses; éléments de l’Univers, astres, planètes; de la grammaire, noms, verbes; de la logique, de la rhétorique, de la géométrie… Dans cette liste ou dans ce tableau, il ne paraît pas qu’une discipline ait cherché la suprématie: ni la langue ni les sciences ne l’emportent sur les choses, les objets eux-mêmes n’y précèdent pas leurs signes. Le ciel nocturne étale un ensemble de points; les atomes, éléments ponctuels des choses, sont souvent présents comme des lettres ou des chiffres, inanalysables et à combiner. De plus, Proclus comme Aristote disent des éléments de la géométrie qu’ils en constituent la matière comme commencent par eux ceux qui l’enseignent ou l’apprennent: fondements ou rudiments, selon. Il ne semble donc pas que les Anciens aient cherché ou pensé des éléments absolument derniers ou premiers: il y en a partout, en des tables locales.
Prosodie: ensemble de règles relatives à la quantité de voyelles qui régissent la composition des vers, notamment dans les poésies grecque et latine.
Le verbe correspondant, steichô, désigne l’acte d’avancer en rang, comme une armée en ligne de bataille, de sorte que le nom correspond à la ligne, la colonne, la rangée. De cette famille, le français n’a retenu que certains mots techniques: le distique, groupe double de vers alignés l’un sous l’autre ou couple d’un hexamètre et d’un pentamètre; la stichomythie, dialogue de tragédie où les interlocuteurs se répondent vers pour vers et comme pied à pied. La prosodie, qui use de ces termes, compte par syllabes brèves et longues, dactyles, trochées, anapestes, avec des points et des traits, comme l’alphabet Morse. Atome, élément: point, trait. De nouveau, qu’est-ce qu’un élément? Cette marque, cette trace, le tiret, le trait, en général la note, au sens où Leibniz usait de ces mots. Et au pluriel: un ensemble de ces notes. Ensemble généralement groupé en une table ou un tableau de points et de traits, en lignes et colonnes, bien rangés. Que je sache, lesÉléments de la géométrie consistent aussi en points et traits que nous devons apprendre comment tracer.
Aujourd’hui comme hier, nous voyons partout rassemblés en de semblables tables: les lettres des alphabets, les chiffres en toutes bases, des axiomes, les corps simples, les planètes, les taches du ciel, les forces et corpuscules, les fonctions de vérité, les acides aminés… Notre mémoire les garde si aisément qu’elles constituent, par elles-mêmes, des mémoires: objectives, artificielles, formelles. Exactement dans le même sens que les vieilles tables de la loi. Que désigne, au total, le terme éléments? Une table, ouverte à toutes les tables concevables; la mémoire, en général: ce à quoi un savoir se réfère constamment. Ainsi les Élémentsd’Euclide construisent un système au sens logique ordinaire, déduit et fondé, mais aussi font une mémoire au triple sens de l’histoire – d’où les commentaires – de l’automate et des algorithmes.
Or un sens unique se détache, remarquable, de cette aire de sens si cohérente: stoichéion signifie l’aiguille qui marque l’ombre sur le cadran solaire; le gnomon, peut-être, mais surtout la trace locale qui note l’heure. Cette heure, que l’étymologie populaire associe à l’horizon, entendu comme limite, marque ou trait d’un bord extrême, se voit ici à la frontière de l’obscur et du clair. Merveille de profondeur, le temps se définit comme le bord commun à l’ombre et à la lumière. Voici l’onglet, le tiret de bronze ou d’or qui garde le souvenir d’un instant fugitif; voici la suite de ces traces stabilisées, gamme d’éléments le long de la ligne soustylaire, épelant tour à tour le jour le plus long et le jour le plus court, la nuit médiane, les solstices et les équinoxes, l’inclinaison de l’écliptique, l’axe du monde et la latitude du lieu… gamme ou table d’éléments pour le plan de l’Univers: encore une mémoire artificielle sculptée sur le cadran, éléments de cosmologie autour du gnomon et marqués par lui. Sur l’aire sémantique du terme élément, on devine là une trace d’origine. Parmi les traits sur la table, épars ou ordonnés, on croit lire soudain qui les a tirés ou tracés. Comme si, en ce nouveau cadran, se découvraient une lumière, une ombre, une date.
Statique
A-t-on plus écrit, au cours des siècles, que sur les livres d’Euclide, et surtout sur ses commencements,Définitions, Postulats et Axiomes, éléments des Éléments? Presque autant que sur la Bible et parfois en de semblables termes: d’histoire et de logique. Et de même qu’il arrive qu’un commentaire de la Bible devienne à son tour une Bible, de même il arriva qu’un commentaire des Éléments de géométrie devînt une géométrie. Ou une logique.
| Inquiétude (quies, repos) signifie étymologiquement un écart à l’équilibre. |
Une description du même ordre que la précédente, analysant le sens des mots usités, m’avait conduit jadis à dire que sous l’énoncé des idéalités pures et formelles, enregistrées sous la rubrique Définitions, gisait un soubassement statique. Les termes grecs que nous traduisons par plan et trapèze signifient d’abord ou la table ou ce qui est de plain-pied. De même les verbes indiquent le repos ou l’équilibre. Tout se passe alors comme si la liste bien définie géométriquement construisait en secret des stabilités de plus en plus complexes à partir des plus simples, la toupie tourbillonnante sur un pied, en fin de rubrique, à partir du point le plus bas, au début. Les repos s’inquiètent ou se rompent par des inclinaisons successives pour retrouver, à mesure, des équilibres de plus en plus raffinés. Comme si les prolégomènes d’une mécanique se cachaient sous les préalables de la géométrie Et cet espace de statique rejoignait le vocable grec d’épistémé qui, signifiant la science, garde encore en lui la trace d’une invariance stable.
Sur cette origine, je persiste et signe, d’autant que, depuis, les analyses de Statues ont relayé puis renforcé ce fondement positif par une fondation anthropologique, exprimant des contenus voisins dans une tout autre langue. L’épistémé engendra la statique alors qu’elle venait des statues. Ici je tisse les deux livres précédents et montre que l’histoire des sciences suit normalement de l’anthropologie des sciences. On pouvait s’attendre à un tel passage. Les Statues sortent de terre, lentement, les Définitions aussi et la géométrie, en somme: on comprend enfin son nom.
Qui trace la marque élémentaire, qui écrit le trait? Le Soleil sur la terre, chose écrivant sur une chose; ou bien: le gnomon, debout comme une statue sortie de terre, sur le cadran solaire, artefact traçant sur un artefact. Les Éléments, par leur titre, semblent avouer une origine astronomique; les Définitions, ensuite, par leurs verbes et leurs noms, permettent qu’on devine une racine statique – je dirais plutôt maintenant un socle statuaire.
Le gnomon ou équerre se décompose en règle et compas
Quoique les Anciens n’en disent rien, les Postulats permettent de tracer les Éléments de la géométrie, à la lettre ses traits, par la règle et le compas: la ligne droite, finie ou indéfinie, le cercle, les parallèles, l’angle droit. Pour ce dernier, l’équerre disparaît puisqu’il suffit d’inscrire, au moyen des deux outils classiques, un triangle rectangle en un demi-cercle. Anciennement appelée gnomon, l’équerre se dissocie donc en deux composants, propres à tirer des traits ou éléments: la règle et le compas, qui portent en eux et conservent invariablement dans une forme en bois, bronze ou marbre, la possibilité, la capacité de construire ou de tracer les tirets, traces, marques, points, lignes courtes ou courbes, éléments réels et intellectuels de la géométrie.
Définitions et Postulats construisent la table ou le tableau des éléments ou traits, dans le sens formel, langagier, pur ou abstrait de ces termes, sens dans lequel ils sont depuis lors compris. Mais le compas et la règle (ou leur somme le gnomon) en font voir la table concrète. Puisqu’ils permettent de les construire, tirer ou mener, ils contiennent ou impliquent en quelque façon une infinité de droites, cercles, points, angles droits, parallèles et figures possibles: ils constituent vraiment la mémoire dans laquelle ils s’enveloppent et d’où l’on peut à loisir les extraire, les abstraire. Abstraire: tirer un trait de ladite table. Le trait abstrait sans dimension autre que la sienne propre s’extrait de la règle en bois ou en marbre, se tire d’elle, en sous sens: comment dire autrement que cet élément y était compris? Pourquoi la théorie de l’abstraction déploie-t-elle ses fastes dans un espace imaginaire séparant les sens, grossiers, de l’entendement pur? Que viennent faire ici sensations et facultés de l’âme alors qu’il s’agit simplement de tirer des traits au moyen d’une règle ou d’un canon, d’une forme rigide, alors qu’on en peut mener sans cesse de cette mémoire artificielle comme d’une corne d’abondance jamais en défaut? Oui, le verbe abstraire a ce sens vraiment élémentaire.
On s’étonne encore de l’interprétation de ces choses par les âmes et les corps. Qui écrit, en effet? Le gnomon, debout comme une statue. Autrement dit: l’élément. Qu’est-ce qu’il écrit? Des traits, lignes, points ou cercles, c’est-à-dire des éléments. Où se trouvent ces éléments? Dans la règle et le compas ou dans leur résultante, l’équerre, c’est-à-dire le gnomon, autrement dit l’élément. L’élément écrit des éléments, abstraits des éléments. Voilà le commencement. Les sujets comme les objets de la discipline hantent l’intelligence ou la mémoire artificielle d’où ils s’abstraient.
Présent dans le titre comme aiguille du cadran, dans les Définitions comme statue en équilibre, l’artefact ne nous quitte pas, hante les Postulats et les rend possibles. La géométrie d’Euclide comme système ou développement d’une série de théorèmes à partir de commencements préposés peut ainsi passer pour un automate. Et cela ne veut pas dire que ses performances restent finies.
Égalité, communauté
Que penser, maintenant, pour former une communauté? L’égalité. Que nul ne l’emporte sur aucun et que les échanges se compensent. Attention: « Tu oublies que l’égalité géométrique règne, toute-puissante, parmi les dieux comme parmi les hommes. Tu penses qu’il faut s’efforcer de l’emporter sur tous les autres: parce que tu négliges la géométrie », tonne Socrate contre Gorgias, jeune cadre dynamique, frais sorti des familles et des Écoles, loup assoiffé de pouvoir sanglant, vaniteux, concurrentiel, et lui montre la surprenante équivalence entre la géométrie et l’égalité. Pas de science sans le signe égale. Pas de connaissance sans cette invariance. Or cette notion et cette opération équivalent aussi et encore à l’ordre, à la justice, à l’harmonie, au lien social. L’égalité conditionne la communauté. Ceux qui optent en faveur de l’invariance votent pour l’ordre social.
Le terme Axiomes traduit donc le plus mal possible l’authentique titre d’Euclide: (Notions communes), sous lequel on traite de l’égalité. Il faut croire aveuglément à un sujet individuel de la pensée pour imaginer qu’il s’agit là de notions que chacun porte ou détient de naissance, génétiquement, de manière innée, de droit ou par miracle. Il ne faut pas grande expérience humaine ou sociale pour apprendre, tout au contraire, que l’égalité, dans la comparaison, le rôle ou l’échange, est la chose du monde la moins partagée: en ce sens, la moins commune. Si d’aventure vous la rencontrez, criez à la sainteté. L’homme, hélas, ne peut penser qu’il est un homme pour l’homme et ne sait agir selon cette vérité. Peut-être même ne doit-on parler d’homme en général que dans cette phrase.
Cela dit, l’égalité s’impose si on veut fonder une communauté. Elle ne vient pas de chacun, mais de ce projet. Commun, dès lors, ne signifie point le dénominateur usuel ou courant, mais ce qui caractérise le public. L’ensemble des descriptions ou implications de l’égalité, ses attributs, opérations ou propriétés, constituent des notions indispensables à l’établissement de ladite communauté. D’où le titre de Notions communes. Pour comprendre cette koiné, il faut prendre congé du sujet individuel de la pensée pour penser un sujet collectif. Qui, en particulier, constitue et fonde la communauté scientifique, celle qui développe la science normale ou élémentaire en déduisant et démontrant à partir de ces commencements, et se développe par là même.
Premiers principes
Au total, les commencements d’Euclide impliquent leur propre anthropologie. Le titre lui-même ramène le gnomon, ainsi que les traits que tracent le Soleil et l’axe sur la terre première qu’évoque la géométrie; de cette terre se lèvent, par successives inclinaisons, les équilibres ou repos d’une statique fine décrite par lesDéfinitions, statues sorties du sol, debout comme l’axe: l’épistémé commence; les Postulats décrivent à quoi sert le gnomon, l’équerre disparue au profit de la règle et du compas, et comment il fonctionne; ils désignent ainsi qui trace les traits ou lignes ou plutôt en quels objets ces lignes ou traits s’impliquent et d’où ils s’extraient ou s’abstraient: objets artificiels pour la mémoire des éléments et leur intelligence; le langage même nous amène à dire abstraits les traits tirés ou construits à partir de ces artefacts comme s’ils s’extrayaient d’eux; enfin les Notions communes décrivent les conditions dans la pensée de l’établissement d’une communauté, ce tout dont chacun, plus petit qu’elle, ne constitue qu’une part. Au bilan, voilà de l’objectif et du collectif, en l’absence de tout sujet dans le sens moderne.
| Épistémologie: théorie particulière de la connaissance scientifique.Gnoséologie: théorie générale de la connaissance en général. |
Il y a du transcendantal dans les commencements d’Euclide qui renvoient aux commencements de la géométrie ou qui les expriment et reprennent, il y a du conditionnel, là, du fondamental, exactement de l’élémentaire. Mais ils ne gisent ni dans le subjectif, ni dans l’a priori, ni dans le formel ou le pur, aux sens de Descartes et de Kant. Ils résident dans le monde, Soleil, Terre, dans l’artificiel, axe, table, compas, règle, statue, enfin dans la communauté, dans l’intersubjectivité mal nommée donc mal conçue à partir du sujet individuel. Si le transcendantal n’ajoute qu’une abstraction vide et stérile aux idéalités constructives de la géométrie ou des fondations subjectives à ses fondements formels, rien ne le différencie d’une fable, d’un conte, d’un ornement cosmétique. Si et quand il existe, savoir lorsque les conditions qu’il dégage, plus que nécessaires deviennent suffisantes, il rencontre l’anthropologie: la genèse des Éléments se repère alors réellement dans les choses du monde et la culture sociétaire.
Les conditions spéciales des sciences – épistémologiques – gisent dans les conditions générales de la connaissance – gnoséologiques – gisant elles-mêmes dans les rapports anthropologiques, obscurs et méconnus jusqu’à aujourd’hui, entre le collectif et les objets du monde, la culture et la nature. Le groupe en tant que groupe rejoint-il les choses mêmes? Si oui, comment?
Notre tradition philosophique dicte que seul le sujet individuel ou perçoit ou pense et constitue l’objectif. De son côté, le collectif ne construit que soi-même: nos relations n’ont pour objet que nos relations. Nous vivons d’autant plus loin du monde que nous nous occupons les uns des autres. Cette partition qui donne au solitaire le rôle héroïque de la rencontre avec les choses dans le silence de la communication répond sans doute à l’expérience usuelle et tragique des faits humains massifs de l’histoire, mais ne répond aucunement à la réelle nouveauté de l’exercice scientifique par rapport à ces faits-là. Le contrôle et le consensus de la communauté que définit cet exercice constituent le sujet de la science. Elle pense collectivement. Le sujet de cette pensée ne devient individuel qu’en de rarissimes moments de crise: quand le groupe menacé recueille un exclu en faisant semblant de croire qu’il l’a envoyé en éclaireur alors qu’il l’avait expulsé.
On peut tenir pour une curiosité historique le fait paradoxal qu’aux dates exactes où la science commence à se constituer en groupe, sinon encore en profession, adonnés aux choses mêmes, à la nature, à la physique, apparaisse une philosophie du sujet individuel connaissant, comme si celle-ci soulignait l’exception en ignorant superbement ce qui devenait la loi commune ou le règlement de la communauté. Pourtant, seul le tribunal de l’assemblée savante, seule l’Église des experts se contrôlant les uns les autres, décident si la Terre tourne et non le héros isolé. Car si seul ce sujet le pensait, la Terre ne tournerait pas ou il n’y aurait pas de science. Tout se passe comme si l’affaire Galilée avait amené au contresens les philosophes de la connaissance, comme si un mythe fondateur de l’histoire ou de l’hagiographie des sciences les avait poussés à oublier que la science pense comme une assemblée, comme un tribunal et une Église et fonctionne comme eux, de sorte qu’en fait l’histoire des sciences évolue, dans le détail comme dans les lois d’ensemble, comme une reprise de l’histoire des religions. Celles-ci avancent par les hérétiques, celles-là par les inventeurs, assez régulièrement expulsés. Rien de paradoxal dans cette comparaison: la religion donne le premier exemple d’un sujet collectif pensant un objet qui transcende les relations de la communauté.
Dans la science, en effet, le groupe égalitaire des experts se reconnaissant les uns les autres constitue le sujet de la connaissance, comme si cette connaissance avait pour condition opératoire la reconnaissance réciproque des individus ainsi égalisés; la science pense comme telle et offre, d’autre part, des garanties qu’elle pense des objets du monde transcendant ses relations. Voilà l’exception, qui, assurément, ne concerne pas l’individu mais le collectif. Car le collectif en général se conduit comme si ses relations lui suffisaient, comme s’il n’y avait pas de monde. Il n’a pas d’objet extérieur à sa fermeture. L’ensemble de ses relations constitue sa définition et la redéfinition de chaque relation constitue la nourriture dont il vit, sa reprise et sa relève. L’idéalisme qui assure que le monde équivaut à nos représentations convient à certaines maladies mentales graves et à toutes les sociétés sans exception, dont les relations se projettent sur le milieu. Les sociologues ont raison de prétendre que les groupes ne connaissent que leurs propres lois: ainsi font les hordes d’animaux et les animaux politiques, petites marionnettes qui ne se démènent que par les ficelles qui les relient entre eux. Le mouvement de l’une exprime ou somme sous un certain angle qui la définit les agitations de son environnement social. Cette boîte à musique ne requiert ni ressort ni programme puisque chaque mouvement, résultat de la somme, revient aussitôt à la somme comme cause d’un prochain mouvement. Rien n’excède les ficelles et le sociologue a toujours raison d’exiger une autonomie de sa science puisque l’ensemble se ferme sur soi et s’autoproduit. Cela produit en tout quelques fluctuations temporelles auxquelles parfois on donne le nom d’histoire.
| Transcendant: hors du monde et sans rapport avec lui.Transcendantal: qui se rapporte aux conditions a priori de la connaissance. |
Il apparaît, soudain, en deux millénaires, dans ce temps hasardeux et monotone, un collège paradoxal qui se donne et pense quelque objet du monde existant indépendamment des réseaux, fils et noeuds, qui assujettissent les hommes entre eux, comme s’il les transcendait. Un Dieu transcendant accompagne, sans s’en occuper, le chaos, le monde et les atomes, dans le texte de Lucrèce, quand commence la physique. Rien de paradoxal en cette double affirmation: le Dieu absent, indifférent aux relations des hommes, a le même statut que le nuage des atomes, en ce sens que leurs agissements de solitaire ou de pluralité restent éternellement indépendants de ce qui fait courir les peuples. L’objet naturel prend la place de Dieu, peut même coexister avec lui en la même place, l’essentiel demeurant de bien comprendre cette place. Les savants croient en l’existence du monde extérieur comme le religieux croit en Dieu: aucun des deux ne peut le démontrer, mais ne peut exercer ni sa foi ni sa science sans ce fondement. Dans l’affaire Galilée, tout l’enjeu réside en cette place même. Un tribunal ne siège que pour dicter sa loi et ne parle que performativement, donc pour lui, cette place n’existe pas: il y a des causes, non des choses. Qu’au milieu quelqu’un se lève et témoigne que la Terre tourne et il n’y a toujours pas de science car il arrive tous les jours que dans un groupe quelqu’un se conduise anormalement. Mais une Église rassemblée a déjà préparé cette place. Seul un tribunal religieux pouvait, en cette occasion, hésiter. Condamner mais rendre possible. Quelqu’un en son sein se lève et témoigne que la Terre tourne et les juristes réagissent comme en présence d’un enthousiaste qui crie son intuition mystique. Certes, il n’y a toujours pas de science, mais s’ouvre une possibilité, existe une chance que, malgré leurs prétentions, les participants à l’assemblée se convertissent à la révolution astronomique, habitués à débattre de raisons réelles, de raisons de Présence Réelle sans aucun rapport avec leurs propres relations. Un tribunal ordinaire manque d’une telle place et ne peut céder, fermé sur les causes; religieux, il ne cède pas, mais peut céder, mais cédera, ouvert sur cette place. Il existe tout à coup des choses et pas seulement des causes. La religion se ferme sur ce qui relie les hommes mais s’ouvre sur l’expérience directe de Dieu: en elle s’affrontent les doctes et les mystiques. L’affaire Galilée continue cette lutte canonique. Mais elle donne l’idée de créer une commission d’experts chargés des choses elles-mêmes, un autre tribunal auprès de l’ancien tribunal: voici la science, qui ne parle pas performativement et en qui se perpétue le même débat. Au total, il existe un ou des objets pour nous, pour le collectif, pour cette société dont la loi d’airain, usuellement, oblige à se conduire comme s’ils n’existaient pas. La science forme un groupe réaliste, paradoxal, dans la communauté ordinairement idéaliste. Par ce savoir, nous, ensemble, avons rapport à une chose dont les lois n’ont aucun rapport avec nos rapports. Aucune philosophie, à ce jour, que je sache, ne nous permet de penser un tel événement puisque la tradition nous dicte qu’il n’existe d’objet de connaissance que pour un sujet individuel et que le collectif ne peut connaître objectivement puisqu’il n’a d’objet que ses relations. Certes la philosophie qui permettrait de le penser, difficile, exigerait de penser cette place transcendante où coexistent Dieu et les objets du monde, l’expérience mystique et l’expérimentation.
On ne peut tenir pour une curiosité historique le fait tragique et fatal qu’aux dates où s’annonce la mort de Dieu, le monde objectif abaisse ses barrières, ôte ses obstacles, allège la cruelle et vieille nécessité, commence à perdre ses batailles face à nos techniques agressives et triomphantes, se retire, humilié, derrière nos représentations, bref, entre en agonie. La bombe tonne la mort du monde. Un demi-siècle à peine après la mort de Dieu. Les deux transcendances quittent la même place à peu près en même temps. Nous voici obligés d’écrire une philosophie de l’agonie de l’objectivité transcendantale.
Fondements
Les mathématiques fondent la physique: assertion large et vague, puisqu’elles fondent, aussi bien, toutes les sciences. En ce sens trivial, on veut dire que la physique ne devient une science que si elle se dit en langue mathématique. Soit. Mais un fondement va plus profond.
A lire élémentairement les commencements des mathématiques, débuts dans l’histoire et préliminaires pour le système, à lire ainsi les éléments des Éléments d’Euclide, on découvre un monde englouti dont on a perdu mémoire: un Soleil et une Terre, l’ombre et la lumière, la marque du temps dans l’espace; des choses lourdes et pesantes, sortant de terre lentement comme des statues ressuscitées d’entre les morts; des artefacts, canons, règles ou cordeaux, mémoires objectives impliquant les éléments ou traits qu’on tire d’elles ou que l’on abstrait; les conditions de constitution d’une communauté, d’un consensus: l’accord sur la vérité ne saurait advenir sans l’égalité. Au total un monde et un groupe.
Voilà les conditions ou fondements de la science: il existe un nous transcendantal qui a pour objet une Terre transcendantale. Voilà les fondements de la connaissance scientifique en général, abstraite ou concrète. Aussi concrète que le sont le monde et les choses. Ainsi cette géométrie fonde la physique parce qu’elle est une physique, parce que le monde est sa condition transcendantale, ainsi que l’objet, tel quel ou fabriqué. Ainsi elle fonde aussi bien la technique puisqu’elle est une technique. Mais, de l’autre côté, aussi abstraite qu’on le voudra puisque productrice d’abstraction. La géométrie pure naît du canon, de la règle ou du compas, comme les géométries, plus abstraites encore et plus pures, sortiront plus tard de la géométrie d’Euclide et de ses commencements. L’abstraction fait un chemin continu qui ressemble tout simplement, ici, à l’histoire. La première se tire de l’artifice et la deuxième de ce qui en vient et ainsi de suite, en éventail qu’on déplie doucement. Pourquoi les Grecs, cependant, n’ont pas inventé la physique mathématique? On répond parfois: en raison de la présence des esclaves. Qui aliène des bras se passe d’outils et se contente de contempler. Tout beau. Croit-on qu’à la Renaissance, où cette même physique émergea, les serfs avaient disparu d’Italie, de Hollande et de France, pense-t-on que la machine à vapeur et la thermodynamique aient paru au siècle dernier quand l’exploitation des hommes par ceux qui ne se croient pas leurs semblables cessa?
Les Grecs auraient hésité devant la loi physique parce que de petits dieux tenaient campagne dans l’espace, chacun dans son département: quand une hamadryade garde chaque arbre, qu’une nymphe par fontaine veille à l’expansion des eaux, quand la mer pullule de sirènes et les prés de faunes, mille singularités s’opposent au passage de la règle générale. Il faut attendre le Dieu unique pour que l’étendue se vide soudain et que nulle localité n’obstrue l’Univers homogène. Un Être au-delà des étants, voici un universel lisse qui rend possibles les sciences naturelles et les techniques. La transparence et l’unicité suppriment toute singularité. L’alliance, enfin, d’une formule avec des phénomènes expérimentables suppose qu’on ait admis le dogme de l’incarnation. Les conditions de type religieux ou métaphysique peuvent paraître plus décisives que les raisons économiques et sociales.
Mais surtout les Grecs n’ont pas inventé la physique en raison des sciences humaines. Car les sciences humaines précèdent les sciences physiques. Antérieures dans le temps et conditions des secondes, les premières les empêchent d’apparaître. Ce conflit, hors des facultés, hante nos premiers savoirs. Nous nous occupons de nos propres rapports bien avant de nous préoccuper du monde. L’humanité, d’abord sociologue, eut besoin de toute son histoire avant de se faire physicienne. Inversement, l’histoire est ce rattrapage lent du monde.
Nous avons si longtemps interprété les religions et les mythologies en termes de sciences naturelles, contresens imposé par notre modernité, que nous croyons encore fermement que nos ancêtres avaient d’abord peur de la foudre, des météores ou de la nuit, de la stérilité des jachères. Non, ils craignaient autrui et le groupe, leurs ennemis. Toutes les mythologies et les religions sont des sciences humaines d’exquise manière, infiniment plus précises, efficaces et sensées que ce que nous appelons de ce nom aujourd’hui. Pour arriver au monde puis à la physique, il fallait d’abord traverser cet écran-là, tissé par les collectifs eux-mêmes.
Les nombres, d’abord, codent les impôts, le commerce ou les salaires: nul problème de mesure connu dans tout le croissant fertile ne s’adresse à la nature, comme si les corps ne tombaient pas, encore. Tous, au contraire, quantifient ce qui passe par nos relations. Même l’évaluation par les harpédonaptes des champs cultivables, dont la crue du Nil a effacé ou renversé les bornes, cherche à clore les contentieux entre voisins par la force de l’État et à rétablir dans son intégrité le cadastre, soit l’assiette de la taxe. Cette géométrie première ne mesure pas n’importe quelle terre, mais balance plutôt l’avoir et le doit, et ses erreurs constantes d’approximation vont toujours dans le même sens: l’intérêt du pharaon ou du plus fort.
Une chose étrange pleine d’eau, voilà l’inauguration de Thalès: les physiciens ioniens découvrent des objets – l’air, le feu, la terre – totalement indépendants de nos rapports de volonté ou de puissance, des choses sans causes humaines. Il existe un monde hors des sociétés closes, où les choses naissent, du feu, de l’eau ou des atomes, sans règle ni loi imposée par un roi ou un dieu. On ne connaît pas de divinité pour la pesanteur. Quand le logos devient une proportion, il annule, par l’effet de son rapport, un peu comme une fraction se réduit à sa plus simple expression, les bouches qui le disent et les ordres qui l’imposent, de sorte que se conservent seulement les relations du monde au monde et celles de la chose à soi-même. Le logos nouveau devient la relation entre deux anciens logoi ou énoncés. Il existe des objets dont l’apparition et la naissance ne dépendent pas de nous et qui se développent tout seuls en rapport avec d’autres objets du monde. Le logos rationnel qui répète deux fois, en grec et en latin, la proportion ou le rapport, parle sans bouche humaine comme une loi hors la loi, à partir de cette transcendance. Chez ces physiciens du premier âge, ce qu’on prend pour une affirmation volontaire d’athéisme et qui en reste une, au demeurant, consiste certes à sortir des religions et de la mythologie, mais en tant qu’elles expriment et consacrent des rapports sociaux. Le monde apparaît, naît, a lieu, va, hors la cité, sans elle: peut-on supporter, dans la polis antique, un tel apolitisme? Non. Il faudra pour l’assumer, une autre transcendance, savoir une religion qui pousse à sortir du sacré, des contraintes écrasantes de la société.
Le pharaon Chéops, divin, tout-puissant, représentant le corps social, fait bâtir sa pyramide pierre à pierre par le peuple et Thalès la mesure sans que la proportion découverte tienne compte en aucune façon du roi, de son ordre, de sa tombe ni de ce rapport politique de l’un au multiple. Le logos-proportion chasse le logos-discours, il existe une loi ou un ordre qui ne connaît pas ou que ne connaît pas l’ordre ou la loi sociale, et le pharaon meurt une nouvelle fois. Reste le polyèdre vide, une forme transparente.
Le malheur voulut et veut encore que ce logos insupportable aux rois, aux sociétés, au langage, se rapatriât dans les bouches et les volontés de puissance, irrésistiblement: retour à l’archaïsme presque inévitable que les Grecs ont vu ou subi comme nous le subissons. Le logos-proportion revient dans le discours et dans la clôture sociale: irrationnel ou rationnel, il ordonne le tissage du Politique, éduque les gardiens de laRépublique et Socrate écrase Calliclès, dans le Gorgias, par l’égalité géométrique toute-puissante parmi les dieux et les hommes. Il redevient de la mathématique pour sciences humaines. Malgré ou par l’effort duTimée, l’invention inaugurale d’un objet-monde indépendant de nous s’effondre à nouveau dans le collectif. La politique, les sciences humaines, les mythes ensemble et tout uniment ont empêché d’éclore la physique mathématique.
|
« Les savants, Calliclès, affirment que le ciel et la Terre, les dieux et les hommes sont liés ensemble par l’amitié, le respect de l’ordre, la modération et la justice et pour cette raison ils appellent l’Univers l’ordre des choses, camarade, non le désordre ni le dérèglement. Tu n’y fais pas attention, je crois, malgré toute ta science, et tu oublies que l’égalité géométrique règne, toute-puissante parmi les dieux comme parmi les hommes. Tu penses qu’il faut s’efforcer de l’emporter sur tous les autres: parce que tu négliges la géométrie. » (Platon, Gorgias.) |
© Extrait d’Éléments d’Histoire des Sciences, sous la direction de Michel Serres. Paris, Bordas, 1986.
Espace
En une région fort restreinte se concentrent Samos, où Pythagore naquit le Milet de Thalès et l’Éphèse d’Héraclite, sans parler de Pathmos, île où saint Jean l’Évangéliste se retira plus tard: source de l’arithmétique, de la géométrie et de la physique, soit trois définitions du logos, nombre, rapport ou invariant, sans compter celle du Verbe.
A élargir peu à peu le cercle, on rencontre les autres lieux producteurs de mathématiques ou de mathématiciens, l’île de Chios et tout le littoral d’Asie Mineure, de Cnide à Cyzique. Sur les mêmes lieux, on raconte que furent inventés l’écriture alphabétique, l’argent et la monnaie, la métallurgie du fer; et, un peu plus au sud, apparut le monothéisme.
Si l’on agrandit encore l’espace, la Méditerranée orientale dont voici la carte, Ionie, Égypte Grèce, Italie, sans parler de la Palestine, dessine l’intersection de l’Afrique, de l’Asie et de l’Europe, lieu de villes maritimes subissant dans le dos la poussée de grands Empires, égyptien, mède et Perse, bientôt romain et se retrouvant dans les échanges sur l’eau. De cette crevasse physique et humaine en activité depuis l’aurore des temps, ont émergé la science, nos religions, l’histoire et le gros des traditions dont nous avons vécu jusqu’à ce jour.
On s’y bat violemment aujourd’hui encore.
La période la plus active va de la fin du VIIe siècle à celle du IIIe et un peu plus avant soit plus de trois cents ans, durée qui équivaut à celle qui nous sépare de Descartes. Pendant les siècles qui suivent, Hipparque, Ptolémée ou Diophante inventent la trigonométrie, un modèle classique du monde « la première algèbre, mais le mouvement se ralentit beaucoup vers l’achèvement du millénaire qui s’écoule entre Thalès et Proclus.
Pour les résultats qui précèdent et préparent Euclide, les sources directes manquent et nous reconstruisons les choses à partir de textes de Platon ou d’Aristote, des Éléments et d’auteurs encore postérieurs, commentateurs ou autres, sauf rarissimes fragments. Nos seuls témoins parlent donc à une distance parfois aussi grande que celle qui nous éloigne de la Renaissance. D’où la fragilité de nos reconstructions.
Sauf exceptions, les producteurs se groupent en Écoles. Ressemblaient-elles à des centres de recherche et d’enseignement, à des sectes philosophiques, des communautés religieuses, ordres, confréries, à des groupes de pression, partis politiques, clubs ou gangs? Nous l’ignorons. Mais n’importe quel collectif ressemble peu ou prou à tout cela, mis ensemble, même aujourd’hui.
Les écoles
Fin du VIIe siècle av. J.-C.
1. Physiciens de Milet: Thalès, Anaximandre, Anaximène. Nature comme objet de science.
2. Pythagoriciens de Crotone: Pythagore de Samos. Nombres; duplication du carré; arithmétique, science fondamentale.
Fin VIe-Ve siècle av. J.-C.
3. École d’Élée: Xénophane de Colophon, Parménide, Zénon, Mélissos. Unité.
Milieu du Ve siècle av. J.-C.
4. École de Chios: Oenopide, Hippocrate. Quadrature du cercle; duplication du cube; trisection de l’angle; premiers éléments.
Ve siècle av. J.-C.
5. Sophistes et Mégariques: Hippias d’Élis, Euclide de Mégare. Quadratrice.
Ve et IVe siècle av. J.-C.
6. Atomistes d’Abdère: Leucippe, Démocrite. Premier algorithme infinitésimal.
IVe siècle av. J.-C.
7. École d’Athènes: Platon, Speusippe. Polyèdres.
Rattachés: Théodore de Cyrène, Théétète. Irrationnelles.
8. Écoles de Cyzique: Eudoxe de Cnide (Égypte, Tarente). Arithmétique; sections coniques.
9. Péripatétitiens: Aristote, Autolycos de Pitané, Eudème. Encyclopédie; histoire.
Fin du IVe siècle av. J.-C.
10. École d’Alexandrie: Euclide. Éléments.
IIIe siècle av. J.-C.
Archimède de Syracuse (287-212): spirale; grands nombres.
Ératosthène de Cyrène (276-195): géodésie; nombres premiers.
Apollonius de Pergé (262-180): sections coniques.
IIe siècle av. J.-C.
Hipparque d’Alexandrie: trigonométrie.
Ier et IIe siècle apr. J.-C.
Ptolémée d’Alexandrie (90-168): système du monde.
Fin du IIIe siècle apr. J.-C.
Pappus d’Alexandrie: géométrie.
IVe siècle apr. J.-C.
Diophante d’Alexandrie: arithmétique et « algèbre ».
Ve siècle apr. J.-C.
École d’Athènes Armée par Proclus (412-485): commentateur.