par Réda Benkirane et Erica Deuber Ziegler
Culture & cultures. Le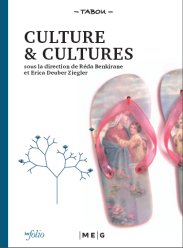 s chantiers de l'ethno (Gollion: Infolio éditions / Genève: Musée d'ethnographie, coll. tabou 3, 2006.)
s chantiers de l'ethno (Gollion: Infolio éditions / Genève: Musée d'ethnographie, coll. tabou 3, 2006.)
Ce livre collectif témoigne de l'éclatement actuel des sens que peut recouvrir la notion de culture et de ce que peut signifier pour un musée d'ethnographie le fait de traiter de cultures lointaines et proches à travers des objets et des thèmes d’ailleurs et d'ici, du passé et du présent. À quelle culture contribue un musée d’ethnographie en parlant de ces différentes cultures? Cette quête et cette interrogation interviennent dans une période de crise où il y a nécessité de redéfinir, d'une part, la fonction muséographique et, d'autre part, le travail anthropologique selon des pistes et des champs d'exploration nouveaux. Culture & cultures réunit ainsi quinze auteurs qui témoignent de leurs expériences muséographiques, apportent des éclairages variés et complémentaires et, enfin, exposent leurs interprétations qui ne manquent pas, parfois, d’être divergentes ou concurrentes entre elles.
Le sujet du livre trouve sa toute première origine dans un colloque intitulé «Culture & cultures» organisé en 2001 par le Musée d’ethnographie de Genève[1]. Il s’agissait alors de réfléchir au contenu d’un projet de nouveau musée[2], à la manière d’habiter son espace, d’organiser ses activités et d’honorer ses missions de service public: quels objectifs généraux voulait-on, quelles mise en place et présentation des objets et des cultures, quel choix des thèmes à aborder et, plus fondamentalement, quel sens voulait-on donner à l’action du musée, au travail ethnographique, aux relations entre humains et, en particulier, aux relations entre soi et les autres que ce travail engendre?
Il avait paru utile aux organisateurs du colloque de s’arrêter un moment sur les questions liées à l’usage indistinct d’un mot devenu omniprésent: «culture».
Le Musée d’ethnographie de Genève avait repris à son compte bon nombre des questions posées par les ethnologues: Fallait-il «brûler les musées d’ethnographie», comme se le demandait Jean Jamin en 1998? Fallait-il les démanteler, comme on était alors en train de l’entreprendre à Paris avec le Musée de l’Homme et le Musée des Arts Africains et Océaniens? Les remplacer par des musées d’art ou intégrer leurs collections dans ceux-ci, comme on venait de le faire au Louvre ou qu’on s’apprêtait à le faire au Musée des «arts premiers», futur musée du quai Branly? Devait-on, comme on le pratiquait avec brio au Musée d’ethnographie de Neuchâtel, en déconstruire inlassablement l’objet, dans une quête historiographique et épistémologique des conditions de leur constitution et du propos ethnologique? Était-il opportun de rebaptiser l’institution, comme le font aujourd'hui la plupart des musées, dits des «civilisations», des «cultures du monde», de «société»{C}[3]{C}, en neutralisant ainsi le qualificatif d'«ethnographie», apparemment déprécié du fait de sa connotation coloniale? Fallait-il, plus ambitieusement, devenir un centre d'interprétation du patrimoine mondial, en abattant au passage les barrières existant entre l'ethnographie d'ici et d'ailleurs? Ces problèmes étaient ceux que les musées d’ethnographie avaient hérités de leur propre histoire et qu’ils projetaient vers l’extérieur.
Depuis une quinzaine d’années, la position occupée par les musées d’ethnographie dans le champ culturel était effectivement en crise. Les difficultés rencontrées étaient liées à une série de transformations profondes survenues dans l’histoire contemporaine: libération politique des peuples, émancipation sociale, progression de la démocratie et des droits de l’homme, globalisation économique, élargissement de la notion de patrimoine et de l’accès populaire à la culture.
Si la mission des musées d’ethnographie à l’égard de leurs collections paraissait toujours relativement claire – conserver, étudier, comparer, mettre en valeur, produire et diffuser des connaissances – si de nouveaux types d’objets, notamment des objets de nos sociétés «développées» ou technologiquement avancées, étaient reçus dans la classe des objets ethnographiques, quels rapports les activités du musée devaient-elles entretenir avec la culture vécue des gens? Les musées devaient-ils simplement continuer à produire du savoir anthropologique et à éduquer? Devaient-ils initier le public aux arts? Lui faire partager l’accès au patrimoine le plus large possible de l’humanité? Former des citoyens du monde? Ou cibler les publics et leur offrir, pour leurs loisirs, des produits différenciés en fonction de leurs intérêts et des modes du marché?
En ce début de XXIe siècle marqué par la mondialisation, les nouvelles migrations, la coexistence obligée des cultures et la reconnaissance de l’égalité entre elles, comment les musées d’ethnographie allaient-ils parler des cultures et produire de la culture à leur sujet?
Le projet d’une approche raisonnée de la pluralité culturelle
Tout au long de la décennie 1990, le Musée d’ethnographie de Genève avait pris à l’égard de ces questions des positions affirmées, plutôt optimistes, centrées sur une vision humaniste de la pluralité des cultures[4]. Son directeur de l’époque, Louis Necker, avançait l’idée d’une sorte d’«écomusée» de la diversité culturelle, idée d’autant plus audacieuse que son auteur entendait prendre ses distances à l’égard des orientations du projet de musée du quai Branly alors en chantier…
L’optimisme et la combativité joyeuse du Musée d’ethnographie de Genève se lit en particulier dans le projet «Diversité 95», une manifestation lancée à la suite du sommet de la terre de Rio de Janeiro, en 1992, et qui s’échelonna tout au long de l’année 1995 pour la mise en œuvre de l’Agenda 21 et d’une politique de développement durable[5]. L’opération avait été imaginée par la Coordination Homme, nature, environnement[6] et aussitôt étendue de la diversité biologique à la diversité culturelle. Louis Necker, alors directeur du Musée d’ethnographie, décrivait dans La Mosaïque genevoise (1995) l’apport démographique, économique et culturel de Genevois venus d'ailleurs comme une source d’enrichissement matériel et spirituel, comme un trésor de tolérance à garder à tout prix. Deux forums, «Diversité I» et «Diversité II» (Aubert et al. 1996), firent en outre connaître et évoluer les questions les plus urgentes: sur la diversité considérée comme une richesse; sur la nécessité, pour éviter d’en être privé à travers l’homogénéisation du capitalisme mondial, de créer sans cesse de nouveaux mythes, des rencontres, des entrecroisements, de l’art, du renouveau, etc.; sur la réforme nécessaire des paradigmes de la connaissance et du langage pour penser un monde multiple; sur l’utilité d’un nouveau musée d’ethnographie à Genève pour y favoriser l’expérience de cohabitation heureuse d'hommes et de femmes issus des grandes civilisations de la planète. La manifestation fut un grand succès, un moment de bonheur, mais elle suscita aussi des critiques: on idéalisait la Genève pluriculturelle, alors que les situations vécues à Genève par les sans-papiers et les requérants d’asile étaient des plus difficiles, que le racisme (notamment anti-Noirs) était patent ou que l’absence de droits politiques pour les étrangers constituait un déni de la démocratie. À l’opposé, des critiques de droite traduisaient la crainte que la manifestation, en marquant un appui aux étrangers, en invitant à leur bonne intégration, ne favorisât leurs revendications à l’exercice de droits politiques ou n’accrût à leurs yeux l’attractivité de Genève.
La vision humaniste, qui s’était exprimée dans le projet «Diversité 95», cherchait à s’incarner dans une ethnologie contemporaine tout en se nourrissant des avancées majeures des sciences et en particulier de celles du vivant. En préservant les valeurs immatérielles des choses et des cultures, en se préoccupant de l’histoire vivante[7] sans toutefois focaliser uniquement sur les cultures lointaines, l’ethnologue genevois Louis Necker voulait par là même déclassifier les sociétés dites «traditionnelles». Ce faisant, il voulait approcher l’autre non plus seulement dans les termes – souvent convenus – de la culture savante, mais en lui donnant la parole et en favorisant, au sein même du musée, l’expression des cultures et des expériences vécues. Pour enrichir cette vision de l’homme et des cultures, il fallait pousser encore plus et mieux l’étude des productions culturelles, nourrir la comparaison entre les cultures du monde, contribuer à leur compréhension, éclairer leurs interactions, montrer les coexistences et les communications interculturelles possibles, profiler les distinctions mais aussi les réciprocités qu’elles impliquent – notamment pour se garder des replis d'ordre nationaliste ou ethnique. Mais pour pouvoir véritablement comparer des cultures entre elles, encore fallait-il pouvoir disposer d’une connaissance des profondeurs. Le musée se devait donc de poursuivre des travaux ethnographiques de chercheurs confirmés appelés à s'engager dans des terrains nombreux et variés.
Du flash au clash civilisationnel
Dès 2001, cette politique muséographique se vit contrariée par un certain nombre d’événements qui affectèrent l’évolution du Musée d’ethnographie de Genève[8]. La réflexion se poursuivit néanmoins dans la situation vécue de mondialisation et de dissolution des liens sociaux traditionnels, où l’on assistait comme jamais à la manière dont les cultures – des différents groupes sociaux, des générations, des classes, des sexes, des immigrés de diverses provenances – s’affichent, interagissent, se métissent, résistent, se recroquevillent et co-évoluent vite par emprunts, contaminations, nouvelles synthèses, réactions et créations. Dans le contexte d'un brassage culturel accéléré, comment populariser les acquis les plus récents de l’ethnographie et de l’anthropologie, faire comprendre à un large public les mécanismes humains (biologiques, psychologiques, etc.) et sociaux de la création culturelle?
Ces interrogations survenaient en même temps que des événements d’une tout autre gravité – les attaques du 11 septembre 2001 sur New York et Washington. Ceux-ci allaient radicalement changer le cours du monde pour l’engager dans une ère de turbulence, marquée notamment par une guerre générique «contre le terrorisme» et «l’axe du mal». Derrière cette rhétorique d’une Amérique profonde, mue par une religiosité zélote mais ébranlée par la découverte de sa propre vulnérabilité, l'Europe allait être prise en otage et sommée de s’engager de gré ou de force dans l’affrontement interculturel, entre croisade et jihad, où l’islam allait servir de repoussoir métaphysique et de bouc émissaire géopolitique.
La théorie du clash des civilisations, cette bible géostratégique des conservateurs américains développée par l'historien Bernard Lewis et le politologue Samuel Huntington{C}[9]{C}, a cherché à trouver un remplaçant à l'ancien antagonisme structurant entre capitalisme et communisme. Et dans une certaine mesure, cette tentative a abouti. Le monde se pense désormais non plus en termes d'opposition entre libéralisme et économie planifiée mais entre Occident et Orient, entre club judéo-chrétien et coalition objective islamo-confucianiste. Ce choc des civilisations devient existentiellement déterminant à partir de trois postulats de base: le spectre de la démographie des pays du Sud, le spectre de l'islam et celui de la montée de l'Asie sous la formidable poussée chinoise. Or, ces trois postulats – qui expriment une sublimation
