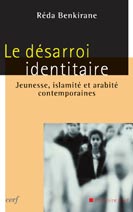
Réda Benkirane, Le désarroi identitaire. Jeunesse, islamité et arabité contemporaines.
Préface de Salah Stétié, Paris, Editions du Cerf, 352 pages, 2004, La Croisée des chemins, Casablanca, 2012.
[ English Abstract | Préface | Table des matières | Extraits | Fiche-livre éditeur | Revue presse | Revue de livre ]
Extraits
Chapitre 1. Hijra, l'aventure identitaire ( Une généalogie d'avenir ) | Chapitre 4. Le désordre et le plus grand nombre | Chapitre 8. Badawa (11 septembre 2001, 14h00 CET)
Voilà, à la fois, la bonne et triste nouvelle du siècle qui s'ouvre : la seule aventure qui vaille la peine est la migration (hijra) et l'exil (ghurba) ; tout ce qui s'inspire de l'hégire. La migration qui se donne à voir au large de Gibraltar préfigure, aujourd'hui de manière dramatique, la grande vague qui remontera, demain en brise bienfaitrice, sur les berges de l'abondance inquiète. Elle porte le message d'humanité qui, de témoignage en témoignage, transformera le monde en quelque chose de meilleur. C'est dans cette dérive que, perdus, hors d'eux-mêmes, ces hommes donnent le meilleur d'eux-mêmes. Nous commençons à peine à comprendre combien le monde a un besoin sincère, profond de cette participation. La jeunesse, son nombre, son teint, l'ancienneté de ses cultures dont la beauté va en certains lieux jusqu'au vertige, font de ces migrants des spécimens précieux. D'une certaine façon, la pauvreté les protège : seule la lumière les inonde. La mutation explosive de l'artefact – croissant en organisme, population et nation artificielles – n'a pas eu tout à fait raison de leurs pensées subtiles, de leurs corps alertes, vibrant aux mille désirs, de leur cœur qui entend et voit bien plus loin que notre horizon. Face à l'être-machine qui consume son énergie psychique dans le virtuel et le simulacre, ces êtres-là restent encore de l'ancienne facture, de la teneur qui allie la pensée agile au grain de la peau. Cette jeunesse itinérante est capable d'ascèses (petite, grande ou calendaire), travaille encore de ses mains, fait encore l'amour – souvent, longtemps – sans écran (plastique ou publicitaire), piqûre ni additif aucun, enfante une progéniture bruyante et insouciante, protège le vieux comme un orphelin. L'eau pour ceux-là est précieuse ; leur hygiène impose la lente sudation puis le gommage du corps pour en soulever toute la crasse. L'ablution est leur rituel quotidien. En voyage, ils mangeront volontiers à la table du juif et dormiront de préférence dans les draps du chrétien. La menthe, l'olive, les dattes et le miel sont tout leur aliment. Le chanvre est leur vigne. Posant le carré d'une étoffe, pour se câbler, l'espace de deux génuflexions, au nombril terrestre, ils prient sur un quai de gare, dans un hall d'aéroport ou un couloir de métro. Parce qu'ils sont les récapitulateurs, ils accueillent dans la tolérance et par la transcendance tout ce qui fut avant eux. Nés d'une argile crissante, ils sont encore la source claire : la voie médiane de l'humanité (ummatan wassatan).
Marocain, je suis occidental dans le sens le plus littéral (maghribi), à sa pointe la plus extrême. Dans mes veines coule un riche mélange ; aristocratie andalouse, tribu berbère et descendance noire de princes et d'esclaves. Globe-trotter, j'ai parcouru le monde avec Ibn Battouta et fait reculer les terrae incognitae, je suis l'auteur avec Al Idrisi d'une géographie universelle qui instruisit depuis la Sicile de Roger II sur la totalité du monde et ses sept climats. À l'époque de Charles-Quint, je meurs en Abdelmalek, le premier des Saadiens, pour faire vivre mon royaume ; j'ai tué au cours d'une bataille mémorable Don Sébastien, roi de Portugal et son complice – mon frère félon, maudit soit-il. Plus tard, je revis en ces lettrés qui parsèment les écoles religieuses (médersas). Je sens partout monter la confusion et enfler l'anarchique dissidence (siba). Je suis de ces hommes qui mènent la course depuis Salé, piratant jusqu'au large des côtes de Grande- Bretagne. J'aime l' é tranger, ses étoffes, ses femmes poudrées, son art et ses breuvages enivrants. Chez lui, je suis chez moi même s'il manque l'appel du minaret et que parfois j'ai recours à l'interprète. Aux temps modernes, je traite avec les manufacturiers génois, implante un négoce à Manchester. Bourgeois, je suis homme de mon temps, monte en Europe où naît une première progéniture et j'assure la lignée pour ma descendance : depuis 1875, le textile fait ma toile. Avec l'administrateur résidant, me voici sbire ; je consens à le servir pour son meilleur et pour mon pire. Conscient du déclin du royaume, vendu moi-même, je renonce aux biens et à l'autorité pour circuler comme un gnaoui au culte vaudou, un illuminé bouhali ou un errant ‘isawi qui s'élève par la torture sur son corps christique. J'entre en confrérie où je chante et danse en attendant la mort. Bienvenue la mort ! Croyant m'éteindre alors que je suis absent, je me refais par la transe une santé et surtout une conscience. Je retourne servir le Roumi, pratiquant la politique de l'arcane. Ma théosophie, apprise tant d'années, sous l'urgence s'est vulgarisée ; elle s'est noircie, maintenant que je l'ai rendue en stratégie de guérilla. Je suis le guerrier véritable, invisible et silencieux ; avant et après la guerre, je suis toujours le docile. J'attends mon heure entre les hauteurs d'Anoual (1921) et des Aurès (1954). Intrépide, ma loyauté parle d'elle-même : désintéressé, j'ai fait deux guerres mondiales, Verdun et le Mont Cassin. Alors que les vieux officiers chantent encore mon courage absolu, le Roumi, le Gaouri méridional me tutoie spontanément et croit me mener à la baguette. Qu'il maltraite les miens ou les déporte et me voilà sa hantise. Qu'il vide tranquillement son chargeur sur ceux de ma tribu, à mon tour, sans sourciller, je viendrai lui ouvrir le ventre ou lui trancher la gorge. S'il m'en prenait l'envie, du bout de ma plume, par écriture magique et à distance, je l'enverrais se tordre dans les airs. Avec l' é mir Abdelkrim, je deviens ce secrétaire indigène-indigne qui sera cet ennemi irréductible de la France, de l'Espagne et du sultanat défait. Craignez ma colère – évitez-là, je ferai vos prochains Vietnams -, elle est imprévisible, indélébile. Je suis l'aube rouge du tiers-monde… et son crépuscule.
Vieilli avant l'âge, je me meurs. J'ai brisé mon dos, mes bras à construire des morceaux de France – nation ingrate qui ne m'a jamais regardé. Prolétaire édenté, immigré au visage fermé, à l'accent impossible, je n'ai fait ni guerre ni école mais j'ai accumulé de l'argent pour tout le groupe. J'ai labouré le goudron, le béton, les terrains vagues, balayé, récuré, débarrassé du monde la laideur qui a fini par déteindre sur moi. Je suis cette longue et mortelle caravane qui, chaque été, dort au bas côté de la route, traversant l'Europe et la mer pour sentir l'odeur de la terre qui m'a vu naître, régaler ceux de mon sang. Tous, d'où qu'ils soient, sont moqueurs à mon passage. Toute ma vie, j'ai souffert, à force d'avoir donné. Mes enfants grandissent, dignes et fiers, mais toute ma vie, j'en ai payé le prix, bavé, sué, pué, souffert sans jamais vivre. Je suis la honte des deux rives, la poussière qui fait ce ciment qui fait l'histoire. Dieu est témoin que si je n'allais pas à la poste envoyer mon chèque tous les mois depuis presque un demi-siècle, trois, dix pays feraient faillite, ne pourraient vivre. J'ai construit ici un grand pays, et de la sueur de mon front, depuis ce froid intense et ces journées sans lumière, j'ai fait construire des villages entiers et nouveaux dans mon bled, plus bas au Sud. Sous la mine ou la grue, au milieu des fraiseuses ou des rails, les versets chantent à mes oreilles, ils vibrent en moi l'inculte. N'eût été le Coran, mon compagnon le texte-imam, que je récite et accueille dans la cave de la cité, je serais sans honneur. Que Dieu fasse donc de nous une forêt et que tous les gens soient bûcherons !
Emigré de luxe, je voyage, esthète solitaire, depuis l'enfance. Ma famille sillonne l'Europe depuis un siècle. N'ayant pas eu l'habitude des contraintes, j'ai goûté au dépaysement depuis que je me souviens. Ce n'est qu'à l'âge adulte que j'ai assumé vraiment, radieux et détaché, l'errance. La guerre lointaine, l'idéologie sont de vieilles blessures ; ayant assimilé d'une traite la géopolitique de la guerre des Six Jours avant le monde des dessins animés, j'aurai toujours de la pudeur à m'émerveiller devant le bel Occident. Doué mais pouvant mieux faire, j'ai poursuivi l'éducation en m'abreuvant à la source de l'intuition – trajet plus court, mais dont la reconnaissance impose le détour par la pensée en solitaire. Je suis l' é tranger chaque fois que ce n'est pas de mode. Sur mes seuls nom et prénom, j'ai endossé le malheur et l'exotisme du monde, la religion des uns et les amours-défaites des autres, expliqué, énoncé-dénoncé, revendiqué la différence. é reintante, inutile pédagogie de l'altérité. L'appartenance est une prolongation qui m'est formellement interdite, la communion de groupe est chez moi une flamme brève. Je n'aime pas le pouvoir ni ne le crains vraiment, j'aime mais évite la foule.
Dispersé, je ne me reconnais qu'en la confrérie de la migration et de l'exil (hijra wa ghurba). J'ai traversé tant de lieux bien avant tout le monde que je me suis perdu. Je parle trois, quatre langues, et n'en maîtrise vraiment aucune. À tous, j'ai posé une difficile équation d'histoire-géographie. Je quittai cette première station de solitude pour une autre terre si accueillante. Trente années vont passer : étudiant, ami, amant et frère toujours de passage, j'ai transgressé avec joie et douleur les barrières sociales, et reste à cet égard un pionnier de la première génération, car je suis, comme dit le philosophe français Georges Canguilhem, « celui dont on ne sait qu'après qu'il est venu avant ». Je n'ai pas regardé mon rang ni la carrière et me suis exercé à voir le monde sous l'œil du pauvre et l'allure du serviteur ; excellente, instructive sociologie ! Chauffeur pour bédouins opulents, porteur d'armes pour les plus radicaux et convoyeur de devises pour des nécessiteux, colleur d'affiches, intendant et secrétaire de VIP ; dans l'antichambre – une vraie école – de l'histoire, j'ai été l'ombre de l'ombre, moi qui attendais cette montée vers la lumière. Les hommes de la Jahiliya m'ont trompé, ou plutôt c'est moi qui ai présumé de leur souffle et puissance. Leur verbe m'a ravi, je l'ai pris pour une émanation du Livre. Erreur fatale. N'étant doué ni pour les révolutions ni pour courtiser le Prince et encore moins pour m'assimiler aux projets de l'ancienne Métropole, bizarrement, je suis sorti indemne de drôles d'histoires qui font en certains coudes la grande histoire. Inutile, inoffensif, je suis irrécupérable. Je me suis moi-même éliminé, m'écartant du chemin pour me fondre dans le paysage.
Emigré sans retour, fils d'une longue bataille, je n'ai pas choisi l'étape finale qui s'est imposée à moi : toujours ailleurs. Sur ma route, je n'ai pas regardé en arrière, mais je n'ai rien oublié. Sans même le vouloir, j'ai renoncé aux biens, à la parenté, aux amis et compagnons de route. La solitude m'a grandi, elle seule m'euphorise mais elle épuise mon corps autant que la prière longue distrait mon intellect. Qui suis-je donc, moi, somme impossible de tous ces ancêtres ? D'où naguère suis-je parti et où maintenant irai-je ?
Extrait de Le désarroi identitaire. Jeunesse, islamité et arabité contemporaines de Réda Benkirane (Paris, Cerf, pp. 22-28).
 Le désordre et le plus grand nombre
Le désordre et le plus grand nombre
Dissémination contre discrimination.
À la fin étaient le croisement et le métissage. Alors que les hommes remontent vers le nord, les mots virent vers le sud. Les uns sont présentés comme des envahisseurs, les autres comme des particules à vitrifier. Tous ignorent les frontières et se transcendent dans l’adversité. Venus du froid, les concepts mûrissent en pleine lumière. Mandatés comme médiateurs par les groupes dominants, ce sont avant tout de nouveaux venus. Prétentieux, ils cherchent à modifier une réalité autre ; immigrés, acclimatés, l’autre réalité les modifie. Partisans dans leur découpe du réel, intégristes au départ, ils finissent intégrés dans leur milieu d’accueil. Burinés par le soleil, limés par les vents de sable, nomadisant sur des terres inconnues, humbles, polygames, pirates, passeurs, les mots… cessent leur existence à sens unique.
Montant vers le continent d’abondance et quelques archipels isolés, l’humanité retisse des liens de survie. J’ai vingt ans ; cubain, je veux parcourir le monde pour voir si j’y suis : les voyages formeront ma jeunesse. Pakistanais, qu’importe, ou Philippins, fuyons la misère du plus grand nombre, choisissons encore l’esclavage sur la banquise de sable : sous nos pieds gît le pétrole qui fit d’une poignée de Bédouins un peuple pingouin et manchot. Vietnamiens, Cambodgiens meurtris par les mots, l’insoutenable douleur de l’être vous pousse vers l’autre rivage : excellez dans le labeur quand vous saviez l’enfer par idéologie interposée. Toi, contestataire douillet, menuisier à Casa, tu as un frère ouvrier à Bruxelles, tes grands-parents tiennent à leur bled ; deux oncles et leur progéniture se sont fixés en Italie. L’autre, cairote d’adoption, entasse tous les siens dans la terrasse d’un vieux quartier ; ingénieur de formation, il s’exporte, main-d’œuvre servile, vers l’État bédouin, Libye ou Émirats : passeport confisqué, mais un salaire servira tout de même à la prise en charge du groupe surnuméraire. Lui, commerçant à Dakar, vit dans une baraque, un HLM avec dix des siens, tandis qu’un autre segment poursuit l’exode urbain à travers Sarcelles et Vaulx-en-Velin. Observez encore, touristes et ethnologues-apprentis, l’habitant du coude du Draâ : des franges atlassiques jusqu’aux dunes du Grand Erg, il travaille son argile avec l’amour pour engrais. Assemblant géopolitique, foi et écologie du lieu, le paysan mystique est surtout créateur. Par dizaines de milliers, ses congénères, mandatés officiellement, émigrent vers la station d’Irak, là où s’échangent dextérité et savoir-faire en matière de domestication du désert.
De nouvelles configurations travaillent les masses populaires. Tout s’opère dans le champ aveugle de l’urbanisation. Autrefois, observer la pyramide humaine suffisait pour donner à voir sa brique élémentaire, l’homme, en discrète présence. Désormais, le théâtre c’est la ville. L’individu, c’est l’acteur de premier plan, mais il reste à deviner, dans l’arrière-plan, quel est précisément son édifice social. Ainsi la tendance à la cellule familiale mononucléaire et la percée de l’individu qui la détermine sont-ils des modèles socioculturels émergents. La force de parenté, primat de l’ex-ruralité, n’est pas pour autant intacte, ni annulée, elle est voilée par l’écran du réel, artifice de la nouvelle urbanité masquant les précédents habitus. Le lien, liant humain distendu par l’urbanisation, est tout en dispersion. Mes carnets d’enquête grouillent d’histoires de vie où la famille éparpillée configure des représentations du monde, des espérances à venir. Il faut savoir attendre, Dieu est avec les patients… Ce qui paraît à première vue comme un éclatement du groupe est en fait un redéploiement : à l’origine, le mouvement microscopique est totalement spontané, mais il finit un jour ou l’autre par révéler sa portée stratégique qu’il faut savoir développer. Nouveau phénomène, la dissémination nous renvoie à l’antique mobilité des groupes. Le lien consiste en ses fragments parsemés dans tous les points du globe.
La tribu, le clan et la famille élargie ont perdu de leur cohésion, mais ils gagnent en dispersion géographique. Ce qui fuit irrémédiablement là s’épanche probablement en un là-bas, plus haut. Les périphéries denses et turbulentes qui s’étirent à l’horizontale s’apparentent aux banlieues de type parc ethnique, pointant leur inégalité à la verticale de la tour grisée. Rien ne se perd, tout se transforme. Ce qui s’évapore par des années de sécheresse se condense un jour sous climat tempéré. Traduits en rendement économique, ces sillages – soit les sommes des trajectoires de vie – sont des flux de résistance devant l’inégalitaire système : intégration des grands (en ensembles régionaux, trusts, lobbies, médias et forces de frappe) et désintégration des petits (minimes, mineurs, masses appauvries). La mise en réseau des chaînes humaines embrasse le monde ; coupons les chaînes, et le monde, décousu, insoutenable, éclatera par perte du sens, car les hommes sont comme cette matière sombre de l’univers mue par l’énergie du vide.
Toujours, la dissémination l’emportera sur la discrimination.
L’humanité solidaire est une humanité dispersée, voilà le paradoxe.
Première ébauche.
Maintenant que la vague islamiste la plus radicale s’éloigne, il reste à comprendre ce qui se passe encore au quotidien dans l’espace des grandes cités. Ici, c’est l’observation directe qui nous l’impose, à l’horizon du plus grand nombre. La question surgit au premier plan dès la révolution iranienne. Si elle s’ancre maintenant dans l’aire islamique, ce n’est que pour se déployer plus amplement, en dépassements, dans le troisième millénaire. Il faut d’abord extraire la notion d’islamisme de certains de ses mythes dissipateurs. C’est à partir du terrain sociologique, des Philippines au Maroc, que se signale une méthodologie intrinsèque au phénomène observé. Cet islam-là ne s’exprime a priori pas dans l’écume intérieure (batiniya) d’une pensée locale ou globale, sa force ne se soupèse pas non plus dans la digression théologique ; malgré un discours de grande allure, la vision n’émane nullement des séminaires et de l’isolement avec soi-même, mais elle est le résultat d’une théologie, pratique, tout terrain dans l’espace urbain. La lecture islamiste du Coran, si elle procède d’une réduction tactique, par modification et restriction progressive du champ sémantique, reste malgré tout ambivalente ; on la range volontiers dans l’interprétation révolutionnaire et radicale. Mais l’on ne sait pas toujours comment elle devient réactionnaire ; par exemple dans ses connexions avec les principautés pétrolières, sa représentation monotone du monde et sa propension si caractéristique à se distinguer des autres mouvements d’opposition politique. Comment passer, par exemple, d’une théorie du tyrannicide – ambitieuse et pas toujours aboutie – à celle, prétentieuse, profane, qui découpe l’univers sensible en tranches licites (halal) et illicites (haram) ? Et de quel héritage – tribal – prétend-on briser les mosaïques de l’Islam par désir d’homogénéisation de tout, en proclamant l’interdit à longueur de discours et en vrac sur le soufisme, l’art musical et pictural, la mixité des lieux, la condition féminine, l’ijtihad (effort d’interprétation) novateur, et, plus prosaïquement, le jeu de dominos au café ?
Préambule avant nos propres déambulations. Les termes islamisme, islamiste ne sont pas l’invention de stratèges occidentaux et autres linguistes, hégémoniques ou abusés par la musique de leurs mots. Ces termes furent produits par le frottement avec le réel dur d’habitants serrés dans des sites impropres à l’habitation, souvent éloignés de l’éducation et du savoir. Mais, dans le même temps, ces noms témoignent de retours d’expérience allant du nassérisme au guévarisme en l’espace d’une vingtaine d’années ; randonnée à travers le spectre idéologique qui va du nationalisme arabe au marxisme-léninisme en passant par ses variantes les plus éphémères, les plus exotiques. Cette terminologie (islam-isme, islam-iste), qui s’articule sur le nom du troisième monothéisme, montre qu’elle est purement endogène d’où sa force, sa marque et sa démarcation explicitement assumée vis-à-vis du phénomène religieux ; à la bifurcation majeure séparant sunnisme et chi’isme ainsi que leurs arborescences respectives – elles-mêmes nourries d’innombrables voies, courants mineurs et scissions majeures –, il faudrait encore ajouter l’opposition entre rationalistes, philosophes spéculatifs, littéralistes et ésotéristes qui ont produit au cours des siècles des différences stylisées dans de multiples écoles de pensée. Il faudrait de même nuancer les niveaux entre religion savante et populaire, spiritualité des villes et des champs, culte du Livre et des saints… Enfin, il faut surtout ne pas ignorer l’ingérence de la violence politique, dès la mort du prophète Mohamed, pour se rendre compte que l’islamisme, phénomène contemporain, n’est qu’une petite vague, disons post-coloniale, insérée dans une durée de quatorze siècles englobant des centaines de peuples distincts.
L’« is(th)me » prononcé consomme d’emblée la rupture ; vu selon le point de vue interne, ce que d’aucuns considèrent comme un kyste, les protagonistes de la scène en question le projettent en prothèse. Expansion probable ou prétention dangereuse ? Le discours islamiste est à la pensée islamique ce qu’une milice est à l’armée, une espèce de scoutisme dont la force intellectuelle n’est vérifiable que par quotidienneté interposée. C’est au nom de cette dernière qu’elle fait sens et survit à toutes les dérives sociopolitiques. Dès l’instant où ce néologisme se coupe de sa racine première, spatiale (l’urbain), temporelle (le quotidien), l’échafaudage conceptuel se dé-contracte : il n’a plus espace ni moment pour être.
L’isthme découvert sur son propre socle avoue un cousinage, éloigné mais tenace, avec d’autres « ismes » témoignant des mondialisation et radicalisation d’une époque marquée en économie, en politique et même en sciences exactes par l’affaissement des grandes convictions et la montée de l’incertitude. Nous découvrons lascience de l’inquiétude, c’est-à-dire littéralement l’étude des phénomènes loin de l’équilibre qui abondent dans la nature. Tout autant que l’évangélisme contemporain, si vivace en Amérique – néo-fondamentalisme anglo-saxon, théologie de la libération sur sol amérindien –, l’islamisme s’éprend des médiums pour étendre sa sphère militante dans les grandes cités. C’est là où les paumés en masse cherchent du sens après leur épuisante inactivité, ou bien alors leur dur labeur à l’usine, au chantier, et, de plus en plus maintenant, leur longue exposition à l’écran-clavier, concourant ainsi à la digitalisation du monde. Ainsi les prêcheurs contemporains sont des self-made-men, virtuoses jouant de la musique blues, débitant des phrasés rap. Tout au long de ce siècle, ces discours contemporains n’auront formulé qu’une théologie politique, ou une idéologie du progrès, une de plus.
Mais nous n’avons pas encore abordé l’essentiel, le substrat, à savoir la dimension concrète (ici et maintenant), mais discrète (le tout ou rien), impliquée dans l’espace vécu. D’où la force, le souffle, l’emphase et, parfois, en quelques endroits aussi, la beauté de l’idéologie. Ce concret s’oppose à l’abstrait, cette inclination si ancienne de l’âme arabe qui guide son monothéisme, orne ses arts, distingue sa pensée.
Quant à ceux qui formulèrent le credo islamiste, ils se comptent sur les doigts d’une main : pour l’essentiel, Hassan El Banna, Abu A’la Al Mawdudi et Sayed Qotb. Ce mode de pensée affleure à longueur de journée, depuis des décennies, dans les terrains sociologiques : Casa, Alger, Tunis, Le Caire, Beyrouth… Ses véhicules sont la revue, la cassette et le haut-parleur, opérateurs culturels à destination de l’individu arabe contemporain – ils seront quatre cents millions d’ici un quart de siècle. Il faut noter au passage le rôle de la technologie dans la vulgarisation de la théologie. La filiation intellectuelle prend source à partir d’une dérive, celle de la Nahdha, « renaissance » arabo-islamique, contrecoup du mouvement des Lumières. Son principal lieu de naissance, l’Égypte, fonctionne pour le monde arabe contemporain comme un pays producteur d’idéologies : la modernisation initialisée au xixe siècle par Mohamed Ali est relayée par le réformisme religieux de Mohamed Abdou, que moralise et affranchit Hassan El Banna, pour diminuer devant la montée du nassérisme, avant d’être finalement reprogrammée, radicalisée par la grille de lecture de Sayed Qotb du corpus coranique. Voilà, prestement évoquée, la procession intellectuelle sur laquelle le discours islamiste prend forme. À ne retenir que sa stricte contribution à la pensée arabo-islamique, il n’y a là rien de remarquable, si ce n’est l’élégante logique démonstrative. En effet, pour se valider comme théorie religieuse, le discours islamiste a recours au raisonnement positiviste. Contrairement au message coranique qui se conçoit et se prouve par lui-même (condensé de la Création), la théorie prétendant construire une société idéale, par application du droit idéal, se fonde uniquement sur le recours à une proposition extérieure ; l’espace profane, jahili. Cet espace fournit, en négatif, des repères cardinaux. Espace d’autant plus vital qu’il se confond aisément avec l’espace urbain. Essentiel, l’espace de la Jahiliya permet la définition de ce que l’on est et voudrait être, en disant ce que l’on n’est pas et ce qu’on ne veut pas devenir. Ainsi, parce qu’on redoute le devenir non maîtrisé, on projette la métamorphose sur les autres pour mieux différer l’incertitude qui pèse sur tous, comme si l’on pressentait son funeste travail de l’intérieur. Aussi, d’un point de vue de logique pure, le postulat islamiste procède moins de l’énoncé coranique à proprement parler que de l’énoncé (méta)mathématique de Gödel sur l’incomplétude : une théorie ne peut se valider que par rapport à une prémisse externe au champ logique de la démonstration.
Végétations.
Les villes contemporaines sont les lieux de la nouvelle frontière, là où se métamorphose l’humain et germe une densité imprévisible. La nature, le ciel s’observent depuis l’écran, soleils personnels à domicile, même au ghetto, sous les baraques de tôle et de zinc coiffées de l’antenne parabolique. Le dehors est trop chargé de CO2 pour laisser augurer du temps qu’il fera dans l’heure qui suit. L’urbain est le paysage, l’horizon-limite, le milieu, le brouillard, ambiance, bruits, course, sillages chronométrés. On y vit en hauteur, baie verticale où le paysage est vitrifié, séjour et travail sages au-dessus du bruit et de la plèbe. On s’y entasse les uns sur les autres et non plus les uns à côté des autres. Ci-gisent sous terre ces tribus émergentes qui choisirent les bas-fonds pour habitacle – sous-sols en tous genres. Les coureurs de l’aube et du crépuscule s’entraînent au championnat du monde dans les bordures de l’autoroute périphérique, sous les fumées des bus et des camions. Des musiques tout terrain s’échappent des échoppes serrées et des véhicules multicolores – de la charrette au coupé sport cabriolet. Une jeunesse immense, séduisante toujours, parfois violente, rôde, mate le passant, s’habille, toujours un peu polyglotte, s’adosse aux murs, remplit les terrasses des cafés, circule et danse le long des avenues branchées. La publicité sur les murs et les franges d’immeubles livre sa messagerie quotidienne et façonne la culture mondiale. Une des voies d’éducation pour les pauvres est cette reconnaissance de caractère – eh oui, mnémotechnique – des marques américaines. Lucrative alphabétisation. La culture efface la Culture. La culture efface la Nature. Que reste-t-il quand tout est oublié, effacé ? Quittez le périurbain, il n’y a plus que des terres vides ou inconnues. L’anthropocentrisme se répand directement, proportionnel à la croissance des géantes bondées et souillées. La désertification avance, forêts et jungles reculent sous l’assaut des végétations humaines, usinières, technologiques, percées militaires et débuts de l’écologie multiforme : on ne sait toujours pas comment faire pousser la nature dans l’espace urbain.
Basculant dans la ville, le globe, réduit au pourtour, change de peau : déséquilibres de l’écosystème, multiplication des mégalopoles, excroissances démographiques. Vus depuis l’espace, nous, humains, mutons ; notre imaginaire avec ses connexions de fils et de câbles, d’ondes et de fumées, se voit maintenant en ces hauteurs. Cette membrane, nouvelle chair à penser de l’humanité, recouvre un espace beaucoup plus large que les continents physiquement finis. La membrane, organisme en formation, connecte toutes les formes de sagesses connues, toutes les traditions et philosophies aux sciences anciennes et nouvelles. Qu’en émergera-t-il encore alors que s’y créent chaque jour d’innombrables connexions, et que les arborescences poussent en étoiles ? Pour le meilleur et pour le pire, nous sommes un et infini, solidaires et dispersés.
Deux exodes : l’un rural, l’autre urbain. Deux mouvements, synchrones, une seule capitalisation, le réel happé : l’urbanisation est un phénomène complexe, contradictoire. Il est pratiquement impossible de l’observer de l’extérieur, à moins de s’arracher à la force de gravitation. Parties prenantes dans l’observation, parties constitutives du laboratoire. La nuit, les mégalopoles brillent pour l’orbite géostationnaire d’un satellite météo. De jour, l’émission de CO2 remplace celle des photons nocturnes. L’urbain s’étend en dérive de la planète projetée : béton et bitume impriment la marque, l’odeur, des plaques d’oxyde défigurent l’écorce du globe. Rupture ou recommencement, là se déploie le réceptacle inédit des sociétés à très grand nombre, marquant leur début dans l’histoire.
L’amnésie accompagne la partance. L’image du père s’estompe ; nouveau, le mélange instruit le procès du passé antérieur, hâtivement revisité, déraciné. L’histoire devient un miroir sans perspective, où se défait la durée propre des événements ; il y manque la profondeur de champ. Réducteur, le regard contemporain reste indifférent : seule transparaît sa jeunesse, immense et massive.
Loi des grands nombres.
Les villes sémites connaissent de nouvelles inaugurations. L’assaut du nombre s’épanche dans ces entrailles urbaines désintégrées et dégradantes que sont toutes les banlieues, marges et autres parties honteuses où vit, rit et meurt, s’accouple et pense le plus grand nombre. À partir de ces stations provisoires, fusent ces surnoms païens destinés à tout ce qui se conçoit dans l’urbain en version monumentale ; événements urbanistiques des pharaons nouveaux. Ainsi, par exemple, le monument des martyrs sur les hauteurs d’Alger fut dès son inauguration baptisé par le petit peuple du nom d’une idole préislamique, Houbal.
L’urbain agglomère des aires culturelles divergentes, décalées les unes par rapport aux autres ; chaque zone ignore sa voisine. Chaque ville du Sud est la somme des capitales du monde. Télescopage de foules.
À Casablanca, Alger, Tunis ou au Caire, il est des lieux relevant de cette autre centralité, où l’humble passant n’est qu’un spectateur déboussolé par la purulence inconcevable, selon lui, du « civilisationnel » et de « l’institutionnel ». Le discours critique sur cette centralité se veut, quant à lui, « insurrectionnel » : il n’est lui-même concevable qu’à partir de sa délocalisation, le lieu d’énonciation conférant alors, par effet combiné de territorialité, la légitimité du discours. C’est alors que nous découvrons la mise en réseau de logiques de survie, de bricolage, nées justement de la sous-intégration ou de l’exclusion. À partir de cette décentration effective dans l’urbain s’enracine le discours islamiste. Il prend ses points de repères dans la société jahiliya ; société de l’ignorance, mécréante à mœurs décadentes, identifiable à l’imitation aveugle d’un Occident hégémonique, que l’on sait proche sur le plan spatial mais qui n’est pas encore culturellement ambiant. Parce que, pour la première fois dans l’urbain pléthorique, la religion vécue coïncide avec un espace vécu, et lorsqu’elle s’érige en logique, c’est à partir d’un espace perçu ; celui où règne l’ignorance de la Foi et de la Loi. Par une sorte de glissement de terrain sémantique, l’espace-problème s’identifie à l’Espace-Texte. L’espace perçu renvoie alors à une glose intrinsèque où l’individu textualise l’espace qui le conditionne et spatialise le texte qu’il ambitionne de conditionner. Au bout de la démarche non consciente aboutit la pose conceptuelle d’un espace de définition ; quoique ancré dans le quartier, unité élémentaire de la ville, microscopique, il participe au projet islamique universel. Voilà de la sorte instauré un mode de pensée caractérisé par une invariance d’échelle et que certains estiment « prêt-à-penser » qui, quel que soit son destin à venir, par sa germination établit l’hypothèse d’une conjonction avec l’urbanisation débordante.
L’espace, en structurant les relations sociales, peut influencer jusqu’au vêtement qui, à sa façon, traduit non plus seulement des valeurs socioculturelles, mais plus concrètement encore des conditions d’habiter. Ainsi, par exemple, des vêtements féminins à l’origine conformes au canon islamique : leur succès est d’autant plus prononcé qu’il est tout à fait adapté aux conditions de vie et d’habitat du plus grand nombre ; nécessité de la séparation des sexes au sein de l’espace domestique (surtout lorsque celui-ci connaît un fort taux d’occupation), besoin du port d’un habit discret et protecteur pour circuler au sein de l’espace urbain via des transports publics bondés de jeunes célibataires, sexuellement sous-actifs et trèsfacilement excitables. De plus, sur le plan économique, l’habit « islamique » contemporain reste moins coûteux que l’habillement de type occidental tout en se démarquant très nettement par rapport au traditionnel haïk algérien ou à la djellaba marocaine. Dans les zones urbaines à forte densité, le port d’un habit soi-disant conforme au credo fondamentaliste procure aux femmes une sorte d’immunité sociale au sein de l’espace public, un moyen d’émancipation pour accéder, malgré toutes les apories, à l’étude et au travail. Relativisons : une tenue vestimentaire peut être ainsi porteuse de modernité à Khartoum, Amman, Islamabad, Kuala Lumpur et passer pour son contraire – archaïsme et signe de rabaissement de la condition féminine – à Mantes-la-Jolie, Bourg-en-Bresse, Bourgoin-Jallieu. Très étrange,l’inverse est tout aussi vrai, c’est-à-dire vérifiable immédiatement au quotidien : la minijupe ne semble vraiment pas adaptée aux lignes de bus suburbaines des villes du monde arabo-musulman (elle pourrait déclencher l’émeute) ; mais, pareillement, dans un établissement d’enseignement secondaire français, un simple foulard(hijab) suffit à provoquer une onde de choc nationale (grèves, manifestations, déclarations politiques, remous médiatiques et débats d’intellectuels). Une lecture superficielle arguerait du facteur culturel quand il faudrait aller à l’immédiat et au concret : il existe un lien structurel entre l’habit, l’habitat et l’habiter, peut-être plus fort encore aujourd’hui que ne le suggère la parenté des mots.
Le projet islamiste se veut tout autant mondial que mondain : c’est ainsi qu’il se fait reconnaître, visant l’accès de son courant communautaire au statut de gentry urbaine. Cette « noblesse » qui ne dépend pas de conditions matérielles, prétend à des qualités spirituelles, qui se donnent à voir : d’où ces petites affiches de mode que sont barbe, khôl, foulard, etc. Ces qualités « spirituelles » se caractérisent essentiellement par un nivellement des origines sociales et culturelles, des filières informatives modernes (socialisation religieuse et militantisme), et une perception de l’espace multipolaire : économique (lancer de nouvelles solidarités), social (demande spécifique d’équipements collectifs), culturel (nouvelle destination pour de nouveaux acteurs) et cultuel (le règne suprême dans l’urbanisme).
L’échelle « glocale ».
L’invariance d’échelle est une des particularités de l’islamisme : cet aspect à la fois local et global des pratiques et du discours prend forme dans les grandes cités. L’invariance d’échelle indique que les problèmes dont il est question résonnent et se traitent indifféremment aux niveaux micro- et macroscopique. L’islamisme intègre autant la singularité que l’universalité des conditions d’habiter. Ceci s’éprouve sur les terrains sociologiques les plus variés et se donne à voir pour peu que l’on détaille les monographies de quartiers populaires comme ceux d’Imbaba au Caire, de Belcourt à Alger et de Ben M’sik à Casablanca.
Ainsi, après les émeutes de juin 1981 qui touchèrent la capitale économique du Maroc, les autorités découvrirent avec stupeur la colère d’une large population vivant dans d’immenses bidonvilles suburbains. Le pouvoir avait alors compris qu’il fallait désormais cesser de cacher cette réalité en édifiant des murs blancs ; ceinturer cette concentration humaine revenait à délimiter une ville dans la ville. Le droit au logement était le seul moyen de fournir aux habitants l’accès définitif à la citoyenneté. Une opération de recasement fut mise en place. En 1982, le projet d’une ville nouvelle commence. Chantier immense, la cité neuve aurait pu être une œuvre grandiose.
Qui étaient au fait ces gens qui vivaient depuis des générations en périphérie urbaine, ce plus grand nombre situé au voisinage, proche mais invisible, du plus petit nombre à la richesse extrême ? En quoi se distinguaient les jeunes habitants du ghetto ? Certes, il y avait un mode de vie particulier : la précarité des conditions de vie – les mots font un écran de pudeur pour la dire –déterminait, en même temps qu’une promiscuité sociale, une solidarité de groupe et une sociabilité orientée pour l’essentiel autour de la famille et du voisinage. Mais cette observation de terrain, aussitôt formulée, était, d’une certaine manière, déjà orientée vers le passé. Car, avec la disparition programmée des bidonvilles et le recasement dans des cités anonymes, disparaîtrait également une bonne partie de l’édifice sociologique qui s’était implanté sous le zinc et la tôle ondulée. D’une certaine manière, les banlieues de Marseille, Lyon, Paris, Bruxelles, Amsterdam délimitaient l’espace des possibilités de comportement des habitants recasés. Pour appréhender le fameux distinguo culturel de la seconde génération, mieux valait désormais se demander : vers quoi convergent les jeunes habitants du ghetto ? Car c’est en voulant ressembler aux autres enfants de la ville que les jeunes de la périphérie révélaient le plus leurs comportements, leurs aspirations et leurs blocages.
Typologie familiale.
Après avoir recueilli, dans le cadre d’une enquête de terrain menée en 1988-1989, une centaine d’histoires de vie, nous avons vu rapidement se profiler trois tendances sociologiques parmi la classe d’âge des 15 à 30 ans ; une première tendance rapportait l’islamisme à une forme d’écologie sociale ayant raison de certaines nuisances de l’urbanisation ; une seconde tendance soulignait l’attrait de la petite migration (vers l’Europe) et en particulier par voie clandestine ; la troisième tendance rapportait la conduite individuelle de dissimulation de la condition bidonvilloise qui restait le fait d’une élite au sein de la jeunesse du ghetto (dans le royaume de l’apparence, certains choisissaient de paraître incognito). En marge de ces trois tendances, une typologie-limite rappelait, au cas où la bienveillance des habitants nous l’aurait fait oublier, que délinquance et criminalité n’épargnent jamais l’espace précaire. Évidemment, ces tendances pouvaient se mêler dans l’itinéraire d’un même individu…
Il nous faut d’abord resituer à leur juste place quelques éléments théoriques : l’islamisme que nous avons repéré est d’abord une praxis, c’est-à-dire une action transformatrice du réel, productrice de nouveaux rapports sociaux, avant d’être un discours à caractère politique, religieux ou philosophique. Dans ce lieu particulier d’énonciation, toute pensée devient artificielle si elle occulte ne fût-ce qu’un instant la contrainte centimétrée du corps entassé, non-citoyen, dans un habitat malpropre. Ce n’est qu’en multipliant les déplacements et les points de vue dans la ville, que le corps surnuméraire projette une pensée qui va s’incarner dans les méandres de l’archipel urbain. Non, ici et ailleurs dans les villes du Maghreb et du Machreq, il manquait de la place, du tissu pour simplement s’exprimer et vivre décemment : la fécondité des concepts islamistes se forge à partir de ce quotidien et de sa place dans l’espace urbain. C’est donc là que l’on peut percevoir la cohérence et la portée réelle du discours.
Jeunesse islamiste.
Première lecture possible : l’émergence de la mouvance islamiste a consacré une nouveauté au sein de la famille, à savoir l’importance de la pratique religieuse chez les jeunes et le rôle social qu’elle leur confère par rapport au reste du groupe familial. Désormais, ce ne sont plus les parents qui sont tellement porteurs de légitimité religieuse mais leurs enfants. Entre les deux générations, le décalage peut être plus ou moins prononcé. Dans les itinéraires biographiques, on constate souvent l’émergence d’une jeunesse radicale qui se démarque ostensiblement de ses parents : soit des jeunes en savent plus long sur le chapitre de l’islam, auquel cas ils ont droit de toutes les façons à une considération particulière, soit ils ont initié eux-mêmes leurs familles à la pratique religieuse.
Ainsi un jeune de quinze ans qui fait sa prière depuis deux ans peut être le seul de la maison à être pieux. Noble visage, air grave et mine renfermée, l’adolescent devient le personnage respecté même en présence de son père qui, lui, est tout à l’opposé : jovial et chaleureux, pas très sûr de ses opinions religieuses et politiques, mais plutôt bien dans sa peau. Le père a la cinquantaine, chauffeur de profession, titulaire d’un certificat primaire, il se dit « moderne » parce qu’il traite ses enfants comme des adultes, ne les frappe jamais, leur accorde une grande liberté, « celle du droit chemin », et considère qu’ils ont été mieux formés que lui car ils ont reçu l’« éducation musulmane ». Parfaitement bilingue (ce qui n’est pas le cas de son fils), il est très ouvert au monde extérieur, à tel point qu’il a laissé un autre de ses fils se faire élever par une famille française de Casablanca. Ce dernier ayant toujours grandi dans un milieu étranger, a fini par quitter le Maroc, et la famille était alors sans nouvelles de lui depuis plus de cinq ans. Plutôt que de percevoir deux choix contraires (migration d’un côté, engagement islamiste de l’autre) au sein d’une même famille, il faut saisir la cohérence de ces comportements : les deux fils ont opté pour des choix de leur temps.
Seconde lecture possible ; il y aurait une continuité entre la culture religieuse des parents et celle des enfants. On peut la rencontrer par exemple au sein d’une famille modeste et pieuse, entre un vieux chef de famille, fquih ayant quitté le Tafilalet trente ans plus tôt et dont un des fils est un étudiant universitaire, trilingue arabe-français-anglais, féru de culture islamique. Le père a enseigné toute sa vie dans des écoles coraniques(m’sid) y compris au bidonville de Ben M’sik où il y instruisit les enfants du voisinage. La relation qui s’instaure entre le vieux père, baigné dans le sunnisme traditionnel et local, et son fils, intellectuel marqué par la modernité et l’universalité de l’islam, est très parlante. Le fils parachève en quelque sorte l’itinéraire culturel et religieux du père. Le père dit apprendre beaucoup de l’islam contemporain grâce à son fils. Il dit être satisfait de l’orientation que prend son fils, dans ses études, la pratique religieuse, et ses fréquentations, même si, gros handicap, ce dernier ne gagne pas encore sa vie et, par là même, ne participe pas à l’amélioration des revenus familiaux. Le fils, licencié en linguistique, « entre en islam » à l’adolescence : du coup, il acquiert rapidement le bagage théorique de base des frères musulmans (écrits de Banna, Qotb, Mawdudi, prêches sur cassettes de Kichk). Mais alors qu’il poursuit ses études à l’université, tout en gardant ses convictions de frère militant, il élargit son horizon culturel au niveau de la pensée arabe contemporaine (la littérature chez Gibran, Mounif, Mina, Jabra, Nejmi, Raji’, Adonis,…) et islamique (les Orientaux El Afghani, Iqbal, Shariati, l’Algérien Bennabi,…). Le jeune homme aime les débats d’idées, la contradiction. Il s’est par ailleurs constitué une bibliothèque appréciable.
Troisième niveau de lecture : à y voir de plus près, c’est-à-dire à l’intérieur même de cette dimension islamique qui réunit père et fils, nous sommes en présence d’une situation de rupture. Les fils commencent leur parcours socioculturel par une entrée idéologique en islam qui les introduit dans des sphères religieuses trèscosmopolites, « radicalement » différentes des petits cercles tranquilles, pieux et traditionalistes des parents. Les jeunes sont désormais partie prenante de la déferlante islamiste ayant succédé aux divers mouvements de gauche qui tenaient jusque-là l’essentiel du milieu estudiantin. Ils sont une communauté engagée de frères et sœurs, déterminés à s’en sortir au milieu d’un espace précaire. C’est en soi un engagement de type citoyen et politique, la religion n’étant que le pont argumentaire, la voie conceptuelle de cette promotion socioculturelle.
Un bagage culturel.
La culture de nos jeunes islamistes se distingue de celle de leurs parents tout d’abord parce qu’elle se propage non par une tradition orale, mais par les moyens audiovisuels. La revue, beaucoup plus que le livre, et la cassette sont les vecteurs de cette culture de masse. La revue et la cassette s’intègrent à l’emploi du temps de l’individu contemporain, elles consacrent une sorte de fast-culture où l’on apprend en résumé et en accéléré. Destiné au plus grand nombre, le corpus théorique islamiste doit donc être rapidement opérationnel. Et il doit se donner à voir. Évidemment, ce bagage culturel s’acquiert le plus souvent au terme de ce que les acteurs considèrent eux-mêmes comme une « conversion religieuse ». La ville jahiliya est le cadre général où a lieu cette prise de conscience.
C’est par exemple ce que décrivent généralement des jeunes qui racontent que tout a changé le jour où ils sont « entrés en islam ». Tel petit fonctionnaire, pilier de famille âgé d’une trentaine d’années, considère que cette prise de conscience est ce qui l’a sauvé des maux sociaux de son quartier. Sa conversion a eu lieu en 1979, lorsque lui et sa future femme ont décidé de faire la prière ensemble. Après avoir triplé sa terminale en sciences expérimentales, il a finalement abandonné le lycée alors qu’il rêvait d’être médecin. Cette période a été pour lui marquée par un grand malaise ; n’étant plus motivé par l’étude, il fumait du haschich, consommait de l’alcool. Depuis sa conversion, il a compris le « vrai islam », s’est senti « revivre », sélectionne ses fréquentations, s’est ouvert aux « frères », renforce et affirme sa personnalité. « Pourquoi prier ? Je devais convaincre les gens avec des preuves universelles ». D’où la nécessité d’une « culture solide ». Comme il a de la difficulté à lire et qu’il traîne toujours pour finir un livre, notre ami fait en revanche une grosse consommation de cassettes de conférences et de cours. L’essentiel de sa culture est acquise par ce biais, reconnaît-il. La télévision joue un rôle dans la mesure où les programmes sont triés sur le volet : ne sont dignes d’intérêt que les actualités, les documentaires (sur la médecine, Connaissance du monde) et, de manière générale, ce qui touche aux domaines technique et scientifique. Quant aux films, il ne les voit guère, sauf s’il s’agit d’un sujet sérieux, d’un film religieux. Aujourd’hui, il n’écoute plus de musique, il lui préfère les hymnes religieux, les « poèmes islamiques » et « les chants d’oiseaux »…
L’étalage d’une culture disons aussi fine et tranchée dans ses choix pourrait prêter à sourire, mais il se trouve qu’un grand nombre d’individus ne connaissent que cette voie de connexion au réseau mondial des idées. Ce bagage culturel remplit un vide que l’État ne peut combler.
Libre et radical.
Parmi les jeunes « frères » qui présentent le même profil socioculturel, certains se dégagent du lot par un niveau de conscience nettement plus radical. S’ils ne sont affiliés à aucune formation politique, ils sont politisés et affichent clairement leurs opinions. C’est ainsi, au bord d’une plage, que nous nous entretenons avec un bachelier qui se permet de juger du bien-fondé de la construction de la grande mosquée de Casablanca ou de l’emprisonnement de certains « musulmans »… Issu d’une famille pieuse et puritaine, l’étudiant fait régulièrement sa prière depuis trois ans seulement et prétend connaître par cœur trois hizbs coraniques.
Illettré, son père s’est fait un peu d’argent en émigrant quelques années en Arabie Saoudite et en Libye. Rigoriste, notre bachelier évite le cinéma parce que, selon lui, il perturbe les esprits, et si son loisir préféré est d’aller à la plage, c’est près du port, là où rôdent les clochards, qu’il jette son dévolu ; il n’y rencontre pas de familles, pas de femmes… Lui aussi trie les programmes de télévision, bannit la musique (les chansons religieuses mises à part) et, bien évidemment, ne s’instruit qu’à l’écoute collective des cassettes de prêches religieux : l’égyptien Kichk bien sûr, mais aussi le prêcheur koweïtien El Qattan, les marocains El Tijkani (résidant en Belgique) et El Bachiri. Avec ses amis, il dit débattre positivement sur la religion et la politique, échanger activement livres et revues et pour écouter une conférence religieuse, dans un lycée ou une faculté, son petit groupe traverse parfois toute la ville. Ainsi, il est parti visiter deux fois l’exposition sur les lieux saints de l’islam qui avait été organisée à Casablanca cette année-là.
Le jeune islamiste exprime de manière pragmatique la notion d’invariance d’échelle qui caractérise ses idéaux : il ne fait pas de différence entre son quartier pauvre et le reste de la ville, car pour lui, la cité dans son ensemble est rongée par les maux sociaux : les problèmes de corruption, de mœurs, de drogue et d’alcool montrent à l’évidence que la société musulmane reste à bâtir. Il regrette au passage que l’argent massivement collecté pour l’édification de la grande mosquée de Casablanca n’ait pas été utilisé à d’autres fins, plus urgentes (« comme celle des bidonvilles par exemple ! »). Le jeune homme conclut, pour sa part, que l’édification du somptueux temple est une opération d’apparat. Mais il admet que le débat reste vif à son sujet ; certains de ses amis considèrent que la grande mosquée serait un lieu de prière licite une fois achevée sa construction [1993], alors que d’autres la récusent catégoriquement. Par ailleurs, il regrette que, trop souvent, de « bons musulmans » se retrouvent en prison. Et bien entendu, l’étudiant a beaucoup entendu parler de Cheikh Abdesslam Yassine, la haute et intrépide figure de l’islamisme marocain. Il nous dit son intention d’aller lui rendre visite un jour à Salé, dans sa résidence surveillée. Il est convaincu que le genre de lien social (rabita) que tisse Cheikh Yassine (libéré depuis lors) produit une génération positive de musulmans. Il compte faire prochainement partie d’une association à caractère religieux. « D’ailleurs, il y en a qui sont reconnues par l’État », précise-t-il, l’ironie dans le regard.
Un islam d’affranchi.
Si la prédication (tabligh) revenait uniquement à prêcher la bonne parole, nous aborderions là une dimension proprement religieuse. Mais, comme pour compliquer l’analyse, l’approche missionnaire nous rappelle également qu’il faut prendre en compte les facteurs sociologiques. Il faut préciser que le mouvement tabligh, né en Inde dans les années 1920, est un mouvement piétiste qui se distingue à proprement parler de l’islamisme. Sur le terrain, le tabligh promet à l’individu une libération entendue non seulement comme progression spirituelle, mais aussi comme émancipation sociale. C’est ce qui fait la force de la prédication, sur laquelle peut se greffer ensuite la propagande islamiste.
Il y a une mosquée à Casablanca, Masjed al Nour, où ont lieu des pratiques d’« écologie » du corps qui rappellent celles de la Nation of Islam, à Harlem. Pour peu qu’il accepte trois jours de compagnonnage dans ce lieu, on garantit au jeune dépendant de la drogue et/ou de l’alcool, une guérison complète et définitive. L’individu ressort définitivement autre. Nous avons rencontré un de ces miraculés « nettoyés », marin buveur et bagarreur, qui dépensait toute sa solde en soirées de bringue, de jeux d’argent, de coups de poing et de sexe joyeux ! Après la rencontre avec les jeunes du Masjed el Nour, du jour au lendemain, il fit peau neuve. Très peu de temps après, il prit femme et se rangea, pieux, sage et économe. Il avait eu pour seule obligation de recruter trois autres personnes soumises aux mêmes problèmes, afin de les ramener à la raison par la thérapie radicale du Masjed el Nour. Ce tabligh, qui fait une démonstration sans trucage entre « l’avant » et « l’après », fonctionne ainsi sur le principe de la chaîne arborescente, et le bouche à oreille suffit à en assurer la promotion.
Parfois aussi, le néo-islam affranchit ce que la tradition asservit. Ainsi de l’histoire éloquente et tragique d’un fils de la montagne berbère, qui a quitté son village natal pour le travail forcé en ville dès l’âge de huit ans. Pour expliquer sa servitude, le jeune homme invoque une coutume qui veut qu’un père envoie un de ses fils travailler en ville pour aider la famille. La tradition est aussi faite de ténèbres : dure et ingrate solidarité familiale ! Jusqu’à l’âge de seize ans, le jeune chelh va s’éreinter sans même jamais goûter à l’usufruit de son travail ; une fois l’an, son père descend de la montagne pour prélever la totalité de sa paye. Après huit années de dur labeur en tant que domestique et apprenti-crémier, il retourne au bled pour la première fois, y séjourne une semaine, puis repart pour Casablanca en compagnie d’un nouvel employeur déniché par son père. Au bout de deux années dans des conditions pénibles (nombre incalculable d’heures de travail en plus du réveil à l’aube), le jeune Berbère quitte la ville, tente un voyage à pied jusqu’à Tanger avec un groupe de petits commerçants itinérants, vit de mendicité quelque temps, puis retourne à Casa où il vagabonde (tacharoud) sans domicile fixe. Il finit par travailler à nouveau comme gardien auprès de riches bourgeois fassi,mais sa condition de pauvre illettré le laisse impuissant : un de ses employeurs refuse de lui verser les dix-neuf mois de salaire qu’il disait économiser pour lui. Le jeune homme poursuit sa vie de galère ; gardien, manœuvre, petits travaux dans différents endroits, boulangerie, imprimerie… Il décide alors d’apprendre à lire et à écrire parallèlement à son travail. C’est à cette période qu’il « entre en islam » : 1978, un gardien l’encourage à faire sa prière, lui fait rencontrer un « frère » de l’association jama‘at al tabligh qui aura sur lui une influence durable. Il se rend régulièrement à la mosquée, achète revues et livres, découvre les « frères », assiste aux débats qu’ils entretiennent. Il se forge aussi un caractère : il prévient ses employeurs qu’il ne veut plus avoir à servir de l’alcool ni à s’en approcher de quelque manière que ce soit. En 1987, des « frères et sœurs » lui présentent une « sœur » ; il se marie, loue une pièce et une cour à Ben M’sik, et lorsque son fils naît, il souhaite lui prendre une assurance sociale. Mais son employeur se montre très réticent quant à cette idée, aussi décide-t-il de le quitter. L’employeur fassi refuse de lui verser son solde. Le jeune homme, cette fois, s’informe auprès des « frères » sur son droit, s’adresse à un inspecteur du travail, va voir un juge. Il prend un avocat et porte l’affaire au tribunal. Depuis, il occupe des postes à temps partiel et vit en grande partie de l’aide que lui apportent des « frères » et des « sœurs ».
Cela fait huit ans que notre ami n’a plus revu son bled. Pour toute une vie si difficile, il dit n’éprouver ni haine ni amertume. Son passé est celui d’un autre, inculte et inconscient. Il dit avoir suffisamment fait pour sa famille de la montagne. Désormais, il cherche à construire le présent, sa petite famille et sa communauté de « frères et sœurs ». Mais depuis son « réveil », il a appris à défendre farouchement sa dignité, à ne plus jamais renoncer à son droit.
Entre drogue et piété.
Un des motifs les plus puissants qui ressort des histoires de vie du grand ghetto de Ben M’sik est celui d’un islam comme recours pour se prémunir des maux sociaux. De l’aveu même des principaux concernés, il n’y a pratiquement guère d’alternative ; c’est soit adopter la prière et l’éducation islamique, soit s’adonner à la colle, l’alcool à brûler et aux comportements délinquants.
Dans le cadre d’un habitat aux conditions de vie extrêmes, l’évolution ne connaît pas d’entre-deux : « l’islam ou le déluge ». Vivre à l’ombre de la mosquée, fût-elle en tôle ondulée, est garantie de protection, une voie certaine pour vivre au moins décemment. Ici, la pratique de l’islam devient un travail de maîtrise de soi qui doit produire un résultat concret. Beaucoup chérissent l’idée qu’il y a tout de même une voie de secours, une manière de renforcer l’hygiène du corps et de régénérer le monde mental quand tout, autour, témoigne de la déliquescence.
Par ailleurs, fait frappant, il y a un chemin oscillant entre la piété et la drogue ou l’alcool. Même si l’on n’a toujours pas réussi son « entrée en islam », on y pense, et l’on tentera l’expérience. Il faut évoquer ici les comportements délinquants d’une frange de la jeunesse sous-intégrée, qui voit à portée de main des antidotes. Un cas typique est celui d’un jeune homme d’une trentaine d’années qui aura connu une vie sans repères, partagée entre la toxicomanie, l’ivrognerie, l’emprisonnement, entrecoupée de périodes de piété. Orphelin d’un père qui s’est marié six fois, il vit avec onze autres personnes dans une simple baraque. Seules les sept filles de la famille étudient et travaillent. Quant aux garçons, ils aident peu ; leurs salaires sont vite dépensés dans les bars et la vie de célibataire. Le pauvre bougre n’a connu de l’école que quatre années en tout et pour tout, et encore il aura triplé. C’est que, dès la prime enfance, il reniflait de la colle « Silicium » et sa tête n’a jamais « capté » grand-chose en classe. Pendant trois années, il vend des cigarettes au détail dans la rue, devient plongeur un temps dans un cabaret nocturne et puis commence une formation d’apprenti-boulanger. Il se met alors à boire de l’alcool, abandonne finalement sa formation au bout de deux années, puis quitte Casablanca et parcourt un été durant les souks et les moussems des Doukkala. Il vend n’importe quoi et loge au hasard des rencontres. À l’âge de vingt ans, il revient au bidonville de Ben M’sik où il mène au grand jour une vie de dévoyé ; kif, sexe, boisson… Pris en flagrant délit de vol dans un magasin de tabac, il est condamné à trois mois de prison. Au bout de sa peine, il reprend de plus belle son mode de vie, écope en 1983 d’une seconde condamnation de trois mois d’emprisonnement. Dans sa geôle, le jeune délinquant découvre la prière. Il s’y astreint plusieurs mois. À l’automne 1984, alors qu’il fait ses ablutions devant une fontaine publique, un voisin, soûlard notoire, le provoque. Bagarre, injures… Le jeune homme sort profondément humilié de cet incident. Il rentre en pleurant chez lui, décide de porter désormais un couteau (genoui) sur lui. C’est que le malheureux vit de manière trouble, priant aux heures régulières et buvant du vin le reste du temps. Un vendredi, après avoir fait la prière collective, il descend en ville acheter quelques comprimés d’Optalidon. Au retour, il a vidé avec un copain quelques bouteilles de rouge. La nuit tombée, il regagne sa ruelle et s’arrête pour manger avec un groupe de religieux (tolba). C’est alors que le voisin, soûl comme d’habitude, l’aperçoit de loin et lui adresse de copieuses insultes ; il est rejoint par son frère, un « buisenassa » (dealer) du coin. Notre infortuné se dirige vers eux, sort son couteau de cuisine et commence à taillader le visage et le corps du soûlard. Il n’arrêtera de lacérer son adversaire que quand il l’aura laissé pour mort. Au commissariat, il sera battu pendant huit jours, aura les ongles arrachés. Le tribunal condamnera notre délinquant à cinq années de prison pour tentative de meurtre (la victime ayant eu la vie sauve). Libéré en 1989 à l’occasion d’une amnistie, il sort huit mois avant l’expiration de sa peine. Il mène la même vie instable mais ne désespère pas d’« entrer en islam » et d’y rester pour toujours.
Seule l’existence de marchés parallèles permet à la société sous-intégrée d’évoluer malgré la chaîne des apories. Le secteur informel représente près du tiers de la production de l’économie officielle, l’habitat dit clandestin assure le quart des logements fournis, les migrations illégales diffèrent les débordements démographiques. Le courant dit islamiste est directement branché à ces marchés parallèles en travaillant deux domaines qui finissent par mieux préciser leurs contours : Religion et Politique. La tension entre ces deux pôles attire le plus grand nombre.
En l’espace de trois décennies, le plus grand nombre a purement et simplement doublé sur des sites malpropres, mal préparés à l’urbanisation. Personne n’avait pu imaginer pareille échelle : seuls les travailleurs du terrain ont pu et su jouer les animateurs de groupe, bienvenus pour combler le manque d’infrastructure, supplanter l’État faible gestionnaire, modérer ou amplifier les gesticulations de groupe. Aucun parti politique ne peut concurrencer une mosquée, foyer où s’accomplissent de multiples tâches civiles : mairie, établissement scolaire, bibliothèque municipale, restaurant, maison de jeunes, agence matrimoniale, tribune politique,… Mieux vaudrait alors définir la mosquée par ce qu’elle n’est pas.
Le risque du marché parallèle est qu’il peut créer de la haute tension lorsque ses acteurs cherchent à l’édifier comme un observatoire sur le monde. Là, il doit être vu dans tout son relief, à la mesure de son échelle. Le marché parallèle est avant tout un laboratoire, où s’est tapie la dissidence, où s’accroît l’activisme et se prépare l’alternance.
Divers et dense, l’espace urbain.
Ici, il s’agit de considérer l’urbanisation comme un phénomène brutal et total, complexe et contradictoire. Irréversible, la révolution urbaine programme la fin de la paysannerie. Phénomène achevé sous les latitudes nord, il se diffuse à grande vitesse vers le sud. Au xxe siècle les plus grandes villes du monde étaient occidentales, à l’avenir elles seront surtout asiatiques, africaines et sud-américaines. En 2025, les deux tiers de l’humanité vivront dans les villes. L’avènement de la société du plus grand nombre. Comment habiter, alimenter, penser, gouverner la mégalopole de demain, spécialement ces géantes d’Afrique-Asie, comme Lagos, Le Caire, Bombay, peuplées de plus de 20 millions d’âmes ? En amont comme en aval de la nationalisation du territoire, l’urbanisation complexe nous révèle une société nouvelle, plurielle, surnuméraire. Urbanisation et démographie s’accouplent dans un espace-problème. Le flux est ingouvernable, comment le canaliser, sinon par des logiciels sociaux – écologiste et/ou islamiste –, le diriger vers des sites urbains secondaires, l’arrière-pays ? Qu’en est-il de l’agriculture, quand l’humanité délaisse ou échange la tourbe contre les champs de béton et de bitume ? Où commence et où finit l’urbain ?
Le plus grand nombre, hier appelé masses urbaines, révélerait deux principes émergents de l’urbanisation complexe et contradictoire : densité, diversité.
Le principe de densité ramène l’urbanisation à une sorte de condensation de la multiplicité socioculturelle. Cette condensation suppose à l’origine qu’il y ait un attracteur étrange : c’est la cité qui le fournit, et alors elle passe à la dimension de mégalopole au fur et à mesure de son accroissement. Métropolis, cité fractale. La haute densité renvoie à ces masses humaines soumises à l’attraction du champ urbain qui condense habitat et habitant et capte l’essentiel des activités culturelles et économiques du territoire national. Des pôles urbains comme Istanbul et Le Caire concentrent d’ores et déjà l’équivalent de la population de pays comme la Suisse et la Tunisie. Monopolistique, la mégalopole est une véritable Cité-nation au sein de l’État-nation. Volontiers connectée à d’autres villes de l’espace-monde, l’excroissance urbaine est trop souvent ignorante, oublieuse des terroirs – qui risquent à terme de devenir des terrae incognitae propices à la dissidence et à la guérilla. L’Algérois a goûté tout au long des années 1990 aux prémices de ces projections théoriques.
Bidon-ville, mot composé, né dans la Casa-blanca (« maison blanche ») des années 1920, se décline depuis en plusieurs langues – karyan, favela, geneçonduk,… – et décrit la palette variée de l’habitat des pauvres :carton, plastique, tôle, goudron, bois, pisé… Cette forme d’habitat précaire n’est que l’une des différentes catégories d’un secteur immobilier qualifié successivement de « clandestin », « spontané », « non-réglementaire », « non-structuré »… La difficulté de nommer, si ce n’est par la négative, dit aussi comment se déploie cette urbanisation à « structure dissipative », en recomposition permanente. Le principe de densité rapporte également la question de l’habitat à des normes de promiscuité sociale. Le taux d’occupation par pièce et l’espace vital par habitant traduisent au quotidien ce principe général. Au niveau du quartier, le principe de densité se repère encore et toujours à certains de ses conditionnements spatiaux. Le transport, la voirie, les fontaines et latrines publiques, la scolarisation par « roulement », les loisirs (du parc, au stade), les équipements sociaux (du marché au temple) constituent autant de séquences et de rapports provisoires – flux – de la densité du plus grand nombre.
Bidon-ville dans l’enceinte « Maison Blanche » : matières, bruits, odeurs. En dialecte marocain, karyansignifie bidonville. Les deux noms ont d’ailleurs les mêmes date et lieu de naissance. C’est dans les années 1920, à proximité de la centrale thermique de Roches Noires à Casablanca, qu’apparaissent les premières baraques construites à partir de matériaux des plus hétéroclites. Leurs promoteurs sont des ouvriers du chantier de construction de la centrale thermique, ils choisiront les abords d’une carrière pour implanter leurs logements sommaires. D’où le nom du premier « bidonville » : Carrières Centrales. Ce nom sera en définitive marocanisé pour donner karyan Centra. À partir de là, le mot karyan (déformation de « carrière ») désignera sur un mode générique cette forme particulière de quartier installé à proximité de carrières. L’étymologie du mot karyan et du mot bidonville n’est pas sans utilité. Elle postule la proximité constante de l’environnement industriel dans l’avènement de cette forme de croissance périurbaine.
Si on insiste volontiers sur l’origine rurale de la population bidonvilloise, on explique difficilement le passage de la hutte (nouala) ou de l’habitation rurale (tenkira) à la baraque. La baraque, tout comme la hutte, ne se construit pas, elle se monte et peut même à l’occasion être déplacée à dos d’homme. Mais à la différence de la hutte, la baraque emprunte des matériaux spécifiques de l’époque industrielle ; morceaux de bois, plaques de zinc, tôle ondulée, bidons de plastique, etc. Tout ce qui forme un fragment préfabriqué de l’industrie et qui est récupérable dans un chantier de construction peut alors participer à la composition de la baraque.
Les fondateurs de bidonvilles du Casablanca des années 20 et 30 ne sont pas seulement d’anciens ruraux, mais d’abord les premiers ouvriers qu’embauche la jeune industrie. Et ce n’est qu’une fois bien implantés que les bidonvilles accueillirent de manière plus ou moins directe les populations migrantes.
On peut distinguer plusieurs degrés d’ancienneté dans l’univers karyaniste. Les familles de pionniers (ceux des années 1910, 1920) restent introuvables… Comme si cette « promotion mythique » n’avait pas laissé de traces, ni joué de rôle dans la constitution de karyan Ben M’sik. Les plus anciens sont ceux qui se sont installés à la fin des années 1930 et au début des années 1940. Puis il y a la vague montante des années 1950 et, enfin, celle de l’après-indépendance. La population bidonvilloise est principalement constituée par ces trois grandes vagues de migrations. À ceux arrivés dans le Casablanca du débarquement américain, quel statut donner ? Quant à ceux venus à l’heure nationaliste, ayant directement vécu l’histoire de la résistance armée, doivent-ils être révoqués de la mémoire casablancaise du fait d’un exode initial ? Ce sont les anciens karyanistes qui présentent un profil de prolétaires, et les derniers arrivés qui s’assimilent le plus aux ruraux. Un cliché sociologique bidonvillois veut que la ligne de démarcation soit l’époque de la Résistance. Ceux qui peuvent aligner quelques souvenirs sur la période nationaliste se présentent à juste titre comme des anciens de la ville. Cette catégorie d’habitants, d’ailleurs, connaît bien Casablanca. Les vieux auront vu grandir la ville jusqu’à être défigurée. S’ils ne la reconnaissent plus, et qu’ils ne sont plus capables d’y circuler en charrette comme jadis, ils sont en revanche les seuls à se souvenir de ses mues antérieures. Aussi, lorsqu’ils entreprennent la datation de la ville, ce sont des événements historiques et politiques qui ponctuent leur propre calendrier ; l’année de la famine (1939), le débarquement américain (1942), l’exil du roi Mohamed V (1953), l’indépendance (1956), les événements du Rif (1958), la mort de Mohamed V (1961), les émeutes estudiantines (1965)…
Paradoxalement, les anciens bidonvillois nous apparaissent comme ceux qui ont marqué le plus violemment la rupture avec le pays natal. Quand la ville les a happés voilà près de cinquante ans, la migration marquait un divorce profond et définitif d’avec l’arrière-pays, et non pas un événement à tendance conjoncturelle comme c’est le cas périodiquement depuis les trente dernières années.
L’ancienne génération s’éteint tout en assistant elle-même à la disparition de karyan Ben M’sik. Elle part sans livrer ses archives, alors qu’elle a vécu toute les mutations de l’espace précaire : ses quatre déplacements depuis l’emplacement d’origine aux abords du quartier habous, sa concentration du fait des regroupements successifs d’autres zones bidonvilloises, l’administration coloniale et la période nationaliste, la seconde vague d’urbanisation, l’édification de l’autoroute et, plus tard, les émeutes urbaines, enfin le recasement en deux étapes. L’ex-ruralité, c’est d’abord une mémoire. Celle de la ville.
Il y a un quart de siècle, le grand bidonville de Ben M’sik s’étendait sur quelque 90 hectares. Il existe des familles bidonvilloises de troisième et quatrième générations. Suite à la construction d’une autoroute périphérique, et surtout aux émeutes du pain de juin 1981, il fut décidé de mettre en place un gigantesque programme de recasement. L’essentiel de ces lieux est maintenant transplanté dans des cités. Décalée dans l’espace et le temps, la situation des habitants rejoint celle de leurs cousins serrés dans des banlieues ethniques en France, Italie, Belgique, Hollande.
Quand le bidonville s’avère non seulement un lieu d’habitation mais aussi une zone d’activités et un souk débordant largement en fréquentation ses limites géographiques, se pose le problème de l’énorme concentration des ordures. Des bandes de gamins en bas âge jouent à l’entrée du bloc sur les seules aires de jeux disponibles ; monticules de détritus où paissent des petits troupeaux de moutons, longs et sinueux filets d’eaux usées, sols parsemés de rocaille agressive, verre brisé, excréments humains, rats en putréfaction. Passé quelques jours d’immersion dans ce milieu d’habitat précaire, la métamorphose opère : pour peu qu’on ne soit pas totalement misérable, analphabète profond pour croire que le karyan est une occasion de vivre en ville à très bon compte, tout spontanément on sent monter en soi la radicalisation, sans même savoir quelles idées au fait seront les vecteurs de la contestation.
Au cours d’une nuit du mois de mai 2003, Casablanca est l’objet d’une série de cinq attentats sans précédent, dont plusieurs attaques-suicides, qui vont entraîner la mort de plus de 40 personnes, dont 13 kamikazes, et une centaine de blessés. Parmi les 14 kamikazes responsables de ces attaques à la bombe et à la voiture piégée visant des restaurants, un hôtel, mais aussi un centre culturel juif, huit venaient du quartier bidonvillois de Sidi Moumen. Subitement Casablanca, la capitale économique du royaume, découvrait l’existence en ses portes de cette jeunesse oubliée de Sidi Moumen, Hay Moulay Rachid, Hay Lalla Meriem, ces quartiers périurbains qui sont les parties honteuses, la face cachée et méconnue de la ville, et dorénavant le trou noir du royaume des « contrastes », des « mille et une couleurs » et de « l’éblouissement des sens ». Une fois de plus, ici s’est exprimée plus fort encore que l’inégalité sociale intrinsèque et fractale (récurrente, itérative), l’invariance d’échelle de l’islamisme radical.
Perspective algéroise. Nous sommes à Belcourt, ce haut lieu de la résistance algéroise. Le Front islamique du salut (FIS) vient de sortir grand vainqueur des élections municipales de juin 1990 ; moment historique au même instant où monte la crise du Golfe ; ceci est le premier scrutin libre de l’histoire du monde arabe. Nous tournons un film documentaire sur la nouvelle situation sociopolitique algérienne. Après avoir visité les tombes de quelques martyrs du quartier et suite à l’insistance de quelques jeunes désœuvrés (hittistes, « ceux qui s’adossent au mur, au hit » à force d’ennui et d’inactivité), nous sommes sommés de poursuivre notre travail d’information. Nous sommes conduits à quelques centaines de mètres de là pour filmer les conditions d’habitat dans un bidonville. À son mur s’inscrit le chiffre 6 (le numéro de la liste électorale porté par le FIS), résultat provisoire d’une équation sommaire : « Islam = Jihad », lit-on encore sur la façade. C’est à une véritable visite guidée que nous avons droit. Omar, photographe de métier et habitant des lieux, nous fait pénétrer dans le dédale de baraques à mi-chemin entre la construction de zinc et le préfabriqué. « Quand survient une mort d’homme, on n’arrive pas à faire passer le corps par ici. » Les familles, complices en colère, assistent Omar le photographe en ouvrant leur porte ; elles s’offrent sans état d’âme à l’œil voyeur de la caméra, soulevant les moindres recoins de leur intimité-problème. Ici les murs sont totalement couverts de moisi, là c’est le plafond qui est perméable et qui empêche la voisine du dessus de laver à l’eau son sol poreux et tout branlant. Plus loin encore, appuyée sur le mur d’enceinte, cette maisonnée a été détruite suite à un accident provoqué par un camion qui s’est renversé…
« Nous sommes des familles originaires de la Casbah. À la Bataille d’Alger, en 1958, les autorités françaises nous ont déplacées ici à Belcourt. Depuis, et malgré les promesses officielles, nous attendons toujours une solution. » Omar désigne maintenant les latrines collectives : « l’hiver quand il pleut, les égouts se bouchent, leswc débordent. Un jour de pluie violente, j’ai vu onze rats sortir des cuvettes… »
Contrairement aux bidonvilles casablancais, le bidonville de Belcourt dispose de l’électricité dans la majorité des baraques – même si, durant la saison des pluies, « on enlève les ampoules par peur du coup de masse ». Les habitants ont un statut économique nettement supérieur aux karyanistes ; ils sont propriétaires de voitures, et l’intérieur des baraques montre un équipement complet (réfrigérateur, cuisinière, télévision, mobilier).
Lors des élections municipales de juin 1990, « la grande majorité des habitants a voté pour le FIS » précise Omar. Et c’est un élu du parti islamiste qui l’a remporté dans la commune de Belcourt. Le choix du vote, on s’en doute bien, n’a pas été motivé par la portée du discours et la rhétorique du FIS. En Algérie, 28 années d’indépendance avaient sevré l’homme ordinaire des nourritures idéologiques. Nous sommes témoins : Alger, fébrile en 1990, cherchait dans la liberté politique des retombées concrètes.
Ici, des communautés survivent et produisent malgré tout, s’entassant à six et huit personnes par pièce quand l’espace vital par habitant n’excède pas un mètre, payant plus cher que les autres usagers de l’espace urbain l’eau, l’éclairage, leurs déplacements. Là, ils contournent un droit foncier inadapté pour édifier un quartier ou une ville nouvelle conforme, cette fois, aux normes urbanistiques et pourtant sans permis de construire. Du désordre découle aussi le processus endogène de régulation de la crise urbaine : la construction informelle assure entre le quart et le tiers des logements aménagés dans le monde.
La densité, c’est l’état continu d’une population installée en situation de désordre. C’est une promiscuité sociale, une contrainte incontournable de la cité du futur. La densité est la grande leçon des pauvres aux idéologues de tous bords, elle propage la bonne nouvelle : elle ne propose ni discours ni panacée. La densité procède du devenir, elle est cette forme d’auto-organisation irréductible à la récupération idéologique – et n’a donc rien à voir avec l’autogestion décidée par le haut, naguère brandie par les champions du non-alignement, vite enclins au despotisme. Elle est cette métamorphose permanente, une dynamique de type bottom–up, évolutive et ascendante, qui sécrète au quotidien et souvent par hasard des remèdes locaux et ponctuels à ses nuisances. La densité est un champ d’équation, chiffré mais vivant, de l’espace habité.
La diversité renvoie, quant à elle, aux origines culturelles et sociales, aux stratégies de survie, à la mobilité résidentielle, aux structures et à la dissémination familiales. La diversité met en outre l’accent sur l’individu-citoyen, ses droits, sa contestation, sa créativité. La diversité est l’état de discontinuité (le champ discret) des individus installés en grand nombre.
Dans les villes jahiliya, la base idéologique de l’urbanisation est définitivement aménagée : l’islamisme. Elle n’en est cependant qu’au stade expérimental. Elle donne à voir ce que seront les logiques sociales du futur, écologies dures qui poussent drues, radicales mais horizontales, qui devront réparer, en confirmant ou en mythifiant, l’amnésie collective induite par l’exode rural. Les projets de société qui naîtront seront peut-être autoritaires, contraignants, mais paradoxalement ils devront leurs succès au choix démocratique, par le biais de scrutins municipaux qui reflètent déjà, non pas tant la richesse des philosophies en jeu, mais l’ancrage au quotidien, dans le réel en temps qui dure, collant à l’angoisse profonde, aux attentes du plus grand nombre.
Car enfin, l’urbanisation est aussi un phénomène culturel. Qu’il se situe dans l’immense conurbation Milan-Dublin, en Afrique de l’Ouest ou dans le Sud-Est asiatique, le plus grand nombre cherche ses conditions initiales, ses appartenances, ses marques perdues entre ruralité originaire et citadinité déclassée. Oui, désarçonné par les mutations en chaîne désarticulant logement, formation et travail, défié par le mondialisme et le radicalisme, le plus grand nombre poursuit son œuvre : embellie entre misère et lumière.
Extrait de Le désarroi identitaire. Jeunesse, islamité et arabité contemporaines de Réda Benkirane (Paris, Cerf, pp. 81-116).
![]() 11 SEPTEMBRE 2001, 14h00 CET. CONSEIL OECUMENIQUE DES EGLISES, GENEVE.
11 SEPTEMBRE 2001, 14h00 CET. CONSEIL OECUMENIQUE DES EGLISES, GENEVE.
Ma présence est comme abstraite au poste de travail, le regard vitreux, je suis en quelque sorte la prothèse de ma machine. Toutes sortes de pollutions abondent dans l'espace-temps informatique dans lequel je suis immergé depuis quelques mois. L'existence au sein de ce système épuise nerveusement, mais son écologie d'artefacts a l'avantage de permettre à l'esprit de fonctionner en parallèle sur le mode de la pensée automatique et machinale. Une partie de mon esprit charpente l'architecture de réseau, tandis qu'une autre vagabonde ; elle cherche une incarnation dans quelque chose d'autre que l'ombre de moi-même. Je voudrais être hors de moi-même, ailleurs et voir si j'y suis. Voilà que j'y renonce, fatigué d'avance par le manque d'attrait de l'imaginaire virtuel et technologique. Je songe alors à cette image, bouddhiste, de ce que je crois être la sérénité parce qu'elle se joue de la douleur ; poser le dos droit, croiser les jambes en tailleur, contempler indéfiniment un mur uniforme à quelques centimètres devant soi, bien respirer, ne plus penser. C'est tout. Nâgârjuna et Niffari sont mes yogis, gymnastes extrêmes du monde mental. Je me nourris de cette image en compilant machinalement des données somme toute sans importance qui nourrissent, prolongent indéfiniment le temps réel. Voilà la seule gymnastique à l'horizon de l'homme moderne, me dis-je, quant au système, à force de grossir en taille, en mémoire, en nœuds, il finira bien par détraquer la Matrice qui désormais enserre notre existence.
14h50 CET. Le poste téléphonique interrompt ma pensée vagabonde. On me signale qu'ont lieu au même moment des détournements au-dessus de New York et qu'il faut se rendre dans les locaux voisins de l'ONG œcuménique humanitaire où un téléviseur diffuse la chaîne américaine CNN. Je m'y précipite sans me douter que je m'apprête à suivre en direct l'événement le plus invraisemblable de l'histoire contemporaine.
Une vingtaine de personnes, toutes des experts du monde des ONG, observe les images en direct de New York. Personne ne parle parmi l'assemblée – anglo-saxonne pour l'essentiel ; pas de cris, ni de pleurs, ce sont des professionnels du malheur des autres. Ils seront restés sobres et dignes jusqu'au bout ; je n'aurai prononcé, quant à moi, aucune parole pendant près de 90 minutes.
Une barre de sous-titres expose sobrement ce qui se passe. La tour nord du World Trade Center se consume déjà lorsque j'entre dans la pièce. Les images ne collent pas avec les sous-titres. De quoi s'agit-il? Un incendie, une bombe? Non, c'est un avion qui s'est encastré dans un des plus célèbres édifices de la ville, à hauteur de ses 94-98 es étages. Un Boeing planté dans un gratte-ciel, c'est la sur-modernité qui se télescope. Mais où est l'avion ? Je me place au milieu de la salle, droit et immobile, et vais contempler l'impensable spectacle télévisé par CNN. Jamais je n'ai vécu un telle aventure mentale ; ce qui a lieu en dehors de moi-même dépasse, devance ce que je n'ai pas le temps de penser et encore moins d'énoncer et de comprendre. Du virtuel démultiplié par son entrée dans le réel dur qui dure jusqu'à sa mort en temps réel. Je fais le vide devant l'écran. Tout est si direct, l'impensable s'incarne à la vitesse de la lumière, crevant le mur du sens : le monde assiste, accouche d'une réalité sans nom qui épuise d'avance tout imaginaire concevable.
16h05 CET. Je sors un bref instant de ma torpeur. Alors qu'un sous-titre nous apprend que le Pentagone brûle, je commence alors à cerner l'ampleur de l'événement-catastrophe. Ceci n'est pas seulement un colossal accident matériel et logiciel, ce que voient des milliards de téléspectateurs a pu être pensé et mené par une poignée d'individus. Quelle disproportion entre les moyens, la cause et l'effet-monde produit. D'où l'hallucinant effet de levier, le dard planté au centre le plus symbolique – et le plus névralgique – de la sur-modernité.
L'édifice crevé par un second avion civil-missile d'United Airlines – Boeing lui aussi, jumeau 767 – fume, et malgré l'émiettement de sa sœur jumelle résiste toujours et ne plie pas. Devant cette rupture de symétrie posée comme une résistance aux ravages du virtuel, j'émets en mon for intérieur une seconde réflexion ; « l'avion s'est planté au milieu… donc la tour ne peut pas s'effondrer. L'opération est hardie mais a en partie échoué. » Et c'est alors à la même fraction de seconde que la jumelle commence sa chute infernale. Tétanisé, j'ai cru que ma remarque avait suffi à faire basculer le gratte-ciel. Terrorisé, oui, transi de peur, j'ai compris qu'un court-circuit logique avait été déclenché ; entre ceux qui l'ont fait et moi qui l'ai vu.
Quand la seconde tour a commencé à vaciller, le sol a manqué sous mes pieds. Comment dire ? j'ai cru que tous nous partirions avec cette seconde tour. Et, étrangement, je me suis senti intensément partir, physiquement défaillir, emporté dans les nuages de poussière et de chair, les débris de la Matrice.
Eventrée, la Matrice s'est finalement brisée en des fragments aussi fins que sa symbolique était jusque-là puissante et éloquente. Sur le plan de l'anthropologie fondamentale, l'effacement des tours annonce une nouvelle – cette petite apocalypse – surpassant toutes les autres. Vulnérable, fragile, plus que mortelle, la civilisation de la sur-modernité.
Dans cette hypnose de l'écran qui rend inapte l'écrit, j'ai cru un instant comprendre alors l'hypnose collective, l'aspect jubilatoire des images virtuelles de la première guerre du Golfe. Il y avait dans le spectacle de New York et Washington quelque chose de plus sain parce que les images que nous voyions n'étaient d'aucune censure ni désinformation. Tout se défaisait, s'écroulait en direct, la voix off , le commentaire étaient superflus. Quelques milliers de civils innocents venaient de partir en quelques minutes. Ce n'était pas vraiment nouveau, par exemple pour les populations civiles d'Irak, de Palestine, de Bosnie , du Soudan, du Rwanda, de Tchétchénie, mais cela l'était assurément pour des Nord-Américains que rien jusque-là, et au-delà de Pearl Harbour, n'avait pu atteindre sur leur sol. Ce qui n'a pas été compris lors de la première guerre du Golfe, me suis-je dit, l'aura été avec l'hallucinante attaque sur les tours jumelles et le Pentagone. Action et réaction, la filiation des événements m'a paru évidente. Ce qui s'est déroulé sous nos yeux est la réponse du berger de l' Arabia Felix et du Yemenau cow-boy de l'Ouest et de l'Espace qui lance, narquois, ubiquitaire, à ce dernier très remonté : catch me if you can .
COMPRENDRE, PENSER L'ECART A L'EQUILIBRE. Trois années ont passé depuis les attaques du 11 septembre, et depuis ont eu lieu les secondes guerres d'Afghanistan et d'Irak. J'en ai tiré un seul enseignement : nous n'avons rien appris de ce qui s'est passé. Nous n'avons à aucun moment saisi qu'il est dorénavant illusoire, définitivement pathétique de persister à croire – au sens religieux du terme – que la science du contrôle et de la manipulation peut encore régir le monde chaotique, incertain et interdépendant qui est le nôtre désormais – pour le meilleur comme pour le pire. Nos dirigeants politiques et décideurs économiques, tous pays confondus, doivent d'abord se rendre compte qu'il existe une classe croissante de problèmes pour lesquels la prédictibilité, le contrôle ne sont que très relatifs. Pour tenter d'agir sur le monde, les politiques doivent paradoxalement opérer un véritable « lâcher prise » en se délestant des principes sommaires de la première cybernétique, celle de l'asservissement et du contrôle de l'homme et de la machine, pour recourir aux idées de la seconde cybernétique qui s'inspirent de la logique du vivant comme l'auto-organisation et l'émergence, ou puiser du côté de la théorie mathématico-physique du chaos et de la sensibilité aux conditions initiales.
Sur le sujet du terrorisme international où, tous, nous sommes d'accord sur le grave danger qu'il représente, il y a beaucoup à redire sur la manière irresponsable dont les dirigeants le traitent. Rappelons-nous tout d'abord comment la guerre du Golfe de 1991 fut vendue à l'opinion publique internationale ; une guerre « courte », « high-tech », « intelligente », « chirurgicale », quasi virtuelle puisque visible uniquement par écran interposé ; or il faut voir les évènements du 11 septembre 2001 comme un effet de retour, une remontée d'acide, ou si l'on veut la réponse low-tech d'une poignée de Bédouins hallucinés et irréductibles à la toute première guerre de l'information.
Toutes ces questions à l'évidence sont mal perçues et pensées par les décideurs politiques. Au lieu d'être conseillés par des politologues qui ne connaissent rien aux phénomènes critiques , à l'instable, au flou, à la dynamique et à la turbulence, les « politiques » devraient s'instruire auprès de spécialistes de la science des nœuds et des liens, de mécaniciens statisticiens, d'immunologistes, d'informaticiens, etc., qui les instruiraient sur la grande métaphore du réseau qui se déploie à l'horizontale à toutes les échelles d'observation.
Le 11 septembre a marqué la grande vulnérabilité de la première puissance mondiale, et en tout premier lieu le cuisant échec et la faible intelligence – c'est le moins qu'on puisse dire – des services de renseignements américains, qui font orgie de moyens technologiques et dépensent des dizaines de milliards de dollars chaque année pour espionner, écouter, photographier chaque mètre carré du globe. La guerre menée contre le terrorisme est désormais pensée comme pour combattre la gangrène, alors que nous sommes en présence d'un mal viral, certes extrêmement dangereux, mais encore faut-il agir et prévenir en conséquence. Il reste à trouver les thérapies appropriées, c'est-à-dire douces pour l'environnement humain. Les tapissages de bombes ne servent à rien, l'amputation ne changera rien ; on confond causes et symptômes et les remèdes sont pires que les maux, provoquant des rejets massifs avec l'étendue des dégâts collatéraux qu'ils provoquent. Ce n'est pas de chirurgiens mais d'acupuncteurs dont le monde a maintenant besoin pour renforcer ses défenses immunitaires contre pareils fléaux qui vont être amenés à se multiplier au sein de l'économie et de la société en réseau. Or, j'aime à penser qu'il y a d'innombrables acupuncteurs qui tentent par leur action discrète et bienveillante de différer l'avènement d'un monde-cadavre.
Si l'on veut pouvoir agir sur les risques inédits qui menacent tous azimuts, il est urgent de changer notre mode d'analyse basé sur la science du contrôle et de la manipulation. De plus en plus, le monde abonde en choses que nous ne pourrons jamais contrôler d'aucune façon ni même enrayer complètement ; mais nous pourrions agir sur elles de manière à les circonscrire, pour limiter leur capacité de nuisance, jusqu'à les faire progressivement se résorber. Tant que l'homme contemporain usera du système obsolète du contrôle et de la commande en lieu et place des logiques non linéaires d'émergence et du complexe, il y aura action et réaction, et par conséquent d'autres singularités inimaginables, du type de l'effacement des tours de Manhattan, viendront aplanir notre paysage évolutif de lutte pour la survie, pour à chaque fois mettre à niveau le plus fort et le plus faible.
Extrait de Le désarroi identitaire. Jeunesse, islamité et arabité contemporaines de Réda Benkirane (Paris, Cerf, pp. 180-186).
